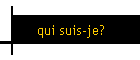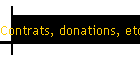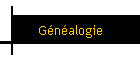L'île, c'est une belle petite
miniature dessinée par la nature bien avant que les Japonais aient commencé
à miniaturiser tout ce que les Américains avaient inventé. Cette île qui
n'est que de quelques centaines de mètres carrés de superficie semble parfaitement
ronde. Illusion d'optique que l'on obtient à cause de la distance et le
clapotement des vagues; effet qui fait perdre à l’œil la précision sur la
pureté de l’image. Cette île fut acheté de la Seigneurie Nicolas Rioux, (Il apparaît
curieux que le gouvernement n’avait pas encore fait l’acquisition des cours
d’eau, lacs et rivières à la fin des années 1930, et de plus que la
Seigneurie Rioux existait encore mais je le tiens de Réal Dionne qui me l’a
raconté le 22 juin 2004) par celui qu’on appelait l’avocat Gagnon de
Rimouski. Réal me dit que M. Gagnon ne l’a pas gardée longtemps mais ne se souvient
pas du nom de celui qui la lui a vendue en 1944.
Note: Les seigneuries ont été abolies en 1854, mais pour
des raisons que je ne connais pas certains terrains non concédés demeurèrent
la propriété des héritiers des seigneuries. Ma soeur, secrétaire de la
municipalité du Cap-St-Ignace me dit qu'elle collecte encore des redevances
seigneuriales de quelques sous par année sur certains lots.
Celui qui en était
propriétaire en 1940 y fit construire une petite maison qu’on peut
apercevoir du côté sud, le reste étant demeuré boisé. En 1944 Mme Dionne,
épouse de Réal devint malade de tuberculose et fut hospitalisée au
sanatorium de Mont-Joli durant un an et demi. Le médecin leur avait
conseillé de se trouver un petit coin tranquille où elle pourrait aller se
reposer durant sa convalescence. Réal était un jeune industriel florissant
et il n’avait pas envie de lésiner sur le coût d’un tel refuge. Par hasard, l’île
était à vendre et Réal en fit l’acquisition. Mais comme me le disait sa
femme, «ce n’est pas à cause de cela que j’ai guéri». Néanmoins, il en fut
propriétaire jusqu’en 1994; c’est-à-dire, durant cinquante ans.
J’ai toujours vue cette
maison peinte de blanc, et décorée de vert persienne. Cette résidence,
occasionnelle, cadre bien dans son entourage composé de grandes épinettes et
de sapins, verts bien sûr. Tête au ciel, ils rendent grâce à la nature,
survivant si élégamment, seuls sur ce petit amas de terre menacé
perpétuellement par les vents, les vagues, la glace et le froid, au beau
milieu de cette étendue d'eau sans cesse en mouvement.
L'Oncle Omer m'a dit que cette
maison-château, que j'ai admirée depuis ma tendre enfance, avait été
construite par l'oncle Donat Boucher. Pas surprenant qu'il fut entrepreneur
en construction à Iberville durant les trente ou quarante années qui
suivirent. Cette année-là, en 39 ou 40, Donat Boucher avait épousé ma tante
Adrienne Thibault et, comme tous les jeunes de son âge, durant cette période
de crise qui n'en finissait plus; spécialement dans la région du bas
St-Laurent qui n'a jamais connu la prospérité, cherchait à effectuer de
menus travaux pour assurer sa subsistance. Comme il avait un peu
d'expérience et beaucoup de doigté pour les travaux de menuiserie et de
construction, il obtint le contrat d'ériger ce splendide refuge sur cette
île sans nom; au milieu d'un lac qui porte officieusement le nom de la
paroisse. (Réal me dit que effectivement, Donat Boucher avait construit
cette maison, mais il avait pris le contrat avec son frère Louis Dionne)
Tous les matériaux furent
transportés par canot de la terre ferme à l'île, me disait Omer Thibault.
Ce qui est possible advenant que le contrat lui avait été octroyé à l'été ou
à l'automne. Cela me laisse quand même septique car il aurait été tellement
plus pratique de charroyer ces matériaux en hiver, sur la glace, avec des
chevaux ou encore avec des camions mais je crois que les Dionne n’ont pas
commencé à transporter le bois de sciage par camion sur les glaces avant
1944 ou 1945. Je me souviens du temps où Réal et Onésime draguaient le
bois, depuis la tête du lac jusqu'à leur moulin à scie. Ces milliers de
billots flottaient à l'intérieur de grands troncs d'arbres, tous, retenus
les uns aux autres avec des bouts de chaîne. Je ne savais pas dans le temps
que cela s’appelait des estacades. Une puissante chaloupe à moteur tirait
lentement cette charge flottante, que seul le faible courant ne pouvait
attirer vers sa destination. La logique me dit que l'oncle Donat et son
associé avaient préféré assumer tout le travail, incluant le transport des
matériaux, qu'ils pouvaient effectuer quand cela leur plaisait et quand cela
leur convenait. D'ailleurs en été l'île était prête à recevoir les
matériaux, et la construction pouvait débuter incessamment. Par contre, en
hiver, on aurait dû empiler le tout et attendre la fin du printemps tard,
avant de pouvoir débuter son chantier. D'un autre côté, cela leur donnait du
travail (très rare à cette époque) pour plus longtemps et c'était cela le
plus important. Ils étaient jeunes, grands, (l’oncle Donat mesurait plus de
six pieds, et possédait une chevelure à faire rougir Samson ou à faire
pleurer les chauves, d'au moins deux pouces de haut même quand il portait
les cheveux courts) fort en muscles, il n'avait pas peur de ramer son canot
aller-retour entre les deux rives; même chargé de bois et d'outils, aussi
souvent que cela était nécessaire.
Ils accomplirent un
chef-d’œuvre digne d'un artiste; même s'ils ne se croyaient que des
apprentis artisans. Leur oeuvre fut l'admiration de milliers de personnes,
qui, à chaque regard, rendent hommage à des artistes inconnus, concepteurs
d'une oeuvre splendide, dans l'anonymat. Donat Boucher, comme tous les
artisans de son temps, ne possédait que quelques outils rudimentaires et
plutôt rustiques: égoïne, sciotte, varlopes, etc. Aucun des outils
électriques que l'on connaît aujourd'hui. Bravo mon oncle (décédé depuis
déjà longtemps, en 1985) qui n'a jamais considéré cette maison plus
importante que n'importe laquelle des milliers d'autres qu'il a construites
par la suite. Je souhaite que la famille Saucier de Trois-Pistoles, qui en
a fait l'acquisition vers 1980, saura rendre hommage au talent de son
concepteur; en effectuant les travaux nécessaires à sa conservation dans sa
forme originale, afin que ce monument historique continue de braver l'avenir
et faire l'envie de tous encore longtemps. (La famille Saucier possède des
magasins de vente de tapis et il semble que ces commerces en font une famille
très prospère)
Réal me confirme qu’ils ont
depuis, rénové le chalet de fond en comble; ils en ont fait un véritable
petit château. Ils ont aussi aménagé tout le terrain avec goût et richesse.
Lorsque Réal a vendu, l’île n’avait jamais été cadastrée et il a fallu des
mois de tracasseries avec le gouvernement pour le faire.
L'été, le lac nous prêtait ses plages de sable doux, son
eau chaude, parfois calme; nous permettant de jolies promenades en canot à
rames, et des baignades comme aucune piscine ne peut en offrir. Aussi, nous
y pêchions de jolies truites mouchetées et de l'anguille. Nous avions
l'habitude de pêcher la truite; spécialement au printemps, (bien après que
les glaces eussent quitté) en nous asseyant sur les quais de roche, érigés
au bord du lac, en des endroits propices à recevoir ces aménagements
spéciaux, provenant du dérochage du sol. La terre était composé de beaucoup de roches
et de très peu de terre. Alors quand on défrichait, on devait
empiler ces roches en tas ou en digues. S’il était possible d’en mettre au
bord du lac, cela évitait autant de perte de terrain précieux. ( Papa disait
qu’il marchait sa terre de long en large sans jamais y mettre le pied à
terre) Lorsque ces pierres étaient empilées sur le terrain, on les appelait
des tas de roches, mais lorsqu'elles étaient empilées dans l'eau au bord du
lac, à des profondeurs permettant la pêche, cela devenait des quais. Nous
avions l'habitude de voir des gens de la ville
passer des heures et des jours,
de pluie en particulier, à pêcher en canot, cherchant à différents endroits
qu'ils croyaient tous plus miraculeux les uns que les autres. Nous avons
souvent surveillé ces «professionnels» de la pêche, et nous voyions très
rarement lever une ligne au bout de laquelle une belle prise se débattait.
Pourtant ces pêcheurs possédaient de belles cannes à pêche avec moulinet, et
semblaient posséder toutes les techniques de la réussite. Nous faisions
pitié à côté d'eux avec nos perches, qui n'étaient que de vulgaires
branches; les plus longues que nous pouvions trouver, au bout desquelles
nous enroulions une vraie ligne à pêche, un poids, un hameçon et un verre de
terre frais, cueilli du jardin de maman. Pourtant, il était très rare qu'on
retourne à la maison sans quelques truites, qu'on ferait rôtir dans la
poêle, enrobées dans la farine, et rehaussées d'un soupçon de beurre et de
sel.
C'était aussi au printemps qu'on pêchait l'anguille. Les
Rousseau s'adonnaient à ce sport avec certains de leurs amis qui ne
voulaient pas manquer cet évènement. Pour pêcher l'anguille, il fallait
certains équipements que nous n'avions pas les moyens de nous procurer;
comme par exemple, un canot, (je me suis toujours baladé avec ceux des
Rousseau) et un fanal au gaz, qui donnait un éclairage très puissant. Les
Rousseau en avaient un, mais papa avait plutôt opté pour l'éclairage
électrique à l'aide de moulins à vent, ou de puissantes batteries, mais tout
cela n'avait aucune utilité sur un lac. Et pour compléter, il fallait un
harpon; sûrement l'outil le plus facile à acquérir et le moins dispendieux.
Alors, par les beaux soirs calmes, lorsque l'eau n'était que miroir, à la
tombée de la brunante, on apercevait soudainement une lumière très brillante
qui avançait lentement sur le lac, à quelques perches de distance du rivage.
On ne pouvait distinguer les pêcheurs. Très souvent, le lendemain, nous
avions droit à un dîner à l'anguille, qu'un des Rousseau avait offert à
maman. Nous aimions l'anguille pour un ou deux repas seulement. C'est un bon
mets, bien qu'il soit très difficile d'en consommer deux jours de suite, à
cause de sa viande pâteuse, collante et grasse; ce qui ne lui enlève pas son
bon goût. Un jour, au début des années 80, j'arrivai aux Iles de la
Madeleine et je rencontrai un de mes amis, un jeune du
nom de Turbide, qui demeurait à
quelques centaines de mètres de l'aéroport. Il m'invita à aller dîner
chez-lui (chez sa mère, avec qui il demeurait toujours n’ayant pas encore de
compagne). Mon avion partait en retard à cause de la bruine. Et tout à coup,
après avoir téléphoné à sa mère à mon insu, Serge vint me voir et me
demande; aimes-tu l'anguille? Et je lui dis, bien sûr, même si je n'en ai
pas mangé depuis environ 1953 ou 1954, lorsque maman en avait acheté d'un
pedleur qui s'approvisionnait des habitants du bord de l'eau à Beaumont
ou à St-Michel. Eux pratiquaient la pêche à l'anguille dans le fleuve. (cela
bien avant que la polution détruise la faune aquatique dans notre beau et
majestueux St-Laurent) Il me dit, alors si tu aimes l'anguille, tu viens
dîner avec moi chez-nous. Je protestai que je ne connaissais pas sa mère et
que c'était très gênant pour moi, mais rien n'y fit. Je savais d'avance que
je ne gagnerais pas car je connaissais les gens des Iles. Et je savais que
quand ils t'invitent, c'est que tu es leur ami et un ami ne peut rien te
refuser. (Mais un peu d'hésitation me semblait ordonné) Il dit, maman a
confectionné un repas à l'anguille, préparée à la façon des Iles et je suis
sûr que tu vas aimer ça.
J'ai mangé le festin de ma vie! De l'anguille précuite au
four, sur bois de cèdre, pour en extraire le gras, ensuite, mijotée à feu
lent dans une sauce dont eux seuls ont le secret. Accompagné de petits
pains maisons, chauds, croustillants, et du beurre salé. Précédé d'un
"petit" Gin de Quyper que j'ai apprécié pour une des rares fois de ma vie;
l'atmosphère aidant. Chaque fois que j'y repense, j'ai le goût de retourner
aux Iles, jaser avec ce monde accueillant, chaleureux, qui s'exprime avec
cet accent envoûtant, particulier. Quand on revient des Iles, on a
l'impression que tout le monde, il est bon, que tout le monde, il est beau,
tellement ce peuple est paisible.
L'hiver, le lac devenait notre patinoire, jusqu'à ce que
la neige se fasse trop abondante pour qu'on puisse l'enlever. Il arriva
souvent qu'avant de pouvoir retourner patiner, on dut attendre les
prochaines pluies. Celles-ci formaient des verglas assez épais
pour supporter les patineurs. De grandes étendues de glace apparaissaient
partout, nous permettant ainsi, de patiner jusqu'à ce qu'une tempête vienne
recouvrir ce dernier verglas.
Il était aussi très agréable de patiner sur le lac,
spécialement sur la glace qui se forme la nuit, à l'embouchure de la rivière
qui l’alimente. Souvent le courant de la rivière fait fondre les glaces sur
plusieurs mètres de distance. Et le lendemain, à la faveur du froid de la
nuit, il s'est formé une nouvelle couche de glace dans cet espace. Cette
glace est encore mince et inégale, parce que le jour arrivé, le courant
recommence à la faire fondre. De là, le danger pour qui s'aventure trop
proche de l'eau claire. Il nous est arrivé de voir craquer la glace sous nos
pieds. Dès que cela arrivait, il fallait se laisser glisser, en étendant son
corps, de tout son long pour répartir son poids, et donner à la glace une
plus grande surface de soutien. En rampant, on pouvait se tirer hors de
danger. Il fallait aussi se méfier des trous chaud. Il y a des endroits qui
sont alimentés par des sources souterraines dont l'eau plus chaude amincit
la glace, et s'il arrive de passer dans un tel endroit, il est possible de
se noyer. Il n'y a, à ma connaissance, qu'un seul homme qui s'est noyé dans
un tel trou dans l'histoire du lac. Il s'agit d'un des frères d'Émile
D’auteuil, le frère de Mme Dionne dont j'ai parlé plus
haut. Papa disait qu'on l'avait retrouvé au printemps, flottant sur le
rivage. Les petits poissons d'eau douce ne l'avaient pas dévoré.
Dès la fonte des glaces, le lac
redevenait notre terrain de jeux préféré. Lorsque les glaces avaient
commencé à fondre, (à délaisser leur emprise sur le rivage, et à se briser
en grands morceaux flottants, en guise de radeaux), nous avions vite fait de
nous procurer de grandes perches avec lesquelles on pouvait, en s'appuyant
au fond de l'eau, pousser ces blocs dans la direction de notre choix. On
appuyait les blocs les uns aux autres afin de pouvoir sauter des uns aux
autres sans danger. C'était un amusement agréable qui comportait ses défis,
et même si à première vue, cela semble dangereux, il n'en est rien. Notre
instinct et notre complicité avec la nature étaient aussi développés que
ceux des animaux. Quelques jours plus tard, de grands vents de printemps
s'amenaient et balayaient les glaces, jusqu’à la décharge. Le soleil ardent
aidé d’un vent chaud avait vite fait de les faire disparaître. Une fois le
lac libéré de ses glaces, il était agréable de faire du canot. Mais cela
comportait aussi ses dangers. Particulièrement lorsque les températures
changeantes du printemps, faisaient se lever brusquement des vents violents,
qui poussaient des vagues de quelques pieds de haut -capables de faire
chavirer une embarcation- qui n'aurait pas eu le temps de revenir à la rive
à temps. Le lac devenait alors une menace qui pouvait nous engloutir en
quelques secondes. Je me souviens d'une fois où nous avons navigué une chaloupe
--verchère-- dans des vagues de trois pieds; n'eut été de
l'expérience d'un gars à Edmond Dionne (Roland) qui était avec nous, nous
aurions probablement paniqué, et on connaît la suite.
Afin d'empêcher les animaux de voyager d'un voisin à
l'autre en empruntant le bord du lac, nous devions, à chaque printemps,
refaire les clôtures que les glaces avaient emportées avec elles jusqu'à
l'embouchure de la décharge à l'autre bout du lac. Ces débris de bois
fournissaient aux castors les matériaux dont ils avaient besoin pour
construire leurs barrages, qui parfois, créant obstruction à l'écoulement de l'eau,
faisait inonder les champs aux alentours. Pour refaire des clôtures, il
fallait travailler dans l'eau jusqu'à une profondeur d'au moins cinq pieds.
Pour ce faire, nous devions utiliser la voiture derrière le cheval (que nous
appelions dans ce temps-là, une waguine, montée sur roues à raton
de
bois entourées d'un bandage de métal). Nous faisions reculer la voiture le
plus loin possible, jusqu'à ce que la plate-forme flotte sur l'eau. Là, papa
enfonçait un long piquet, le massait pour l'enfoncer aussi profondément
qu'il le pouvait; s'il n'avait pas la malchance de pointer sur une
roche.....en alignait un autre et un autre....Lorsque les piquets étaient
bien solides, il n'avait autre choix que de descendre à l'eau, souvent très
froide tôt au printemps, pour y fixer (la broche piquante) les barbelés que
les vaches connaissaient bien, et qu'elles n'oseraient pas braver, même si
les pâturages semblent souvent bien meilleurs chez le voisin.
Pour nous qui étions enfants, monter dans la voiture qui
flotterait sur l'eau, c'était le sport, l'aventure, le plaisir de côtoyer le
danger, et surtout, le désir qu'ont tous les enfants de suivre leurs parents
partout. Pour papa, c'était le désespoir. Mais comme tout bon père de
famille qui ne veut pas toujours disputer, argumenter et déplaire, il
accédait à nos demandes plutôt silencieuses mais combien insistantes; par la
façon dont on s'agrippait fermement aux parois de la voiture en signe de
refus de débarquer. Après les mises en garde habituelles et les conseils sur
la sécurité, le cheval recevait la commande de commencer son travail sans se
rebiffer même s'il n'aimait pas du tout reculer dans l'eau. Spécialement
quand son instinct lui dicte qu'à chaque pas, il s'enfonce davantage, ce qui
lui fait perdre son assurance et
le rend nerveux. Mais jamais d'incidents fâcheux
n'avaient
troublé ces opérations dangereuses; ce qui rendait papa moins craintif.
Mais, il y a toujours une première fois. Voilà que tout à coup papa compte
sa progéniture; un, deux, trois, quatre....il en manque un, où est-il? Une
seule réponse, tout au tour de la voiture, il n'y a que de l'eau. Tous
ensemble, on a vu Jean-Yves recroquevillé en forme de fœtus entre deux eaux.
Papa l'agrippe, le sort de sa situation et vivement le replie sur son genou
afin de lui faire vomir l'eau qu'il a avalée. Tel un vieux moteur qu'on
vient de noyer d'un coup d'accélérateur de trop, il toussote et se met à
respirer de nouveau. Ses poumons et son cœur reprirent rapidement, leur
rythme revient à la normal. Ces quelques éternelles secondes nous ont enseignés tous les
dangers du risque, et sans que papa eut à nous expliquer les faits et
détails, nous avions compris.
Cet incident ne nous a pas rendus plus peureux ou plus
craintifs. C'était arrivé à Jean-Yves parce qu'il était encore petit, ne
connaissait pas le danger et n'avait pas encore acquis beaucoup
d'expérience. Mais nous, un peu plus âgés, faisions déjà partie intégrante
de cet ensemble qui compose la nature; les lacs, les rivières, la forêt, les
animaux, les humains. Avions-nous peur de jouer dans la neige, de sauter
dans les tasseries de foin, de jouer au cow-boy dans les bois? Les
castors et les loutres avaient-ils peur de sauter dans les rivières et y
bâtir leurs nids dans des endroits presque inaccessibles? Les truites
avaient-elles peur de ces visages humains; l'appât pendu à la ligne,
manifestant une éternelle patience en attendant qu'une d'elles cède à la
gourmandise et devienne ce délicieux festin dans une poêle fumante? Non, ces
créatures n'ont pas peur car ils ne vivent que pour remplir une fonction
bien précise dans les cycles de la vie. Et nous, à l'exemple de cette nature
sauvage, nous avions hérité d'un instinct semblable aux autres espèces qui
composaient notre environnement. C'est cet instinct qui nous apprenait à
vivre en harmonie avec cette nature, souvent cruelle, à en jouir et aussi à
nous en protéger.
Même s'il n'était qu'une étendue d'eau d'environ dix
milles de long, le lac n'en constituait pas moins à cette époque une voix
fluviale très importante pour les habitants de ce coin de pays, qui
l'utilisaient avec imagination et discernement en hiver comme en été. Je me
souviens d'un temps où les Rousseau n'utilisaient jamais le cheval pour
aller au village à moins d'avoir à y transporter de lourdes charges. Le père
Georges, chasseur, trappeur aimait transporter
très lourd sur ses épaules. Il apportait les victuailles sur son dos
jusqu'au canot, traversait le lac à la rame pour ensuite se rendre à la
maison à pieds. Benoît, qui faisait de longues études dans ce temps-là
(huitième et neuvième année au couvent tout neuf, du village), voyageait en
canot tous les jours en été, et à pieds l'hiver. Les dimanches, les
Desjardins et les Rousseau allaient à la messe en canot. L'oncle Omer et
papa, qui avaient été élevés loin des grands cours d'eau n'ont pas réussi à
adopter cette coutume en été. A preuve; nous n'avions même pas de canot.
L'hiver, bien sûr, ils préféraient aux aussi la voie la plus courte, qu'ils
faisaient la plupart du temps à pieds. Mais mon père préférait de loin le
cheval et la carriole, qu'il conduisait avec autant de passion, que nos
mordus d'automobiles conduisent leur bolide. Edmond Dionne qui possédait un
camion (de deux tonnes) et plus tard une voiture, (Ford 1938) et qui avait
la chance de demeurer en bas de la côte, près du lac et juste en face de la
passe, préférait voyager par la route. Par contre, lui et ses enfants
faisaient plus de canot que tous les autres réunis. Souvent, c'était pour la
pêche, mais les garçons qui étaient aux études à Rimouski avaient appris que
les loisirs existaient déjà pour les villageois. Quand tu deviens citadin,
il n'y a pas plus beaux loisirs que les grands espaces, les lacs et les
rivières, où l'on peut pratiquer la pêche; devenue loisir depuis qu’on ne la
fait plus par obligation pour assurer sa subsistance.
Les cultivateurs du haut de la paroisse (partie ouest du
troisième rang vers Trois-Pistoles) qui possédaient des lopins de terre au
sud du lac, dans la partie surnommée le Circuit, allaient y faire une grande
partie de leurs travaux en canot. Les Dionne et Dionne et Fils etc. y
draguaient le bois de sciage qu'ils achetaient des fermiers qui exploitaient
des terres à bois qu'ils possédaient à la tête du lac. Enfin Omer Rousseau,
Opticien de Québec, et natif de St-Mathieu, venait à l'occasion visiter ses
parents avec son hydravion. Il faisait la joie de tous les habitants
passionnés d'aventure nouvelle; en leur offrant pour quelques dollars, la
chance de faire de courts vols de quinze minutes, au
dessus du lac. Nous
regardions cet avion avec étonnement, émerveillement; c'était la navette
spatiale des temps modernes.
L'hiver, grâce à la glace, nous n'étions plus qu'à un
mille du village, soit à pieds ou à raquettes; les deux moyens de transport
préférés du père Georges. Étant donné les côtes, que l'on surnommait parfois
précipices, tant elles étaient à pic, il ne nous était pas toujours possible
d’entretenir des routes carrossables vers le lac. Nous devions donc nous
contenter de faire le grand détour par la route. Mon père n'aimait pas
beaucoup la marche, par contre il aimait orgueilleusement ses chevaux. Il ne
manquait surtout pas d'occasions d'aller les faire parader au village; après
avoir bien astiqué sa monture et son attelage. Comme il était impossible de
faire marcher de jeunes enfants dans la neige et le froid jusqu’à l’église
le dimanche; mon père avait sûrement raison de nous y amener en voiture. Car
pour lui, cette façon de faire était bien normale; c'était la façon de faire
lorsqu'il était enfant lui aussi.
Nous avions, nous aussi des terres éloignées. L'été, nous
entassions le foin dans de petites granges qui
avaient été construites sur ces terres à cette fin. Durant l'hiver, après
que le froid eut épaissi la glace sur le lac, nous installions un panier à
foin sur un «bobsleigh», pour transporter le foin de ces granges jusqu'à la
grange de la ferme principale. Ces paniers à foin étaient nommés ainsi parce
qu'ils étaient faits de deux cadres de bois, un en bas sur la voiture, soit
celle à quatre roues utilisées l'été, soit les bobsleigh l'hiver, et d'un
autre à environ six pieds de hauteur (beaucoup plus grand que celui du bas)
relié par des barreaux d’environ un pouce de diamètre insérés dans des trous
qu'on avait percés dans les cadres aux deux extrémités. Ces paniers qui,
somme toute, étaient assez grands pour la capacité d'un cheval ne
contenaient guère plus que quelques balles de foin pressé comme on le fait
aujourd’hui.
Lorsque les snowmobiles ont fait leur apparition dans
notre coin de pays, eux aussi utilisaient le lac comme raccourci; épargnant
ainsi de longs chemins lorsqu'ils transportaient bois, moulées, courrier ou
passagers. Je pense spécialement à notre voyage annuel, pour aller à la
messe de minuit, lors des dernières années que nous avons vécues sur la
terre du quatrième. Papa louait les services du snowmobile, qui
servait aussi de taxi lorsque demandé. Je me souviens que nous dormions tous
durant la messe, car c'était trop tard pour les enfants. Mais, nous n'avons
jamais dormi dans le snowmobile; cette merveille que nous avions tant
attendue.
Les Dionne et Dionne etc. utilisaient eux aussi le lac
mais de façon très particulière. Ils se promenaient en Jeep l'hiver, soit
pour aller superviser les coupes de bois dans leurs propres chantiers, soit
pour aller visiter les fermiers/bûcherons, de qui ils achetaient le bois de
sciage. Le temps venu, ils effectuaient le transport sur la glace avec leurs
gros camions de l'armée (cinq tonnes, à multiples roues motrices) à traction
intégrale, ce qui semblait pour eux une solution plus avantageuse que le
dragage, qui désormais, semblait avoir cédé sa place à une certaine forme de
modernisation; on est à la fin des années quarante.(A la toute fin de la
guerre)
Pour nous les jeunes, qui n'avaient aucune notion
technique quant à la capacité de la glace, ces lourds camions chargés de
bois nous impressionnaient grandement. Même si nous devions reconnaître que
la glace les supportait sans broncher, comme s'il se fut agi d'une route
moderne en été. Mais la bravoure des Dionne ne s'arrêtait pas là. Un jour,
Émile Lagacé, qui demeurait près de notre école, dans ce genre de petit
village qui s'était créé autour de l'employeur qu'était devenu Désiré
Dionne, avait décidé de déménager sa maison au grand village de la paroisse.
La distance n'aurait pas constitué un problème; n'eut été de la route très
étroite entre le lac d’un côté et les marécages de l’autre. On chargea la
maison sur de gros troncs d'arbres servant de skis et, à l'aide d'un
bulldozer, on tira la maison à travers champs et ensuite, sur le lac, dans
un endroit que je considère risqué; parce que situé très près de la
décharge, dans la partie qui justement, fond durant le jour et gèle durant
la nuit suivante. Mais, les Dionne avaient l'expérience. La partie la plus
dangereuse est toujours celle du bord du lac. Entre la rive et la glace, il
y a toujours une fissure qui laisse monter l'eau, et qui enlève à la glace
sa capacité de flottaison. Mais les Dionne avaient pris soin de préparer le
chemin à l'avance, en enlevant la neige, pour laisser le froid pénétrer en
profondeur et, assurer ainsi un passage sécuritaire. Passé le lac, on grimpa
la pente dans sa partie la plus douce. On vint ensuite déposer la maison sur
ces nouvelles fondations; celles-là même qui la supportent depuis ce temps.
Les habitants d'un lac comme ceux d'une île apprennent à vivre avec leur
environnement particulier; ils apprennent à utiliser les ressources du
milieu de façon ingénieuse, étrangères aux non initiés.
Le lac s'était également donné et aménagé un avenir de
loisirs. Les différents peuples indigènes; Iroquois, Algonquins, Malécites
et autres, qui furent les premiers habitants de ce coin de pays, ont été à
même de bénéficier de ses bienfaits et ressources; des ruisseaux et rivières
qui l'alimentent. Ils le parcouraient en canot, y pêchaient, y tendaient des
pièges à loutres, à rats musqués et à castors. Ces animaux, à viande non
comestible, (au goût des humains) fournissaient à l'industrie du vêtement,
des fourrures de très grande qualité. Des fourrures bien chaudes comme
l'homme en a utilisé durant des millénaires, pour se vêtir convenablement et
braver les éléments sans peine. C'était bien avant que l'homme invente tous
ces habits légers, chauds et à l'épreuve des radiations, du froid intense de
l'espace, de la chaleur extrême ou de la friction due aux vitesses des
vaisseaux spatiaux durant la conquête d'autres planètes. Mais pour ces
premiers habitants, les lacs étaient la voie d'accès à toutes ces sources
d'approvisionnement, qui assuraient la subsistance des familles. Pour eux,
le lac faisait partie intégrante de la vie de tous les jours.
Note: Les peuples indigènes étaient
tous nomades et parcouraient les territoires à partir du Maine et de la
Rivière St-Jean, le Témisquata et retournaient vers la Gaspésie au gré des
saisons. On ne pouvait pas dire que telle ou telle nation vivait à tel
endroit. Ils vivaient partout et nulle part à la fois, selon le livre,
l'histoire du Bas St-Laurent.
Déjà, à la fin des années 1930 on patinait sur le lac.
On faisait du canot pour s'amuser. On se promenait en chaloupe motorisée. On
pêchait pour se distraire. Et le père Georges lui, tendait des
pièges à
loutre et à rats musqués.
C’était son loisir préféré. Depuis toujours, on s'y baignait sur ses plages
et, années après années les citadins et villageois construisaient des
chalets tout autour; aménageaient ses rives et commercialisaient ses plages.
Restaurants, hôtels et salles de réceptions font maintenant partie du
paysage. Les montagnes qui le bordent sont devenues des pistes de ski alpin
achalandées. Facile d'accès, on y arrive de tous côtés, grâce à un réseau
routier le reliant aux grandes routes nationales. On s'y rend de Québec en
deux heures, de Rimouski ou de Rivière du Loup en une demi-heure. Grâce à sa
grande capacité d'adaptation, le lac contribue au mieux être de ses
riverains; depuis ceux qui y vivaient de pêche et de chasse, d'agriculture
ou de coupe de bois, jusqu'à ceux qui y vivent de loisirs. Sans compter le
grand apport financier qu'il contribue au trésor municipal.
Le lac par lui-même est presque un tout; d'ailleurs tout
s'y rattache: l'agriculture, l'industrie forestière et touristique, la
villégiature et le résidentiel. Tous, depuis les différents peuples
amérindiens jusqu'à nous, ont vécu de ses ressources. La grande différence
entre le passé et le présent réside dans le fait qu’on y exploite maintenant
des ressources différentes. Et, je puis prédire sans crainte de me tromper,
que grâce à l'esprit inventif de l'homme, on trouvera encore d'autres façons
de bénéficier de l'immense générosité de ce lac. Qu’il saura encore
s'adapter aux besoins nouveaux de ses habitants, à condition que l'homme,
souvent négligent et sans scrupule, soit de plus en plus conscient de la
valeur de cette ressource, et protège son environnement.
haut de page
Incidents de boucherie.
Je me souviens aussi d'un autre incident, très malheureux
celui-là, car il aurait pu causer la mort de mon père. Cela devait être vers
la fin novembre. On abattait un porc d'environ 250 livres dans l'entrée de
l'étable. Il y avait les Rousseau: Mathieu, Victor, Henri et le plus vieux
des fils de Pit Desjardins, Gérard. Tous étaient affairés à retenir le
cochon couché sur le côté; un tenait les pattes arrière, l'autre les pattes
avant écartées pour permettre la saignée. Le plat pour récupérer le sang
était juste au-dessous d'où se ferait l'incision dont s'était chargé mon
père. La saignée se fait au moyen d'un grand couteau d'environ douze pouces
de long, étroit et mince, très bien aiguisé, qu'on insère entre les deux
épaules pour atteindre le cœur de l'animal, qui écoule son sang par
l’incision laissée par le couteau; jusqu'à ce que mort s’en suivre. C'est au
moment précis où mon père s'apprêtait à percer la peau que se produisit un
évènement qui n’arrivait guère plus d'une fois par année; un de ces vieux
avions monoplace volait très bas juste autour des bâtiments. Tous ces
jeunes lâchèrent le cochon au même instant, et sortirent en vitesse regarder
ce rare phénomène. Le cochon se sentant délaissé de ses tortionnaires
sursauta rapidement, et la main de papa glissa sur le couteau. Ayant pour
résulta une coupure entre le pouce et l'index qui se rendait jusqu'à l'os.
Papa essayait de conserver son calme malgré la gravité de
la situation. Il sortit vite de la grange et demanda à l'un des gars d'aller
vite chercher sa jument trotteuse et de l'atteler au buggy ; pendant
qu'il allait à la maison se faire un tourniquet pour arrêter l'effusion de
sang, et se préparer pour se rendre chez le docteur Catellier de
Trois-Pistoles, à douze milles de chez-nous. Le bras en écharpe, il monta
dans la voiture, saisit les cordeaux de sa bonne main, et lança sa trotteuse
au maximum de la vitesse qu'il lui savait être capable de maintenir, pour
atteindre son maximum d'endurance. Les chevaux et lui ne faisaient qu'un;
ils avaient toujours vécu ensemble et se complétaient. Pour sauver son
maître, la petite jument parcourut les douze milles en un temps record. Et
même s'il avait perdu du sang tout le long du parcours, il n'était pas
encore trop affaibli. Le docteur Catellier (seul docteur Catellier dans la
province dans ce temps-là, et père du seul docteur Catellier inscrit à
l'association des médecins de toute la province en 1982, qui exerçait sa
profession au CHUL; lui-même m'a révélé ces faits à mon grand plaisir car
après tout c'était la première fois depuis nombre d'années que j'entendais
parler du médecin qui m'a mis au monde) ce bon docteur de campagne qui en
avait vu d'autres, dit à mon père, je vais te geler ça et coudre la coupure.
Papa qui n'a jamais manqué une occasion de faire son dur et surtout d'avoir
la chance de le raconter plus tard lui répondit; non, j'ai assez perdu de
temps comme ça, faites-le à froid et tout de suite s'il
vous plait. Le docteur dit, je veux
bien mais tu ne le supporteras pas. Et mon père lui dit, ça ne fait rien, je
vais essayer. Le médecin pria sa femme de venir l'assister. Dès qu'il
commença à coudre, mon père perdit connaissance. Dès qu'il se réveilla, il
repartit pour le long trajet du retour à la maison. ( Je suis encore surpris
qu’il ait trouvé assez d’humilité pour nous raconter l’incident, admettant
de ce fait, peut-être à sa grande surprise, sa propre vulnérabilité) La
petite jument repartit donc sur la route du retour. Et ne se sentant plus
pousser à toute allure, repris son petit train régulier, suivant son
instinct. Elle put reprendre son souffle et maintenir un rythme qui lui
éviterait la fatigue; pendant que son maître, écrasé sur son siège, et
affaibli par cette aventure, ne savait pas trop bien s'il dormait ou s'il
rêvait, tant il voyait défiler des essaims d'étoiles noires devant ses yeux
chaque fois qu'il les entrouvrait.
LA POLITIQUE, A ST-MATHIEU
Durant les années florissantes du Duplessisme, au
provincial, et la montée vertigineuse du Crédit-Social de Réal Caouette au
Fédéral, la vie politique remplissait une bonne part des activités sociales
de plusieurs citoyens de St-Mathieu. Un fermier entreprenant et respecté, du
nom d’Émile Paradis était l'organisateur de l'Union-Nationale dans la
paroisse. Tout le monde votait bleu; enfin, presque tout le monde! Tous les
dirigeants de la paroisse, aussi bien religieux que municipaux, de la Caisse
Populaire ou de la Coop, votaient bleu; même mon père, qui lui aussi faisait
partie de l'un ou l'autre de ces organismes votait bleu. Le parti de
Duplessis contrôlait si bien le peuple, en se servant du clergé, et en
appliquant les méthodes de persuasion efficaces de la religion, que celui
qui résistait aux bleus était considéré comme un renégat au même titre que
celui qui se serait dit protestant.
Note: Duplessis était bien l'un des
premiers politiciens à se servir du clergé. Car depuis des siècles, ce fut
toujours le clergé qui se servit de la supposée classe dirigeante pour
parvenir à ses fins.
On avait obtenu une subvention pour construire un couvent
mixte; c'est-à-dire, pour garçons et filles. On y enseignait la huitième et
la neuvième année, après quoi on arrêtait les études, (car ceux qui
atteignaient ce niveau de scolarité à la fin des années 40 étaient
considérés comme instruits) ou on se dirigeait vers le collège de Rimouski
(où il fallait presque promettre de devenir prêtre pour y accéder), et
surtout trouver l'aide financière requise. C'était une école que l'on
appelait couvent parce que c'était des sœurs qui y enseignaient. Et, si on
se réfère à la croyance populaire du temps qui voulait que Duplessis achète
le vote de la population par l'entremise du clergé, on croyait qu'en
impliquant au maximum la dimension religieuse, Duplessis ne pourrait refuser
aucune subvention.
La politique provinciale, municipale et "religieuse"
ne faisaient qu'un. D'ailleurs, on y retrouvait partout les mêmes personnes
et les mêmes clans. Ils étaient tellement préoccupés par ces trois factions
qu'il n'y avait plus de place pour la politique fédérale, (ou à peu près)
jusqu'à l'arrivée des créditistes de Réal Caouette dont je parlerai plus
tard.
Les clans se composaient de cultivateurs comme Émile
Paradis, organisateur de l'Union Nationale, donc, l'homme de Duplessis.
D'autres comme mon père et l'oncle Omer, membres du comité de direction de
la Caisse Populaire et de la Coop, étaient les plus fidèles amis et les plus
fidèles servants (bras-droits et parfois garde-corps) de Gérard Ouellet,
Président de la Caisse. Gérard Ouellet, maître-chantre, grand penseur,
philosophe, intellectuel, politicien anonyme, tenant les ficèles des
dirigeants, manipulateur dans le sens positif du mot, homme souvent discuté,
parfois craint, parfois détesté, presque toujours respecté, même par ceux
qui ne partageaient pas ses opinions, (à cause de sa réputation de fervent
catholique d'une droiture et d'une franchise à toute épreuve) il ne laissait
personne indifférent. A la fin des années 50, il devint député du comté de
Rimouski sous la bannière créditiste. Mais, lorsque Réal Caouette commença à
perdre la faveur populaire, Gérard abdiqua et joignit les rangs des
conservateurs vers la fin de son deuxième terme. (Je ne croyais pas qu’un
jour un si grand homme ait une si grande faiblesse). D'autres comme eux,
actifs dans les diverses activités paroissiales, religieuses, sociales,
coopératives et politiques complétaient l'un ou l'autre clan.
Le clan d'opposition à Gérard Ouellet n'osait pas
s'insurger contre le clan du gros bon-sens; politiquement du bon bord.
Lorsqu'un mouvement de protestation se levait contre les idées du clan
dirigeant, Gérard, l'intellectuel, l'homme dont la personnalité,
l'intelligence et l'envergure dépassait de loin quiconque dans la paroisse
aurait voulu le contester, organisait une grande assemblée générale dans la
grande salle paroissiale. Escorté de ses deux fidèles amis (Donat et Omer
Thibault) qui, physiquement n'avaient peur de personne, passait à travers la
foule et se dirigeait sur le podium, calmement et sûr de lui. Il allait
justifier devant la population, les décisions des dirigeants. Même s'il
essayait de simplifier son vocabulaire, pour se faire mieux comprendre des
moins instruits, son langage intellectuel impressionnait tellement les gens,
que même s'ils n'avaient pas très bien compris, ils croyaient qu'il (Gérard)
avait raison. Et de toute façon, ils n'avaient pas les arguments pour se
lever et le contester publiquement. Il ne restait que les quelques radicaux
du clan adverse qui osaient crier leur désaccord, au grand dam de la foule,
qui croyaient que ces gens ne cherchaient qu'à créer la bisbille pour se
rendre populaire.
Gérard disait à la foule, «mes amis, moi je suis fumier».
Quelle belle phrase pour des agriculteurs qui ne réussissaient pas à se
débarrasser de cette salle odeur même dans leur lit! Ensuite il passait un
long temps à leur expliquer que cette expression voulait dire qu'il était
une source de connaissances où ces humbles agriculteurs, fidèles membres de
la Coop et de la Caisse Pop. pouvaient aller puiser lorsque cela s'avérait
nécessaire. Il avait le talent de prolonger son discours jusqu'à ce que la
réunion se disperse; ayant plus ou moins compris l'essentiel de ses propos.
Cela semble peut-être exagéré et un peu faux. Exagéré, je
ne crois pas vraiment. Faux, peut-être à certains égards, considérant qu'il
s'agit d'interprétations des propos et conversations de mon père, soit avec
des voisins ou soit avec ses frères; entendus par les oreilles déjà
éveillées de l'enfant que j'étais. Quoi qu'il en soit, l'important c'est que
nous les enfants, étions très souvent de fidèles auditeurs de ces
conversations d'adultes. Et je suis persuadé que cela a beaucoup contribué à
notre formation. D'autre part, comme mon père faisait souvent office de
leader, il était de ce fait, celui qui contrôlait les conversations et, vu
son implication plus intensive que les autres au sein des différents
mouvements, cela lui permettait d'être plus au courant, et de convertir
facilement les autres aux causes auxquelles il croyait. Je suis aussi
persuadé que sans le savoir, c'est pour ces raisons que nous aimions écouter
ces conversations et comptes-rendus; car, voyant les multiples facettes de
la personnalité de notre père, nous développions une fierté évidente et
normale. Il était évident que papa occupait dans son entourage un statut
particulier. Bien sûr, il dirigeait les soirées d'études organisées par
l'Archevêché de Rimouski. Il était actif au sein des mouvements coopératifs,
sociaux, paroissiaux. Il était moraliste, par nature; tous venaient se
confier à lui et quémandaient ses conseils. Il coupait les cheveux de tous
les autres dans le rang. (Il y avait dans ce temps-là beaucoup de barbiers
amateurs dans les rangs et souvent aussi les femmes, comme ma belle-mère par
exemple, qui coupaient les cheveux des enfants, de la famille ou des
voisins, car les barbiers des villages étaient souvent trop loin et trop
chers pour les moyens de ces grandes familles; c'était aussi, bien avant,
que l'on invente le travail au noir) Il était le remplaçant du père de ses
frères et sœurs; il les dirigeait. Il était toujours celui qui était en
avant; aujourd'hui, on dirait de lui, qu'il était un grand leader.
Il ne faut pas oublier que dans ces petites paroisses,
tout le monde se connaissait. Nous savions qui était pour, qui était contre,
qui était membre de la Caisse ou de la Coop. Celui qui n'était pas un
coopérateur subissait les regards hostiles au même titre que celui qui
n'aurait pas participé aux cérémonies religieuses. Je me rappelle que pour
mon père, emprunter de l'argent de la Banque Canadienne Nationale ou acheter
ses victuailles au magasin général était un sacrilège pour les
membres coopérateurs. D’ailleurs, il ne comprenait pas que quelques-uns
n'aient pas compris les bienfaits de la coopération. Malgré tout il est
toujours demeuré ami avec Magloire D'Anjou,
administrateur du magasin général, propriété du
maire Onésime Dionne
et de Léo Théberge, gérant de la Banque. Bien sûr, ces derniers ne
s’occupaient pas de politique d’aucune sorte, et ils pratiquaient leur
religion avec grande ferveur. Ils se devaient d’être des gens sans reproche.
La Banque Canadienne Nationale a survécu à l'implantation
de la Caisse Populaire Desjardins, même si durant plusieurs années, les
affaires étaient au ralenti. Ses fidèles clients devaient souvent se faire
discrets lorsqu'ils devaient franchir la porte de l'établissement, parce que
d'un coté, certains semblaient se sentir coupables de ne pas s'être
convertis à la Caisse comme les autres, et d'un autre côté, certains autres
ne voulaient pas se faire montrer du doigt par les coopérateurs. Il était
mal vu de pécher contre la Caisse et la Coop. Les dirigeants de ces
organismes avaient su cultiver dans l'esprit de leurs membres les mêmes
sentiments qui animaient leur appartenance à la religion catholique; on
pratiquait les deux avec la même ferveur et condamnait les dissidents avec
le même mépris.
La Caisse était administrée par Gérard Ouellet, marié à
la sœur de Monseigneur Parent; un enfant de la paroisse,
bien que né dans le deuxième rang de Trois-Pistoles. Un Gérard Ouellet
qui était frère de quatre prêtres et d'une religieuse. Fils d'une mère dont
tous disaient qu'elle était plus sainte que la Vierge ou le Pape et, qui par
surcroît était maîtresse de poste; donc qui avait accès aux petits secrets
de toute une population. Enfreindre les commandements d'une famille si près
de Dieu était cause de remords et de ressentiments, même s'il s'agissait
d'emprunter de l'argent à meilleures conditions.
Le magasin général lui, à l'instar de tous les magasins
généraux de cette époque, ouvrait ses portes sept jours semaine. Étant situé
juste en face de l'Église, les dimanches lui rapportaient gros car beaucoup
d'habitants des rangs profitaient de cette venue au village pour acheter les
menus articles que l'on y retrouvait. Mais, si je me souviens bien des
propos de mon père, ce n'était pas toujours bien vu d'aller encourager le
magasin général; surtout après que le nouveau magasin coopératif eut été
inauguré. L’ancien était situé dans un local temporaire et désuet dans une
bâtisse qui ressemblait à un vieux hangar désaffecté.
L'ouverture du magasin coopératif bénéficia d'une grande
campagne d'achat, là où tous étaient membres; donc tous propriétaires. De
telle façon qu'à la fin de l'année les profits retournaient aux membres sous
forme de ristournes. On appela ce magasin qui n'était pas en fait un magasin
général dans le vrai sens du mot; la Familiale. (Car c'est la meunerie
coopérative qui vendait les moulées et articles de quincaillerie et
plomberies, etc.) Le magasin était plutôt une sorte de grande épicerie, de
linge de travail en particulier, et autres menus articles. Ce magasin qui
fut astucieusement appelé La Familiale, portait en son nom le reflet des
nombreuses et grandes familles; une réalité de cette époque. Il faut se
souvenir que c'était à l'époque de la revanche des berceaux, l'époque du
Duplessisme où les prêtres directeurs/dictateurs de consciences enjoignaient
leurs commettants à mettre au monde le plus d'enfants possibles; seul moyen
de combattre la majorité anglaise au Canada. En ce temps-là quand on disait
canadien, on voulait dire québécois et pour ceux qu'on
nommait les canadiens,
on les appelle désormais les anglais. On avait oublié que le nombre ne combattrait jamais le
système éducatif des autres provinces, qui avait un siècle d’avance sur nous
qui avions comme premier ministre Maurice Duplessis, celui qui croyait
fermement que c'était en gardant la population dans l'ignorance que l'on
pouvait mieux la contrôler.
Le magasin de d'onésime Dionne connut des jours, voire
des années sombres. Le pauvre a dû compresser ses dépenses au minimum pour
survivre. Il faut dire que la population du village qui n'était pas
concernée par le système coopératif --qui s'adressait exclusivement aux
cultivateurs-- continuait à encourager le magasin général comme avant, à
condition que les prix soient compétitifs, selon la valeur de la
marchandise.
Cette compétition était devenue nécessaire pour le bien
de la population. Les coopératives, laissées à elles-mêmes, auraient
elles aussi, perdu le sens des justes prix et profits. Elles se seraient aventurées
dans des écarts de prix que ne leur permettait pas le baromètre fixé par la
compétition. C'est peut-être encore plus au niveau du service que la
discrimination aurait été plus évidente, et ce, au détriment de la
clientèle. D'ailleurs plus tard, certains employés des Coop. se lancèrent en
affaires. On vit apparaître; quincailleries, plomberies, épiceries,
merceries, etc. Ceci n'empêcha pas les Coop de progresser modérément, dû à
une lente mais sûre augmentation de la population, grâce en partie, à la
construction de nombreux chalets, hôtels, et aussi du centre de ski au sud
ouest du lac.
Les Dionne et Dionne etc. ne se sont jamais mêlés de la
petite politique locale. Ils étaient des industriels voués à l'entreprise
privée, qui ont su s'adapter très vite, et vivre en harmonie avec le
mouvement coopératif et ses membres. Ils vivaient du bois, l'achetaient de
qui en avait à vendre. Ils employaient qui voulait bien travailler; sans
discrimination. À l’exception d'Onésime qui fut maire de la paroisse durant
plus de vingt-cinq ans et préfet de comté durant de nombreuses années, aucun
des autres Dionne ne s'est mêlé à la politique locale ou autre. Même Onésime
ne dépassa jamais ses fonctions de maire. Les Dionne étaient des employeurs.
Ils ne cherchaient pas à obtenir des postes de directeur de caisse ou de
gérant de Coop ou de toute autre position que l'on peut atteindre grâce à la
politique. Ce sont eux qui avaient fait de St-Mathieu une des paroisses les
plus prospères du comté, et à ce titre, ils étaient bien au-dessus du
patronage politique.
Presque tout le monde de la paroisse avait un jour ou
l'autre travaillé pour les Dionne. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ils leur
avaient aux moins, à certaines occasions, vendu leur bois. Les Dionne
avaient besoin des autres et les autres avaient besoin d'eux. Les Dionne
vivaient de l'industrie forestière, et même s'ils possédaient une fabrique
de boites à beurre qui utilisait beaucoup de bois, c'est le bois d’œuvre qui
en constituait la partie la plus importante. Pour approvisionner leurs
scieries, ils avaient besoin de limites à bois; ces grands territoires
boisés que leur cédait le Gouvernement pour la coupe du bois. Je crois que
c'est à ce niveau que se situaient leurs convictions politiques, ils
devaient discrètement fournir à la caisse électorale du parti au pouvoir, et
discrètement aussi à celui dans l’opposition au cas où il remporte une
éventuelle élection; car ils avaient besoin de ces limites à bois et ils les
obtenaient.
Mais voilà que soudainement le Crédit Social, parti
populaire dans l'ouest du pays à l'époque, (la Saskatchewan d'où était
originaire son fondateur Louis Evans,) vint enseigner ses philosophies
monétaires et socialisantes au Québec par la voie de Réal Caouette. Grand
chef charismatique, il mit sur pied une organisation dynamique dans tous les
coins et recoins de la province. Son organisateur provincial était un
beauceron, hôtelier, dénommé Perron, surnommé le bras coupé, bras qu'il
avait perdu à la suite d'un accident quelconque. Il savait dénicher dans
chaque paroisse les bons hommes. Il était un homme convaincant, rassembleur,
populiste et spécialiste des discours politiques comme on en n’avait jamais
entendus. Nul ne résistait à sa verve enthousiaste qui n’avait d’égale que
les foules qui lui tendait l'oreille religieusement. Il savait se faire
comprendre. A St-Mathieu, ses deux hommes de confiance, organisateurs,
étaient les deux Omer; Ouellet et Thibault.
On mit tout en branle en vue de la prochaine élection
fédérale. Les Créditistes ne ménagèrent aucun effort. Caouette et ses
troupes étaient partout: radio, journaux, discours dans toutes les salles de
la province. Caouette et ses hommes attiraient les foules, ils étaient de
plus en plus convaincants. Ils parlaient le langage du peuple. Ils avaient
les solutions à tous les maux et donnaient toujours en exemple les
réalisations du parti en Saskatchewan et en Alberta. C'était facile et,
personne ne pouvait vérifier leurs dires. Comme les prédicateurs, ils
étaient porteurs de vérité. Leur philosophie de base ne tenait qu'à quelques
phrases; en tenant le pouvoir et les clefs de l'imprimerie, on n'avait qu'à
imprimer l'argent dont on avait besoin, le distribuer aux démunis et, leur
permettre d'acheter les produits dont ils avaient besoin. Stimuler la
consommation, l'économie, procurer du travail et assurer le bien-être pour
tous. C'était si simple et personne n'y avait pensé. La population qui ne
connaissait rien à la politique et à l'économie adulait ce langage et
embarquait d'emblée. Personne ne se doutait que nombre de ces philosophies
se retrouveraient un jour dans le programme du parti libéral de Trudeau, que
le pays s’endetterait de milliards de dollars, que l’inflation serait hors
control, que 40% des impôts iraient au service de la dette, qu’on
hypothéquerait l’avenir des générations futures. Et, bizarrement ce sont les
opposants à Caouette, c’est-à-dire les Libéraux et les Conservateurs qui ont
fini par réussir ce méfait en utilisant les politiques du Crédit-Social.
Tout ceci pour plaire à une population qui croyait que tout ce qui venait du
gouvernement était gratuit. Et, bien sûr, quand le gouvernement remet dans
l’économie les impôts et emprunte l’argent pour ses opérations, l’économie
va très bien, et le bon peuple, croyant que cela va durer éternellement,
continue de voter pour lui sans se soucier de mettre en péril l’avenir de
leurs enfants.
Par contre, un grand nombre de réformes proposées par les
créditistes devenaient de plus en plus nécessaires, dans un pays en pleine
progression économique; une population plus à l'aise, demandant plus de
mesures sociales pour venir en aide aux moins bien nantis. C'est d'ailleurs
sous l'insistance répétée des créditistes que le Parlement canadien adopta
des mesures comme les allocations familiales, l'assurance chômage, la
sécurité sociale, les pensions aux mères nécessiteuses et les pensions aux
personnes âgées, en autres. Le gouvernement n'avait pas le choix, il avait
compris que ces mesures étaient très populaires, et que les créditistes
avaient pris beaucoup de terrain grâce à elles. Ils (les créditistes) ne
pouvaient pas vraiment prendre le pouvoir mais si je me souviens bien, ils
avaient effectué un tel balayage au Québec en 1961 qu'ils étaient devenus
l'opposition officielle à Ottawa; ce qui mettait les libéraux dans une
position très fâcheuse, eux qui avaient perdu le Québec et, qui étaient
plutôt faibles dans le reste du pays. Je me souviens même d'un temps ou Réal
Caouette détenait la balance du pouvoir. C'était plus tard à l'époque de
Pearson et de Trudeau, qui durent accéder aux demandes des créditistes afin
de réussir à se maintenir au pouvoir.
Les deux Omer avaient fait leur boulot. Ils avaient
convaincu une grande majorité de l'électorat de St-Mathieu qu’ils n'avaient
plus rien à perdre. Les vieux partis nous avaient prouvé à maintes reprises,
qu'après avoir gagné l'élection, ils n'avaient plus rien à offrir. On devait
voter Créditiste. Cela sous-entendait qu'on avait tout à gagner et la
population avide de changements mordait dans le renouveau.
Au lendemain de l'élection, les deux Omer se promenaient
la tête haute, dans l'attitude des vainqueurs. On n'avait pas obtenu le
pouvoir, non! Seulement le pouvoir d'y jouer un rôle et de faire partie
d'une machine aussi complexe que le parlement d'un pays. Même si nos deux
compères étaient à des années lumières de ces hautes sphères politiques, ils
avaient comme bien d'autres, le sentiment d'avoir accompli leur mission;
faire élire un grand nombre de députés, donnant ainsi à leur parti une forte
représentation à Ottawa.
Mais le pouvoir politique est souvent bien éphémère. Il
navigue dans les hauts et les bas. Les Conservateurs ayant compris les
tactiques des creditistes les ont imités lors de la prochaine campagne
électorale. Et ce fut un balayage au Québec, qui donna le pouvoir aux
conservateurs. Ils avaient pu compter également sur de solides appuis dans
l'ouest du pays. Néanmoins, ce fut un gouvernement minoritaire dont la
balance du pouvoir était détenue, non pas par les libéraux, mais bien par
les créditistes.
Lors de cette élection, Omer Ouellet était déjà parti
s'établir sur un lot près d'Amos en Abitibi. Omer Thibault était demeuré le
seul organisateur et porte-parole des créditistes dans la paroisse, au
moment même, où l'engouement pour ce parti était à son plus bas niveau. Les
partisans créditistes d'un jour, qui étaient demeurés de fidèles bons bleus
au niveau provincial, avaient également voté bleu au fédéral.
Cette élection fut un échec total pour les créditistes de
Louis Evans dans les provinces de l'ouest comme pour ceux de Réal Caouette
au Québec. Seuls quelques comtés aux candidats très populaires ont survécu.
La philosophie du parti et le charisme des candidats n'ont pu survivre aux
vents récalcitrants des autres partis. Même mon père, fervent adepte
créditiste de la première vague, avait suivi le courant.
Cette élection avait eu lieu durant les vacances d'été de
1949 ou 1950. L'oncle Jacques Delisle de Montréal; homme personnifiant
l'effronterie et la grossièreté comme pas un, prenait habituellement ses
vacances annuelles durant la période de la récolte des foins. Même s'il ne
connaissait pas le travail de la ferme, il savait quand même se rendre utile
dans les champs et apporter une aide supplémentaire à mon père et à Omer
durant cette période plus achalandée.
Plombier de son métier, le travail à la ferme était pour lui un
divertissement qu'il appréciait beaucoup. Mais cette année-là en
particulier, ce sont les élections qui l'ont bien amusé. Car pour lui, rien
n’était sérieux, la vie semblait une farce et toutes ces farces lui
apportaient de quoi rigoler et survivre à la décrépitude d'une
vie d'artisan dans un métier qui n'a aucune chance de rendre un peu de
dignité à un travailleur ambitieux.
Jacques Delisle est un phénomène: de nature bouffonne,
joueur de tours, il s'amuse de tout et aux dépends de tous. Vulgaire et
semblant mal
élevéà ses heures, il est quand même le personnage le plus vrai et le plus naturel que
j'aie connu. Il est lui-même! Il ne subit l'influence de personne et n'a
aucune gêne à faire les pires conneries en se croyant le plus drôle des
comiques. Inconscient et sans malice, il peut commettre les plus grandes
bêtises envers les autres sans se faire adresser de reproches ou se faire
détester. Ses victimes restent bouche bée, déconcertées. Il jouit de la
protection de son caractère enfantin, naïf, qui s'amuse pour le plaisir sans
la moindre intention de blesser.
En ce lendemain d'élections, c'était au tour d'Omer
d'aller livrer les bidons de crème à la beurrerie et de subir les vacheries
de son beau-frère Jacques. A cette époque, les réfrigérateurs n'existaient
pas et nous arrivions à conserver la crème durant vingt quatre heures en
laissant tremper les bidons de crème dans une source d'eau très froide,
recouverte d'un toit, afin d'empêcher les rayons du soleil de la réchauffer.
Sinon les bactéries pouvaient se propager et rendre la crème impropre à la
consommation. Omer fit comme d'habitude la tournée des quatre cultivateurs;
mais ce matin-là, il était accompagné de Jacques, qui, sans connaître le
déroulement du voyage, y voyait sûrement une bonne occasion de se payer la
tête d'Omer en ce lendemain d'élections. Ils traversèrent le village d'est
en ouest jusqu'à la beurrerie, échangèrent les bidons pleins pour les bidons
vides de la veille, et s'en retournèrent via le magasin général, la
meunerie, etc.; là où il y a toujours du monde tout oreille tendue! Jacques
Delisle a crié à qui voulait l'entendre "oui c'est vrai, le Crédit Social
s'en vient, il y a eu un vote!" Le pôvre Omer humilié n'a pas réussi
à le faire taire; au contraire. Jacques continua de répéter son cri
victorieux, et si humiliant pour Omer qui essayait d'oublier sa déconfiture.
La paroisse et la politique continuaient leur petit
train-train. Pour Omer Ouellet, c'était fini, l'Abitibi le tint si occupé
qu'il n'y repensa plus. Pour nous, c'était le déménagement à Beaumont en
1951. Une nouvelle vie et un nouvel environnement nous ont détachés de tout
cela. Omer vendit sa terre, acheta une maison au village de St-Mathieu. Il
travaillait désormais pour l'Électrification rurale où il fut électrocuté en
1952 à l'âge de 33 ans. Il ne mourra pas, mais on lui amputera les deux bras
à quelques pouces en bas des coudes. Il avait déjà neuf enfants et cela ne
l'empêcha pas d'en avoir trois autres; à la grande surprise de tous ceux et
celles à qui il répétait en leur répliquant; que rien ne l'empêchait d'avoir
d'autres enfants, c'étaient ses bras qu'il avait perdus!
Omer ne pouvant plus travailler s'impliqua davantage dans
les divers mouvements et activités sociales de la paroisse. Ayant pris le
goût de la lecture, il parvint à accumuler un bagage intellectuel
impressionnant qui le rendait de plus en plus, socialement important.
Comprenant le désarroi des handicapés et défavorisés de toutes sortes, il
n'hésita pas à apporter son aide et devint par le fait même un genre de
travailleur social, bénévole. Il ne savait pas qu'un jour, lorsque les CLSC
feraient leur apparition, qu'il y aurait un besoin pour un travailleur
social auprès des handicapés, et qu'on aurait recours à ses services. On lui
expliqua, à sa grande surprise, qu'il était un des seuls dans la région qui
possédait 25 ans d'expérience dans ce domaine. Depuis 25 ans vous ne faites
que cela M. Thibault, lui a-t-on dit, il est temps qu'on vous rémunère un
peu.
Bien sûr Omer avait acquis l'expérience de la vie, il
s'était intéressé, il avait lu. Il s'était instruit, particulièrement en
côtoyant Gérard Ouellet; source de connaissances inépuisables. Lorsque Gérard Ouellet se présenta candidat créditiste dans le comté de Rimouski,
l'ex-organisateur créditiste accompagna son candidat. Ils remportèrent deux
élections. Omer avait enfin surmonté la défaite. Il avait savouré la
victoire de son meilleur ami; c'était aussi la sienne. Omer, armé de toutes
ses expériences devint un homme respecté, juste, compréhensif et disponible.
Je ne peux que dire bravo à cet homme sans ressources qui a su durant toutes
ces années se mettre au service des siens.
Les pionniers de l'aviation.
Même si la deuxième guerre mondiale avait permis de
développer les réactés, (qu’on appelait, avions à réaction) il n'en demeure
pas moins que les jeunes mordus de l'aviation de ce temps-là, comme ceux
d'aujourd'hui, devaient apprendre à piloter sur de petits avions monomoteur,
semblable à ceux que l'on voit de nos jours, mais beaucoup moins
perfectionnés. Mathieu Dionne (fils d'Edmond) était un de ces mordus. Il
aimait l'altitude. On le voyait souvent grimper sur la maison ou sur la
grange, il s'asseyait sur le toit, regardait haut et loin. Il était dans son
élément préféré. Alors qu'il était encore jeune, il alla travailler à
Rimouski pour son oncle Albert, qui était concessionnaire Ford.
Celui-ci possédait
deux avions et je crois l'école de pilotage. Mathieu ne tarda pas à suivre
des cours de pilotage même si cela devait lui grever une grande partie de
ses revenus. (Albert mourut en février 2001 à 95 ans 8 mois. Il avait été un
des co-fondateurs de Québec Air. Il a touché à tout ce qui s’appelait des
affaires à Rimouski. Il fut le plus grand homme d’affaires de cette ville
après Jules Brillant ).
Quand il eut la permission de voler en solo, il
s'empressa de venir montrer à la population de St-Mathieu son savoir-faire.
C'était l'hiver, et en plus de faire très froid, il faisait un vent de
l'ouest violent et glacial. Pendant que son père finissait de déblayer une
piste improvisée sur le lac, Mathieu volait autour du village; question de
piquer la curiosité du monde qui devinerait que c'était lui qui était aux
commandes. Il savait que tous ces curieux le surveilleraient dans ses
manœuvres d'atterrissage sur la glace. Lorsque son père lui fit signe que la
piste était prête, il entreprit sa descente, nez dans le vent, obéissant à
toutes les autres normes de sécurité qu'on lui avait enseignées. Mais
quelque chose ne s'est pas passé comme dans le livre, ou comme sur un vrai
aéroport, où l'on peut bénéficier des bons conseils des contrôleurs aériens,
qui informent le pilote sur la vitesse des vents, leurs directions et autres
informations parfois très utiles. Spécialement lorsqu'on n'a pas encore
acquis beaucoup d'expérience pratique, et qu’on s’aventure sur une piste
improvisée. Le vent ou le froid a déjoué ses calculs, et il heurta la glace
violemment, glissa de côté dans le banc de neige, piqua du nez et brisa
l'hélice de bois dont étaient munis ces petits modèles. Quelqu'un attela un
cheval et conduisit Mathieu vers le plus proche téléphone, probablement chez
son oncle Charles de l'autre côté du lac. Il communiqua avec quelqu'un à
Rimouski, et à peine une heure plus tard, on vit arriver un autre petit
avion qui lui, atterrit en douceur sur cette piste improvisée que Edmond
avait rélargi pour assurer une plus grande sécurité.
Le pilote d'expérience sortit, suivi d'un mécanicien muni
d'une nouvelle hélice et des outils nécessaires à l'opération. Soudainement
les deux avions repartirent avec le pilote d'expérience dans la position du
leader. Ils prirent quelques centaines de pieds d'altitude et nous firent
trois pirouettes consécutives; bien synchronisées et bien réussies. Lorsque
à notre grande surprise ils ont commencé à effectuer leurs tonneaux, nous
croyions qu'ils avaient perdu le contrôle et qu'ils allaient piquer du nez
directement dans le lac. Mon cœur a manqué quelques battements et j'ai senti
mes jambes qui me piquaient et qui voulaient me laisser tomber. J'ai eu
l'impression, qu'ils avaient fait exprès pour nous donner ces sensations, et
qu'ils connaissaient exactement notre réaction; riant bien de notre méprise.
Mais c'est sûrement le contraire. Ces manœuvres demandent une très grande
concentration, et le moindre égarement peut être fatal. Pour eux c'était
aussi, le spectacle, la bravoure et l'entraînement.
Ces jeunes aventuriers aimaient le risque, ils ne
connaissaient pas la peur. Les autres passaient leur folle jeunesse en
automobiles, accomplissaient toutes sortes de prouesses et accumulaient les
accidents, mais eux; c'était dans le ciel qu'ils s'amusaient. Mais, le ciel
n'est pas toujours sans risques. Un certain Jacques Fortin que je connus à
l'aéroport de l'Ancienne-Lorette lorsque j'y travaillais, avait vu son
permis de pilote suspendu à vie pour avoir fait des tas de bêtises comme de
passer sous les ponts ou de passer entre les deux clochers de la cathédrale
de Rimouski durant la grand-messe, ou prendre toutes sortes de risques que
Transport Canada ne tolère pas.
Presque tous les fils de Nazaire Lemelin (ancien
propriétaire des autobus Lemelin) ont fini par se tuer dans des accidents
stupides, en prenant des risques inutiles, pour impressionner le monde
lorsqu'ils jouaient aux grand seigneurs avec l'argent de leur père. L’argent
qui achetait tous les luxes; boisson, femmes, etc.; tout, excepté la vie. Le
seul qui s'en tira fut Raymond que j'ai eu le plaisir (ou l’occasion) de
connaître lorsqu'il était devenu fauché, après que sa mère Crécence eut
décidé de lui couper les vivres;
ceci, suite à l'abandon de sa femme et de
ses deux garçons. Il dut ensuite travailler comme portier dans un hôtel de
Miami afin d'assurer sa maigre subsistance. Mathieu Dionne a lui aussi vu
son permis suspendu pour quelques années. Il dut se contenter de
piloter
des autobus de Nazaire Lemelin, le père de ses amis. Ces quelques années
passées à trimer dur et à réfléchir lui ont permis de reconquérir son permis
et de faire une belle carrière de presque quarante ans avec Québecair. Il
fut premier officier, capitaine, chef-pilote et instructeur. Les Paul
Lapointe, Mike Beaudoin sont morts jeunes, mais de causes naturelles. Hubert
Larin est toujours dans les airs en 1993. Lorsque Québecair termina ses
opérations, Hubert dut aller piloter pour de petites compagnies en attendant
de trouver autre chose. Lorsque Air Alliance démarra, il fut celui qui
organisa toute la structure des opérations de vol et des pilotes; à titre de
Vice-Président de ce département. En 1993 il s'est joint à l'équipe d'Air
Transat, ses anciens compagnons de cabine à Québecair. Je l'ai perdu de vue
depuis.
Lorsque Mathieu Dionne recouvra son permis, il pilota de
petits avions qui appartenaient je crois à Rimouski Air Services (l'ancêtre
de Québecair). Cette compagnie qui avait vu le jour grâce à l'obtention de
contrats pour approvisionner les compagnies et les travailleurs dans le
grand nord. Il faut se rappeler que c'était durant la construction de ce
qu'on appelait; le Dew-Line. Ce Dew-line qui s'étendait presque à la
longueur du Canada près du pôle nord était à l'époque, le plus grand et le
plus moderne des réseaux de communications-radar pouvant acheminer les
communications par Morse, radio ou téléphone entre le Canada, les
États-Unis, l'Europe et même la Russie. Vingt-cinq ans plus tard, grâce à
l'arrivée des satellites et des ordinateurs, ce système devint aussi désuet
et archaïque que la corne à caller l'orignal. Mathieu m'a souvent
raconté des anecdotes de ces années de pilotage dans la brousse et dans le
nord qu'il semblait se souvenir comme des plus belles années de sa vie. Je
crois que ce qu'il avait apprécié le plus, c'était le contrat de livraison
du courrier sur la Côte nord. A cette époque, il n'y avait aucune route qui
reliait les paroisses de la Côte nord depuis Baie-Comeau jusqu'à
Blanc Sablon. On acheminait les sacs de courrier depuis Rimouski, avec un
avion C46 ou DC3, vers Baie-Comeau ou Sept-Îles; qui avaient été dotées de
pistes d'atterrissage rudimentaires, (faites de gravier compacté) pouvant
accueillir ces types de transport aérien. C'est à partir de ces points
névralgiques que de plus petits avions, dont un de ceux-là, piloté par
Mathieu, allaient livrer le courrier aux différents bureaux de postes de la
basse Côte nord. Mathieu me racontait de quelle façon on devait procéder
alors. Il était impossible d'atterrir et les sacs ne pouvaient pas être
parachutés. On devait ralentir au maximum, et descendre le plus prêt
possible du sol ou de la neige, un assistant laissait tomber le sac au sol,
le plus prêt possible de l'objectif, soit, le bureau de poste. Mathieu me
disait que son assistant laissait aller le sac seulement lorsqu'il lui
criait GO! Ils devinrent tellement habiles à cette manœuvre qu'il leur est
arrivé souvent de tirer le sac directement dans la fenêtre, au grand
désespoir du maître de poste, qui devrait encore une fois réparer les
dégâts. On était jeune, tout devenait partie de plaisir, et même si on
gelait dans ces avions non chauffés, c'était cela l'aviation, on ne
connaissait pas mieux et on n’était pas encore arrivés à l'âge où on cherche
le confort. Notre seul but était de voler, qu'importent les conditions, nous
disait Mathieu, relatant ces souvenirs en affichant ce sourire encore
nostalgique des années de folle jeunesse.
A cause de Mathieu, j'admire tous ces pionniers de
l'aviation qui ont su faire voler des avions désuets, sans équipement de
communications adéquat, ni de radar; souvent surchargés, devant atterrir sur
des pistes improvisées: sur des banquises de glace au Pôle nord ou sur des
bancs de sable sur la basse Côte nord. Ils devaient faire leurs plans de
vols sur des routes imaginaires et ensuite suivre rivières et lacs sur des
milliers de kilomètres; guidés par la boussole ou le soleil. Nombre d'entre
eux se sont perdus et n’ont jamais été retrouvés, dont certains d'entre eux
faisaient partie de mes connaissances et même de mes amis. Au moment où j'ai
commencé à connaître l'aviation, déjà, les équipements avaient été améliorés
et les communications radio et radar étaient beaucoup plus fiables. Malgré
tout, les travailleurs qui se sont isolés au Pôle nord et dans les terres de
Baffin ont pu manger, se vêtir, recevoir périodiquement les nouvelles de la
civilisation, les lettres de leurs familles, de leurs amis, et de leurs
amours; grâce à ces pionniers de l'aviation pour qui la conquête du ciel
était leur seul but.
L'industrie du bois
Vivre du bois,
Bûcher pour vivre,
Bûcher pour se chauffer,
Bûcher pour sa vie,
Vivre pour bûcher.
Note: Un des très importants acteurs de
l'industrie du bois à St-Mathieu, Réal Dionne est décédé le 4 mai 2005 à
Québec, âgé de 91 ans.
De tous les habitants de cette partie du bas St-Laurent,
la plupart étaient cultivateurs. De tous les cultivateurs de cette partie du
Bas St-Laurent, la plupart étaient bûcherons. Cultivateurs ou bûcherons, on
se devait de pratiquer les deux métiers sans quoi il était impossible de
faire vivre ces très grandes familles de l'époque. Si on ne possédait pas sa
propre terre, on bûchait pour le compte des Dionne et Dionne l'hiver et,
l'été on travaillait dans leurs scieries. Les cultivateurs qui n'avaient pas
de bois de sciage sur leur ferme devaient eux aussi bûcher pour les Dionne
l'hiver. Les autres, comme c'était le cas pour mon père et pour Omer,
coupaient du bois de sciage sur leurs terres; sapin et épinette, qu'ils
vendaient à Désiré Dionne, parfois à d'autres Dionne.
Le problème, pour ces cultivateurs, était le temps qu'il
fallait donner à la nouvelle repousse avant qu’elle n’atteigne encore une
fois sa maturité. Même si la plupart des terres étaient composées de vingt
pour cent de terre cultivée et de quatre-vingt pour cent de bois, la terre à
bois n'était jamais assez grande pour fournir en bois de sciage, un
habitant durant toute sa vie. Je me souviens que mon père avait bûché
une belle tale de sapin qui avait été bûchée par Félix Rioux environ trente
ans plus tôt. Étant donné l'endroit favorable à une repousse rapide (au pied
de la côte du dos de cheval, côté sud, jouissant de beaucoup de soleil et
d'humidité du sol) le bois était déjà de dimensions minimales et était prêt
à être coupé par un gars qui savait qu'il allait vendre sa terre très
prochainement. Il était évident qu'il n'avait pas l'intention de continuer à
protéger ses réserves pour l'avenir.
A cause des difficultés de renouvellement de la ressource
de bois de sciage, nombreux furent ceux qui durent se lancer, non sans
réticences, dans la coupe de bois de chauffage. Beaucoup moins rémunératrice
que le bois de sciage, cette ressource de bois franc de très haute qualité,
érables et hêtres en particulier, était presque inépuisable. Bien sûr, on
allait toujours couper du bois de chauffage. Il en fallait environ quinze
cordes par année pour le poêle de cuisine et environ dix cordes pour
chauffer la fournaise l'hiver. De plus, chaque habitant catholique devait
fournir quelques cordes pour chauffer l'église et le presbytère, cela
faisait partie de la dîme. Je crois me souvenir aussi qu'après l'arrivée du
curé Bérubé (vers 1948) chacun payait sa dîme
en argent et la Fabrique achetait ce dont elle avait besoin. Elle nous avait
acheté du bois de chauffage dans les années où mon père et Omer en furent de
gros producteurs.
L'évaporateur de la cabane à sucre en consommait
lui aussi; au moins trente cordes par printemps. De beaux quartiers de bois
bien sains qu'on avait coupés le printemps précédent et mis à sécher sous un
toit sans murs autour, afin d'obtenir une qualité de séchage efficace et un
bois de chauffage de première qualité.
Ces différents travaux faisaient partie d'un rituel qui
se répétait chaque année et à chaque saison. Tous les automnes, après les
travaux de la ferme terminés, on abattait les arbres et les coupaient en
billots de 10 pieds de long ou à peu près, selon la grosseur de l'arbre et
de sa forme, et de la capacité des hommes de les manœuvrer; on les mettait
ensuite en piles. Plus tard on battait des chemins pour le charroyage
de ce bois qu'on aménagerait en grosses piles plus près des bâtiments. En
février, on faisait des corvées de sciage. A l'aide d'un gros banc de scie
qu'on appelait un butter, on coupait les billes en bouts de 14, 18 ou
24 pouces selon les différents besoins et goûts. Lorsque l'on finissait chez
l'un, on déménageait le tout; butter et engin ainsi que les hommes
vers la prochaine pile de billots, qui très vite se confondait en billes de
bois de chauffage; prêtes à être fendues en quartiers, cordées, idéalement à
l'abri, assurant ainsi une plus grande qualité de chauffage. Bientôt le
temps des sucres annonçait la renaissance de la nature, que le printemps
prendrait soin d'apprivoiser, avant de la céder aux douceurs de l'été.
Lorsqu'il s'agit de couper du bois de chauffage en grande
quantité destinée à la vente; cela devient une entreprise commerciale.
Siméon, Omer et mon père, étaient les trois compères frères/partenaires,
dans cette grande entreprise. Siméon, ne possédant pas de terre boisée
recevait un salaire. Omer et papa coupaient des quantités de bois
équivalentes sur leurs terrains respectifs. On transportait les billots en
hiver dans un endroit qui se prêtait bien au stockage de grandes quantités
de bois; sur un terrain où il serait facile de scier, fendre et corder le
bois ainsi transformé. Un terrain qui également serait accessible au
transport par camions vers les éventuels clients, dont la plupart résidait
au Bic ou à Rimouski.
Il fallait trouver un terrain assez plat, permettant
l'installation des équipements de sciage; banc de scie et engin
stationnaire, fendeuse mécanique; ce qui n'était pas très facile à trouver
sur ces terres montagneuses au cœur des Appalaches. Cette fendeuse mécanique
mérite qu'on lui prête un peu d'attention. Il s'agissait d'une machine de
très grande envergure, qui devait peser quelques tonnes. Elle était montée
sur un châssis de métal d'environ huit pieds carrés sur six pieds de haut.
Une roue d'air d'environ quatre pieds de diamètre et lourde de six ou sept
cent livres était fixée sur son châssis. Une grosse hache était fixée
au bout d'un bras entraîné par un axe pivotant
autour du moyeu. Lorsque la hache
frappait la bille, placée sur une petite table par un des hommes, elle la
sectionnait en deux, sans regard au fait qu'elle ait été facile ou difficile
à fendre par un homme muni d'une hache. Cette roue ne tournait pas très
vite, mais quand même. Cette opération était très dangereuse pour
l'opérateur, qui aurait pu être frappé à mort par l'éclatement d'une bûche
ou encore, il aurait pu avoir les mains coupées par la hache au moindre
moment d'inattention. Je me souviens que, pour ces raisons, on ne s'en
servait qu'au strict minimum; c'est-à-dire, seulement pour les bûches qui
semblaient trop difficiles à fendre selon la méthode conventionnelle. Et
finalement, un homme habile avec sa hache accomplissait beaucoup plus de
travail que celui qui s'obstinait à utiliser indûment la machine.
aujourd'hui, on utilise un levier hydraulique contrôlé par l'opérateur,
c'est plus lent et sûr, et presque sans danger.
Après quelques recherches on avait enfin trouvé l'endroit
idéal; assez plat pour travailler à son aise.
Un endroit sec et desservi par
une voie carrossable pour camions. Quand j'ai revu, trente ans plus tard cet
endroit, j'ai été très surpris de constater que ce terrain plat constituait
une pente d'au moins dix degrés. Il faut croire que lorsqu’on a l'habitude
de vivre en montagnes, on ne voit pas de la même façon et, ce qu'on appelle
normalement un terrain plat, n'a plus la même signification.
Ce fut un gros chantier de trois cent cordes de bois de
chauffage. Combien de fois ont-ils aiguisé les lames des sciottes? Combien
de coups de scie ont-ils donné? Combien de fois ont-ils manipulé ces billots
et bûches coupés en huit pieds? Combien de fois les a-t-on portés sur la
pile, repris sur la pile, chargés sur la sleigh, repris sur la
sleigh, replacés sur une autre pile, repris sur l’autre pile, montés sur
le banc de scie, repris en bûches sur le banc de scie, tirés à bout de bras
sur le tas, repris de sur le tas, placés sur la fendeuse, tirés sur un autre
tas, repris et cordés pour faire sécher, de nouveau repris et chargés dans
le camion pour la livraison, déchargés chez le client en ville? Ouf! Fin des
opérations! Quelles tâches devaient accomplir ces hommes qui ont précédé la
mécanisation des temps modernes!
Ce chantier a duré deux ans, juste avant notre départ de
St-Mathieu. Ce n'était pas aussi rémunérateur que le bois de sciage, mais
cela assurait des revenus d'une ressource qui autrement se perdait et,
c'était mieux que d'aller travailler dans les chantiers des Dionne.
Spécialement pour des types aussi indépendants et autonomes
que l'étaient mon père et ses frères. On était son
propre patron et on vivait chez-soi, ce qui permettait de s'acquitter des
tâches journalières; à la grange en particulier, plutôt que de devoir
laisser à la femme et aux enfants ces responsabilités lorsqu’on devait
travailler au loin.
Le temps et les efforts étaient calculés selon leurs
propres critères. Les muscles bien entraînés et les chevaux effectuaient
tout le travail. Ces hommes étaient en excellente forme physique. Ils
mangeaient beaucoup de nourriture lourde, grasse, qui soutenait l’estomac de
l’homme dépensant énormément d'énergie. Il n'était pas rare de voir ces
hommes, le soir venu, parcourir à pieds quelques milles pour aller patiner
ou même jouer au hockey. Car même si on trimait dur, il fallait se divertir.
Ces hommes dormaient paisiblement, d'un sommeil doux et réparateur; se
levaient le lendemain à la barre du jour, prêts à recommencer un autre jour
de dur labeur.
Les trois compères étaient ce qu'on appelait de bons
bûcheux. Ils aimaient cela, et ils s'encourageaient tellement chaque
jour, qu'ils ne voyaient passer ni les jours ni le temps. Mon père qui
souffrait d'un ulcère à l’estomac depuis l'adolescence n'éprouvait plus
aucun trouble digestif dès qu'il entrait dans la forêt avec sa hache et son
sciotte. Ceci me fut confirmé par Omer trente ans plus tard lorsque je lui
demandai comment mon père pouvait accomplir des tâches aussi dures, sans
ressentir les malaises causés par cet ulcère qui le faisait tant souffrir?
Omer me dit que dès que Donat mettait les pieds dans le bois pour bûcher, il
mangeait de la viande et des beans et, ne se plaignait d'aucun
malaise. C'est là que j'ai compris que ce n'est pas ce que l'on mange qui
affecte notre système mais bien plutôt les soucis et le stress avec lesquels
l'esprit nourrit les différentes composantes du corps.
Les inventions de Jean-Baptiste Jean
Jean-Baptiste lui, s'était fabriqué des moulins à vent
(éoliennes) à l'aide de générateurs d'automobile, auxquels il fixait une
hélice de bois qu'il fabriquait lui-même. Lorsque le vent activait l'hélice,
la génératrice procurait l'éclairage électrique grâce à quelques faibles
ampoules 40 watts.
Ce n'est que vers 1950 que les rangs des campagnes ont
été dotés de l'électricité en vertu d'un programme du gouvernement de
Duplessis, qui couvrait les régions du bas du fleuve, de la Matapédia et de
la Gaspésie, entre autres. Jean-Baptiste fixait sa génératrice au bout d'un
pylône solidement ancré au pignon du toit de la maison. Ce système
comprenait son propre contrôle de la vitesse de l'hélice ; contrôle
obligatoire, particulièrement lors de grands vents. La génératrice était
montée sur un cadre métallique au moyen d'un axe central, et était retenue
en position par un ressort dont on pouvait ajuster la tension de façon à
permettre à l'hélice, lorsqu'elle atteignait une vitesse donnée, de se
cambrer à l'horizontale. Lorsqu'elle avait diminué de régime, et qu’elle
était redevenue en position verticale, elle recommençait son accélération
jusqu'à ce qu'elle bascule encore, et encore.
Nous aussi, nous nous sommes éclairés durant quelques
années avec un tel système. C'est pourquoi je me souviens bien du mécanisme,
car il est arrivé souvent que papa ait dû y faire soit des réparations soit
des ajustements; avec l'aide du grand curieux que j'étais qui ne manquait
pas de vérifier tous les détails.
Il fallait de bons nerfs pour réussir à dormir par les
nuits de grands vents qui faisaient basculer le système à toute minute.
Lorsque l'hélice changeait de position, elle faisait un bruit exactement
comme l'hélice d'un avion lorsque l'on change soudainement l'angle des
palles (pitch) pour l'arrêter rapidement. En plus de produire ce bruit, ce
changement de direction de l'hélice provoquait une vibration qui se
transmettait à toute la maison; on eut cru à chaque fois que le toit venait
de s'envoler. Mais non ; fra,fra,fra de nouveau et bang, le mécanisme
retournait en place et le même manège recommençait. Les non habitués qui
venaient nous visiter avaient, chaque fois qu'il ventait, une peur bleue.
Ils devenaient blancs comme du lait ou rouges comme des tomates mûres et
parfois verts comme des tomates pas mûres, et nous dans notre escalier, on
avait toujours notre fou rire de les voir.
Jean-Baptiste avait remplacé cette éolienne par un
système de grande roue à aubes aménagées dans un ruisseau tout au bord, de
ce qu'on appelait la coulée; là, où le ruisseau devenait écluse, et se
tournait même en chute lors des grandes crues. Ce ruisseau qui prenait sa
source au pied de la colline à quelques arpents au sud de la maison coulait
presque à l'année. Cette source, en plus de nous fournir l'eau courante à
l'aide de gros tuyaux en bois, nous servait d'endroit frais où l'on pouvait
conserver les bidons de crème et de lait durant l'été. Cette source était
recouverte d’un toit sur quatre murs. Une portière à l’avant donnait accès à
l’intérieur.
Ce ruisseau longeait le chemin d’accès à la maison, il
bifurquait à l'ouest autour du jardin à environ cent pieds en face de la
maison, pour retourner vers le nord, à mi-chemin entre la grange et la
maison. Il déversait brusquement dans cette côte effroyable, aussi abrupte
que ces toits de chalets de montagne tout en hauteur. C'est à ce point
précis, que Jean-Baptiste y avait agenouillé une cabane sur pilotis à
quelques pieds dans la descente, en y aménageant des bras d'appui sur le
terrain plat juste au-dessus dans la posture d'un homme qui s'agrippe au
bord d’un précipice d'où il vient de perdre pied.
L'eau entraînait la roue, qui elle à son tour, entraînait
la génératrice qui fabriquait l'électricité, et l'accumulait dans les
batteries conçues à cette fin. Il s'agissait d'un bon système, mais à cause
de la pauvreté des matériaux, (seul le bois avait été utilisé même là où il
aurait fallu une bonne base de béton bien ancrée sur le roc, pour supporter
le mécanisme et son abri), le temps, le vent, la neige et les glaces ont
vite fait d’anéantir cette installation qui devait s'écrouler pour ne jamais
être reconstruite. Je crois que c'est à peu près à ce moment que papa acheta
la terre.
Que sont devenus ces gens (Jean)?
Jean-Baptiste, à l'instar de bien d'autres cultivateurs
qui en avaient assez de ces terres impropres à l'agriculture, avait cherché
une plus belle terre quelque part, afin d'améliorer son sort. Et, c'est à
St-Anaclet, à quelques milles de Rimouski, qu'il avait trouvé ce qu'il
désirait. Plus tard, ce fut au tour de Cyprien Desjardins de trouver une
plus belle terre, c’est à St-Léon le Grand qu’il trouva la perle. Quelques
années plus tard, ce furent les Ouellet, Mathieu, Réal, Omer, et aussi mon
père, qui trouvèrent en Abitibi et à Beaumont. Les Romuald Rioux et Omer
Thibault trouvèrent des emplois et optèrent pour la vente pure et simple de
leurs terres. Romuald Jean, frère de Jean-Baptiste, nous avait vendu sa
terre du sud du lac et était allé travailler à Rimouski. Fortunat, autre
frère, avait vendu à Omer Thibault et était allé ouvrir son garage à
St-Simon. Beaucoup d'autres manquaient de courage pour apporter des
changements radicaux dans leur vie; la peur d'affronter les risques étant
toujours présents. Ils ont continué leur petit train-train jusqu'à ce qu'ils
finissent par abandonner l’agriculture.
Jean-Baptiste était parti et, les communications étant ce
qu'elles étaient dans ce temps-là, on n’a plus jamais entendu parler de lui.
C’est en 1960 lorsque je résidais à Sept-Iles et demeurais chez un jeune
couple avec qui je m’étais lié d’amitié, que j’eus des nouvelles d’eux. Jean
Hudon venait de St-Marcelin, et Brigitte, de St-Anaclet; une paroisse qui
avait également hérité vers 1950 de notre curé Bérubé, tellement apprécié de
tous durant son séjour à St-Mathieu. Et pour cause! Il avait été le sauveur
qui avait remplacé le très bizarre et controversé curé Charles Pelletier.
(Pédophile expulsé de la paroisse par Mgr. Courchesne, à la demande d’un
groupe de citoyens dont faisait partie mon père.) L'Abbé Bérubé, plus jeune,
dynamique, progressiste, de personnalité chaleureuse et attachante était
tout ce que le curé Pelletier n'était pas. De ce fait même, par sa seule
personnalité, il avait apporté à la population de cette petite paroisse un
changement bien mérité. Il avait vite conquis ses commettants leur offrant
amitié et respect. Aimant le progrès et prônant la valeur des sports comme
divertissement pour les jeunes, il avait réussi à convaincre, même les
moins jeunes, (je me souviens que c'était son expression) de lui prêter main
forte pour organiser des loisirs qui aideraient à éviter la délinquance chez
les jeunes; ce problème qui semble exister depuis toujours.
Brigitte qui connaissait très bien la famille de
Jean-Baptiste a pu me renseigner sur la destinée de chacun d'eux; à mon
grand plaisir. Elle m'a souvent parlé aussi de notre regretté curé Bérubé
avec autant de bien et d'éloges que j'en imaginais de lui, même si mes
souvenirs étaient déjà lointains. Je vais continuer de parler plus
longuement de ce curé qui a su personnifier l'individu qui, tout en étant et
en demeurant un professionnel de son métier, sa carrière ou sa vocation,
réussi à oeuvrer bien au-delà du cadre des fonctions qui lui étaient
assignées; s'imposant ainsi comme un modèle qui, de par son dévouement,
change la vie de la communauté qui l'entoure.
Durant les quelques années qu'il résida à St-Mathieu, un
grand couvent, où on dispensait les cours jusqu'à la neuvième année fut
construit; sans doute avec l'aide de subventions gouvernementales. On se
souvient de ce bon vieux temps où le curé, et le maire, assistés de
l'organisateur du parti, étaient les personnages les plus puissants de la
paroisse. Au niveau gouvernemental, les commissions scolaires relevaient du
Ministère de l'Instruction Publique dont le contrôle
avait été laissé au clergé et, la municipalité, du Ministère des
Affaires Municipales. Les subventions et le patronage venaient de ces même
Ministères, et la coordination de ces projets tombaient sous la
juridiction de ces quelques dirigeants. On se souvient que Duplessis ne
refusait presque jamais de construire couvents et écoles, s'appropriant
ainsi les votes du clergé et des communautés religieuses, et, de tout ce bon
monde influencé par ces réalisations. Une patinoire extérieure avait été
érigée derrière le couvent, donc en avant de l'écurie où on laissait les
chevaux quand on allait à l'église. Le soir, les gens de tous âges allaient
patiner et le dimanche après-midi on y discutait des parties de hockey
contre des équipes venant d'autres paroisses. Un court de tennis avait été
aménagé à l'est du presbytère près de la petite grange qui servait jadis à
abriter le cheval du curé. Mais à ma connaissance l'abbé Bérubé avait
discontinué cette pratique; il ne gardait plus de vache non plu. A cette
époque, les cultivateurs livraient le lait de porte en porte, il n’était
donc plus nécessaire pour le curé de garder des vaches. D'autres projets ont
sûrement été réalisés mais comme nous sommes partis de St-Mathieu en 1951,
je n'en fus pas témoin.
Je garderai toujours en moi le souvenir de ce prêtre qui
n'osait pas encore porter le pantalon au lieu de cette encombrante soutane
noire, ç’aurait été mal vu, cette tolérance n’arriva que quelques années
plus tard. C'est avec plaisir que je lui rends hommage. Sa ressemblance
physique, je m'en suis toujours souvenue, à cause de sa ressemblance à Paul
Leclerc de St-Charles. Même visage rouge, cheveux lisses, taille mince et
élancée.
Les corvées
La fin de l'automne et les mois d’hiver donnaient lieu à
des corvées où, tout le monde se transportait d'un voisin à l'autre, pour
effectuer certains travaux impossibles à accomplir par un homme seul. Dès le
début du temps de l'Avent on commençait les boucheries. Chaque famille avait
engraissé une bête à cornes et un lard, pour les besoins en viande de la
famille, pour une partie de l'année. Pour certains, le reste des besoins en
nourriture, était comblé par les résultats de la chasse. C`était le cas des
Rousseau. Les équipements d'abattage étaient très rudimentaires: quelques
couteaux aiguisés sur la meule à l'eau, une hache pour assommer l'animal, et
une scie quelconque pour débiter la carcasse en quartiers. Un palan fixé à
une poutre du fenil pour pendre l'animal abattu pour l'éloigner les chats,
chiens et autres possibles carnivores sauvages, qui sentent la chair de
loin. La plupart des habitants étaient chasseurs, et avaient l'habitude
d'abattre et de débiter un animal sauvage en pleine forêt. Pour eux
l'abattage d'animaux domestiques n'était pas plus compliqué, et ne créait
aucun souci. Rien n’empêche que je me souviens de quelques aventures plutôt
pittoresques quand on y repense.
Un automne, assez tôt, bien avant les neiges, Pit
Desjardins demande à mon père de l'aider à abattre un bœuf. Mais comme ni
l'un ni l'autre n'était chasseur, ils laissaient normalement les autres plus
expérimentés se charger du travail d’abattage, mais quand on est seul, on ne
peut faire confiance qu’à soi-même. Même en doutant de leurs capacités de se
débrouiller par eux-mêmes, ils décidèrent de se lancer dans l’aventure. Ils
amenèrent le bœufprès de la grange,
mais ni l’un ni l’autre ne savaient exactement comment
assommer un animal pour le saigner. L’un d'eux y alla d'un coup de masse
beaucoup trop fort, probablement qu'il défonça le crâne,
et l'animal
ne fléchit pas les genoux. Au contraire, le bœuf sentant l'ennemi lui faire
du mal, se fâcha et prit la fuite en voulant abattre de ses cornes tout ce
qui faisait obstacle sur son chemin, spécialement les humains. Nous, les
enfants, avons eu très peur et nous nous sommes placés dans un endroit
sécuritaire pendant que nos pères tentaient de re-capturer l'animal
incontrôlable. Les deux bouchers amateurs se consultèrent et en vinrent vite
à la conclusion que la seule solution était d'aller chercher un fusil, de se
placer le plus très possible de l'endroit de travail, d'approcher l'animal
qui ne demandait pas mieux que de foncer sur ses deux bourreaux et, de tirer
au moment le plus propice. (N’étant pas chasseurs, ils étaient tous deux
plutôt malhabiles avec le maniement des armes) L'animal s'effondrerait sans
plus de dégâts et, l'aventure serait passée. Je me souviens avoir entendu le
coup de fusil et vu l'animal butter sur ses genoux, la situation redevint
normale. Je ne me souviens que très vaguement du reste. Alors que plus rien
d'excitant n'était susceptible d'arriver, nous sommes retournés à nos jeux.
Pour le reste, les boucheries se passaient assez bien
pour les hommes. Mais pour les femmes il en était tout autrement. Car même
si déjà elles avaient à s'occuper de nombreux enfants, d'aller aider à la
grange soir et matin; il leur fallait en plus donner à dîner à ces hommes
qui s'entraidaient. La vraie corvée, c'est la femme qui la subissait; une
corvée longue, dure et solitaire. Personne ne venait l'aider à l'exception
des enfants lorsqu'ils arrivaient de l'école. C’est à elle aussi que
revenait la tâche la plus ingrate; celle de dégraisser les ventres de
cochons pour en retirer la panne, qui plus tard servirait de graisse pour la
cuisson. Elle devait aussi faire cuire ou congeler le sang pour le conserver
avant de le convertir en boudin. Et finalement, elle devait aussi découper
les morceaux de viande pour les envelopper et les faire congeler jusqu'au
printemps. Ou bien en faire cuire certaines parties, en mettre d’autre en
conserve, afin d'en assurer la conservation durant l'été.
Comment s'y prenait-on pour faire ces conserves de
viande? Les poêles à bois étaient munis d'une bouilloire qui avait la
capacité d'amener l'eau à ébullition si on chauffait très fort. Nous avions
aussi de gros boillers en zinc que nous mettions sur le poêle pour
faire bouillir l'eau. Après avoir rempli les pots de verre Mason, de
viande que l'on avait fait cuire au four, on les plaçait dans ces contenants
d'eau bouillante pour la stérilisation. Le poêle surchauffé rendait la
maison inconfortable et devenait lui-même un danger pour le feu;
spécialement les feux de cheminée; ce qui énervait ma mère et la gardait sur
le qui-vive.
Les parties de porc qui étaient destinées à devenir du
lard salé étaient coupées en briques d'environ quatre pouces carrés et
étaient conservées dans une saumure à l'intérieur de barils de chêne. Les
caves des maisons n'étaient pas chauffées ou l’étaient très peu, et les
planchers étaient de terre durcie assurant une humidité et une fraîcheur
constantes; favorables pour la conservation des aliments, spécialement les
fruits et légumes. Les carottes et les navets étaient conservés eux aussi
dans ces barils qu'on avait remplis de sable. Les autres légumes étaient eux
aussi mis en pots avant que ne débutent les saisons plus chaudes. Lorsqu'on
retirait un morceau de lard salé de la saumure, il était bien mariné et bien
conservé, même sans avoir été cuit auparavant, ceci grâce aux grandes
qualités de conservation du sel. On le mangeait de différentes façons. Très
souvent on le coupait en petites tranches qu'on faisait frire dans la poêle
jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes. On les dégustait alors pour
accompagner le petit déjeuner (après avoir passé plus d'une heure à la
grange), mais, c'est surtout pour rehausser la saveur des beans et
des patates fricassées qu’on les appréciait. Oh, quel délice! On les
appelait, grillades de lard; nom que je préfère de beaucoup à celui que
certaines personnes leur donne aujourd'hui, des oreilles de Christ,
ça semble vulgaire et sans saveur en comparaison. Elles ressemblaient un peu
aux tranches de bacon que l'on achète aujourd'hui, mais elles étaient
combien plus succulentes! un festin d'antan! Et quelle joie de constater que
malgré tout, ces gens à qui la grande crise économique avait tout pris
excepté la misère, avaient su, dans ces temps difficiles user d'imagination
pour se nourrir convenablement et à moindre frais. D'ailleurs j'ai eu
l'occasion d'en savourer d'excellentes chez la tante Germaine au retour d’un
évènement que j’ai oublié; maman m'accompagnait. La tante Germaine s'était
préparée depuis longtemps pour nous offrir ce festin, dont elle savait que
personne n'avait goûté depuis au moins vingt ans. Des patates fricassées
autour d'un oeuf, au centre d'une assiette bordée de grillades de lard,
accompagnées de pain de ménage bien frais, encore chaud, qui répandait dans
la maison cet arôme qui redevient présent dans notre souvenir, chaque fois
qu'on y repense. Quel rare festin pour nous ramener ces
beaux souvenirs d'enfance! Et quelle joie de constater que
malgré tout, ces gens à qui la grande crise économique avait tout pris
excepté la misère, avaient su, dans ces temps difficiles user d'imagination
pour se nourrir convenablement et à moindre frais.
C'est toujours avec un brin de nostalgie que l'on se
remémore le bon vieux temps. Mais à bien y penser; qu'y avait-il de si bon?
Sinon le fait de vivre dans un monde moins stressé, moins pressé par la
rapidité de la vie des villes. Un monde où la discipline et la foi
religieuse remplaçaient les psychiatres et les médecins. Le bon vieux temps,
pour moi, c'est un mythe. Malgré les guerres et la grande dépression, la
première moitié du 20ième siècle fut une époque relativement calme. La vie
ressemblait à celle des siècles précédents. Il ne se passait presque rien.
On avait bien inventé le téléphone, l'électricité et l'automobile, mais
presque personne n'en bénéficiait. Les premières inventions étaient des
machines ou appareils rustiques, très gros et lourds, plus ou moins
fonctionnels. Il était très difficile d'activer les ventes car les moyens de
communications qu'utilisent aujourd'hui les spécialistes du marketing
n'existaient pas, et de toute façon, personne n'avait d'argent pour se
procurer ces nouveautés très chères. Par surcroît, même s'ils avaient
l'argent, ils n'étaient pas tellement intéressés, ils n’en voyaient pas le
besoin. Et l’influence de cette omniprésente société de consommation
n'existait pas vraiment encore.
Il est évident que maintenant, on se sent déjà très loin,
à des années lumières, de l'époque des corvées de boucheries et de sciage de
bois de chauffage. Encore davantage des corvées de battage des grains dans
les granges l'hiver. Les battages des grains comptaient parmi les corvées
les plus longues; spécialement si je me réfère à une époque que j'ai à peine
connue. Avant l'arrivée des engins stationnaires, on utilisait les chevaux
comme force motrice pour faire tourner le moulin à battre conçu à cet effet.
J'ai eu le plaisir d'en voir un fonctionner grâce à un habitant très
conservateur qui préférait toujours les chevaux à toute autre mécanique
moderne. C'était ingénieux; les chevaux marchaient sur un tapis roulant qui
glissait sur un plancher en pente, et dès que le cheval montait sur le
tapis, sa pesanteur faisait tourner le tapis et, le cheval n'avait d'autre
choix que de marcher, sinon, il se sentait aller à reculons; ce qu'il
n'aimait pas vraiment. Il en existait deux modèles; un, à un cheval et un
plus puissant à deux chevaux. Même les deux chevaux ont été remplacés par
des engins stationnaires de cinq chevaux-vapeur.
Il fallait aussi beaucoup de main d’œuvre pour effectuer
ce travail. Quelques hommes approchaient la récolte non battue depuis la
tasserie jusqu'au batteux, un autre homme devait prendre de ses
mains, la paille, et donner à manger à l'engrenage de la batteuse. C'était
la tâche la plus dangereuse, l'homme risquait à tout instant de se faire
arracher les bras par cette machine vorace qui avalait tout avec grande
efficacité. D'un côté sortait l'avoine en grain que la machine avait séparée
de la paille, qui elle, tombait à l'autre extrémité. Encore là, il fallait
deux hommes; un pour empocher l'avoine et un, souvent même deux autres, pour
disposer de la paille dans une tasserie devenue libre, après qu’on
l’eut vidée de tout le foin qu’on y avait entassé en juillet, pour nourrir
les animaux. Le mécanisme de la machine tournait à grande vitesse, et alors
propulsait hors de la machine toute la poussière que peut contenir la
paille. Une poussière noire rendait souvent la visibilité presque nulle dans
la grange, et les hommes qui travaillaient (selon l'expression) comme des
nègres, devenaient effectivement le visage noir, comme des nègres
noirs. Les poumons qui respiraient cette poussière devenaient presque
incapables de fonctionner, cela donnait les symptômes d'une mauvaise grippe
durant environ trois jours, avant que le système se nettoie. C'était le
«bon vieux temps ».
Au début des années quarante, presque tous les
cultivateurs possédaient ces nouvelles batteuses mues par
des moteurs à
essence qu'on appelait "engins de grange stationnaires". Un engin de 5CV
pesait 1500 livres, n'avait qu'un cylindre et tournait de 150 à 200 R.P.M.
Vers la fin de la guerre, on vit apparaître de nouveaux engins de 5CV
beaucoup plus petits, pesant environ le tiers de leurs prédécesseurs. Ils
développaient autant de pouvoir grâce à leur vitesse accélérée, mais nous
étions encore loin des petits moteurs de 5CV que nous retrouvons aujourd'hui
sur nos tondeuses à gazon.
Ces nouvelles batteuses étaient beaucoup plus rapides que
leurs ancêtres, mais il fallait quand même compter de quatre à cinq jours
chez chaque fermier pour compléter le travail; si désagréable fut-il!
Quelques années plus tard les grosses batteuses mobiles firent leur
apparition. Elles étaient plus chères et nécessitaient beaucoup de
personnel pour les opérer, donc, on se regroupait pour en acheter une. Cette
machine était plus avantageuse, plus rapide et plus moderne que toutes
celles qui l'avaient précédée. Bien sûr, elle faisait partie de la même
génération que les nouvelles moissonneuses-lieuses qui coupaient l'avoine ou
le blé, le mettaient en gerbes et l'attachaient avec une ficelle. Il n'était
pas pratique de mettre en tasserie dans la grange ces gerbes en
attendant de faire les battages l'hiver. Alors, on laissait sécher dans les
champs les gerbes que l'on regroupait en monticules de 5 ou 6, et un jour
quand notre tour était arrivé, la batteuse mobile était amenée chez-nous
ainsi que tous les propriétaires avec leurs voitures à foin. Un groupe
ramassait la récolte dans les champs et chaque voiture était approchée de la
batteuse. A l'aide d'une fourche, on tirait les gerbes sur un tapis roulant
qui donnait lui-même à manger à la machine sans que personne ne risque de se
faire avaler. Il fallait quand même empocher l'avoine d'un côté mais la
paille était maintenant soufflée directement dans la grange. Et maintenant
que ce travail s'effectuait à l'extérieur, cela rendait la corvée plus
agréable. La plupart du temps, toute la récolte d'un fermier était battue
dans un seul après-midi. Les tracteurs étaient arrivés à ce moment-là, et
heureusement, car il fallait un moteur d'environ 45CV pour opérer la machine
ainsi que pour la tirer sur la route.
Mais je ne suis pas prêt à dire que tous l'aimaient. Elle
était efficace et mobile mais très encombrante. D’autre part, partager des
équipements avec ses voisins, faisait partie d'un nouveau concept, qui
n'était pas de prime abord bien accueilli par les cultivateurs.
L’agriculture avait depuis des siècles, été pratiquée de façon individuelle.
Je crois aussi que si on semblait ne pas apprécier à sa juste valeur cette
machine, c'est qu'elle faisait partie d'une foule de nouveaux équipements de
ferme, récemment arrivés sur le marché, ayant pour but d'améliorer les
conditions générales des fermiers, de leur permettre de se préparer à des
conceptions nouvelles, qu'exigeaient une agriculture en voie à de profonds
changements.
Pour revenir à la batteuse à chevaux, il faut se rappeler
que les grains étaient coupés à la faucille, plus tard à la faux, et ensuite
à la faucheuse tirée par les chevaux. Ces méthodes étaient lentes et il
fallait laisser sécher la paille, ensuite la charger délicatement dans des
voitures et la transporter dans la grange. L'avènement de la première
moissonneuse changea quelque peu les règles du jeu. Elle coupait la paille
et la distribuait par terre en petits tas qu'on devait lier à la main au
moyen de ficelles. Ensuite on les faisait sécher en les regroupant en nombre
de 4 ou 5 à la fois. La grappe d'avoine devait être pointée vers le haut
afin d'assurer une meilleure qualité de séchage. Et plus tard la
moissonneuse-lieuse mit vite fin aux beaux jours de sa consœur car elle
liait elle-même les gerbes; il s'agissait d'une innovation qui réduisait
incroyablement les heures de travail. Par contre, il fallait encore
assembler les gerbes, quintaux, (appelés «stooks» dans Bellechasse, prononcé
stouc, selon le mot américain), pour le séchage.
Dès que le grain était sec, on plaçait la batteuse mobile
au beau milieu du champ, réduisant ainsi le temps de transport. (d'abord, la machine étant maintenant munie d’une soufflerie, on la plaçait
près de la grange afin d’y souffler la paille directement au bon endroit).
Encore une fois, c'est un nouvel équipement, la presse à foin, qui amena la
batteuse au milieu du champ. On n'avait qu'à approcher la presse à foin près
du tas de paille, presser la paille en ballots, et ainsi, faciliter le
transport et le stockage. Mais en attendant l'arrivée des combines,
tout ce travail exigeait encore de grandes corvées, bien que moins longues
et moins ardues, que celles qu'on avait connues auparavant.
Quant aux corvées de sciage de bois de chauffage,
l'arrivée de la scie à chaîne les a éliminées, on coupait maintenant les
billes selon la longueur désirée dès l'abattage des arbres. On n'avait plus
à manœuvrer de lourds billots de bois franc, les bûches étaient tellement
plus agréables.
Jusqu'à la fin des années cinquante, les corvées de
sciage de bois de chauffage se faisaient durant les froids de février. Le
bois enneigé et glacé glisse mieux sur le banc de scie. Aussi plus le bois
est gelé, mieux il se scie et plus il est facile à fendre. De bon matin, par
des froids sous zéro, un voisin arrivait avec le banc de scie et un autre
tirait l'engin stationnaire. Ces équipements étaient tous munis de skis et
tirés par des chevaux jusqu'à l'emplacement idéal. Il ne restait aux hommes
qu'à effectuer les derniers ajustements et on pouvait démarrer.
Normalement, il suffisait d'une journée pour couper tout
le bois nécessaire à une famille pour l'année durant. Les femmes préféraient
ces corvées car elles n'avaient qu'un dîner à servir; ce qui n’alourdissait
pas leurs tâches durant les jours précédant la corvée. Car en plus des
battages, des boucheries et du sciage de bois, il y avait les réparations et
parfois les constructions de bâtiments et autres travaux où l'homme ne
pouvait suffire seul à la tâche. On avait souvent l'impression que la
cuisine familiale prenait l'allure de restaurant et la femme (hôtesse-cuisinière-serveuse)
devait assumer toutes ces tâches en plus de son boulot quotidien. C'était le
bon vieux temps, celui que l'on préfère avoir oublié rapidement.
La légende de la Corriveau
Préambule, que je vous incite à lire.
Vous aurez sûrement comme réflexion que des histoires de Corriveau n’ont
rien à voir avec des histoires de Thibault. Certes, vous avez raison. Mais
si j’ai décidé de vous raconter cette histoire vraie, devenue légende c’est
que d’une part cette histoire est arrivée juste après la Conquête des
Anglais de 1759. Les vainqueurs étaient maintenant les maîtres de la
Nouvelle France et ils devaient le prouver à la population; à ceux qui
avaient survécu à la guerre. Pour vous rappeler un peu l’histoire, les
Anglais avaient incendié tous les bâtiments à partir de la rivière Ouelle
jusqu’à St-Thomas, maintenant Montmagny. Ils avaient incendié partiellement
le reste de la côte du sud jusqu’à La Pointe Lévy ainsi que tout le secteur
habité de la côte nord du fleuve jusqu’à la Baie St-Paul.
Ce qui veut dire que nos propres ancêtres originaires du Cap-St-Ignace,
installés depuis un peu moins d’un siècle ont dû se battre, et plusieurs
d’entre eux sont décédés. Et, le général Murray avait donné ordre de
déporter en France toute une partie de la population, mais la plupart sont
revenus rejoindre leur famille demeurée en Nouvelle France. Du jour au
lendemain nos ancêtres se sont vu obligés de coucher à la belle étoile avec
leur famille. Reconstruire les bâtiments, refaire leurs outils, labourer
leurs champs pillés par l’armé. Ce furent la pauvreté et la misère qui
dominèrent. De plus, on dû prêter allégeance aux nouveaux seigneurs et
maîtres.
Les habitants n’étaient pas très heureux de s’être battus pour un roi qui
les avait laissés tomber. En effet Louis XV, roi faible qui laissait
conduire la France par le Cardinal Fleury depuis sa majorité, ne s’occupait
que de ses maîtresses et la Nouvelle France n’avait aucune importance pour
lui. La frustration était très grande dans le peuple et plusieurs étaient
presque heureux de voir leurs ennemis devenus leurs maîtres; ils avaient de
grandes espérances.
Louis XV (1715-1774) était le petit fils de Louis X1V, il devint orphelin
à l’âge de trois ans. Il règne d’abord sous la régence de Philippe
d’Orléans, neveu de LouisX1V, jusqu’à sa majorité. Il marie la polonaise
Marie Leszczynska. Il avait 15 ans. Après quelques années de mariage il
commence à se lasser de cette si belle reine aux mœurs froides. Le roi
s’ennuie et alors M. Fleury avec l’aide du Comte de Richelieu, neveu du
grand Cardinal Richelieu, et de son valet de chambre le duc Pecquigny pour
lui trouver de l’amusement. Mais cet amusement se compose en particulier de
femmes pour le plus grand bonheur du roi qui ne s’ennuie plus et qui
enrichit ses bienfaiteurs tous les jours d’avantage.
Louis XIV avait été un grand roi et nul ne l’a jamais contesté. Son
prédécesseur Henri 1V est demeuré lui aussi dans l’histoire des grands rois.
Je parle de lui parce que peu de gens savent pourquoi on possède des
boulevards à son nom, etc. Henri IV était roi de Navare, un état tout au sud
de la France, à la frontière de l’Espagne qui n’appartenait pas encore à la
France. Henri faisait partie de la lignée des Bourbons et donc à ce titre il
avait le droit d’accéder à la couronne de France. Mais la reine Catherine de
Médicis ne l’entendait pas ainsi et donc ils étaient deux grands ennemis.
Henri était un des plus grands comploteurs de France et, il lui fallait
trouver un moyen d’arriver un jour à être le maître du Louvre. Il vit dans
la reine Margot, fille de Catherine, une femme aussi rusée que lui et aussi
ambitieuse. Il n’avaient aucun amour l’un envers l’autre, mais ils devaient
s’associer, et le mariage semblait la base la plus solide pour réaliser leurs
ambitions.
Ils s’épousèrent mais le mariage ne dura pas longtemps. Par contre en
unissant leurs forces ils pouvaient déjouer les desseins de Catherine. Mais
Catherine trop ambitieuse empoisonna un de ses fils pour faire accéder
l’autre au trône. Henri III, de santé fragile mourut soudainement et comme
personne d’autre que Henri IV n’était disponible, il eut la couronne de
France et devint un grand roi.
Lorsque le deuxième mari de la Corriveau fut décédé et qu’elle fut
reconnue coupable, elle fut exécutée et pendue dans une cage de métal sur le
terrain dans la fourche de Lauzon, (qu’on appelait dans le temps, les quatre
chemins de la Pointe de Lévy) à quelques rues de la Boulangerie Samson, où
plus tard on a construit une maison, qu’on agrandira plus tard encore, et qui
devint un quatre logements dont je fus le propriétaire durant presque vingt
ans. Voila pourquoi je vous raconte cette histoire qui me concerne
maintenant.
Je vais vous la raconter telle que l’a racontée Philippe Aubert de Gaspé
dans son roman Les Anciens Canadiens qu’il a écrit au
milieu du dix-neuvième
siècle, donc au temps où cette histoire était presque contemporaine.
«Trois ans après la conquête du pays, c’est-à-dire en 1763, un meurtre
atroce eu lieu dans
la paroisse de St-Vallier, district de Québec; et quoiqu’il se soit
bientôt écoulé un siècle
depuis ce tragique événement, le souvenir s’en est néanmoins conservé
jusqu’à nos jours,
entouré d’une foule de contes fantastiques qui lui donnent tout le
caractère d’une légende .
En novembre 1749, une femme du nom de Corriveau se maria à un cultivateur
de Saint-Valier.
Après one ans de mariage, cet homme mourut dans cette paroisse le 27
avril 1760. Une vague rumeur se répandit alors que la Corriveau s’était
défaite de son mari, en lui versant, tandis qu’il était endormi, du plomb
fondu dans l’oreille.
On ne voit pas toutefois que la justice de l’époque ait fait aucune
démarche pour établir la vérité ou la fausseté de cette accusation; et trois
mois après le décès de son premier mari, la Corriveau se remariait en
secondes noces, le 20 juillet 1760, à Louis Didier, aussi cultivateur de
Saint-Valier.
Après avoir vécu ensemble pendant trois ans, la tradition s’accorde à
dire que, sur la fin du mois de janvier 1763, la Corriveau, profitant du
moment où son mari était plongé dans un profond sommeil, lui brisa le crâne,
en le frappant à plusieurs reprises avec un broc,(espèce de pioche à trois
fourchons). Pour cacher son crime, elle traîna le cadavre dans l’écurie, et
le plaça en arrière d’un cheval, afin de faire croire que les blessures
infligées par le broc provenaient des ruades de l’animal. La Corriveau fut
en conséquence accusée de meurtre conjointement avec son père.
Le pays étant encore à cette époque sous le régime militaire, ce fut
devant une cour martiale que le procès eut lieu.
La malheureuse Corriveau exerçait une telle influence sur son père
(Joseph Corriveau), que le vieillard se laissa conduire jusqu’à s’avouer
coupable de ce meurtre : sur cet aveu, il fut condamné à être pendu, ainsi
que le constate la pièce suivante extraite d’un document militaire,
propriété de la famille Nearn, de la Malbaie.»
Je vais ne reproduire ici que le texte traduit en français par les
autorités du temps.
Québec, 15 avril 1763
«La Cour martiale, dont le lieutenant-colonel Morris était président,
ayant entendu le procès de Joseph Corriveau et de Marie-Josephte Corriveau,
Canadiens, accusés du meurtre de Louis Dodier, et le procès d’Isabelle
Sylvain, Canadienne, accusée de parjure dans la même affaire; le gouverneur
ratifie et confirme les sentences suivantes : Joseph Corriveau, ayant été
trouvé coupable du crime inputé à sa charge, est en conséquence condamné à
être pendu.
La Cour est aussi d’opinion que Marie-Josephte Corriveau, sa fille, veuve
de feu Dodier, est coupable d’avoir connu avant le fait le même meurtre, et
la condamne, en conséquence, à recevoir soixante coups de fouet à neuf
branches sur le dos nu, à trois différents endroits, savoir : sous la
potence, sur la place du marché de Québec et dans la paroisse de
Saint-Valier, vingt coups à chaque endroit, et à être marquée au fer rouge à
la main gauche avec la lettre M.»
«La Cour ordonne aussi Isabelle Sylvain à recevoir soixante coups de
fouet à neuf branches sur le dos nu, de la même manière, temps et places que
la dite Josephte Corriveau, et à être marquée d’un fer rouge à la main
gauche avec la lettre P»
Heureusement ces sentences ne furent point exécutées, et voici comment le
véritable état de la cause fut connu.
Le malheureux Corriveau, décidé à mourir pour sa fille, fit venir le Père
Glapion, alors supérieur des Jésuites à Québec, pour se préparer à la mort.
À la suite de sa confession, le condamné demanda à communiquer avec les
autorités. Il dit alors qu’il ne lui était pas permis consciencieusement
d’accepter la mort dans de pareilles circonstances, parce qu’il n’était pas
coupable du meurtre qu’on lui imputait. Il donna ensuite aux autorités les
moyens d’arriver à la vérité et d’exonérer Isabelle Sylvain du crime supposé
de parjure, dont elle était innocente. A la suite des procédés ordinaires,
l’ordre suivant fut émané.
Voici la traduction française de l’ordre :
«Québec, 15 avril 1763
La Cour Martiale, dont le lieutenant-colonel Morris était président, est
dissoute.
La Cour Martiale Générale ayant fait le procès de Marie-Josephte
Corriveau, accusée du meurtre de son mari Dodier, l’a trouvée coupable. Le
Gouverneur (Murray) ratifie et confirme la sentence suivante :--Marie-Josephte
Corriveau sera mise à mort pour ce crime, et son corps sera suspendu dans
les chaînes, à l’endroit que le gouverneur croira devoir désigner.»
Conformément à cette sentence, Marie-Josephte Corriveau fut pendue, près
des Plaines d’Abraham, à l’endroit appelé les buttes à Nepveu, lieu
ordinaire des exécutions, autrefois.
Son cadavre fut mis dans une cage de fer, et cette cage fut accrochée à
un poteau, à la fourche des quatre chemins qui se croisent dans la
Pointe-Lévy, près de l’endroit où est aujourd’hui le monument de
tempérance, -- à environ douze arpents à l’ouest de l’église, et à un arpent
du chemin.
Les habitants de la Pointe-Lévy, peu réjouis de ce spectacle,
demandèrent aux autorités de faire enlever cette cage, dont la vue, le bruit
et les apparitions nocturnes tourmentaient les femmes et les enfants. Comme
on n’en fit rien, quelques hardis jeunes gens allèrent décrocher, pendant la
nuit, la Corriveau avec sa cage, et allèrent la déposer dans la terre à un
bout du cimetière, en dehors de l’enclos.
Cette disparition mystérieuse, et les récits de ceux qui avaient entendu,
la nuit, grincer les crochets de fer de la cage et cliqueter les ossements,
ont fait passer la Corriveau dans le domaine de la légende.
Après l’incendie de l’église de la Pointe-Lévis, en 1830, on agrandit le
cimetière; ce fut ainsi que la cage s’y trouva renfermée, et qu’elle y fut
retrouvée en 1850, par le fossoyeur. La cage, qui ne contenait plus que l’os
d’une jambe, était construite de gros feuillard. Elle imitait la forme
humaine, ayant des bras et des jambes, et une boîte ronde pour la tête. Elle
était bien conservée et fut déposée dans les caveaux de la sacristie. Cette
cage fut enlevée secrètement quelque temps après, et exposée comme curiosité
à Québec, puis vendue au musée Barnum, à New-York, où on doit encore la
voir.»
Le mariage
d'Omer
En principe, je ne voudrais pas vous causer du mariage de
quelqu'un en particulier, mais le mariage d'Omer me permet de vous raconter
une page d'histoire des us et coutumes jusqu'au milieu du 20e siècle. De
plus il s'agit d'un évènement pittoresque dont je me souviens assez bien, et
qui concerne un oncle qui ma considéré comme un de ses propres fils toute sa
vie.
Depuis quelques années Omer
gagnait sa vie à travailler un peu partout; dans les chantiers l'hiver et
dans les moulins à scie l'été. Durant les périodes de chômage il venait
aider mon père et, possédant comme seul véhicule sa bicyclette, il devait
demeurer là où il travaillait; c'est-à-dire chez-nous. C’était normal car
c’est comme ça que ça se passait dans le bon vieux temps. Maman ne s'en
plaignait pas, même si cela lui apportait une somme supplémentaire de
travail; elle en avait l'habitude! Il y avait toujours quelqu'un à la
maison. Rares étaient les personnes qui possédaient une auto, et de ce fait,
il était impossible de voyager à plus de quelques milles de distance.
Un certain printemps, Fortunat
Jean (dont j'ai déjà parlé) avait décidé de vendre sa terre et d'aller se
lancer dans l'opération d'un garage à St-Simon, afin d’y construire des
auto-neiges. Donc, Omer, armé des conseils judicieux de mon père acheta la
terre. Il s'appliqua à rendre la maison agréable et attirante pour la jeune
fille qu'il cherchait, maintenant qu'il possédait sa ferme; ce qui
l'identifiait dans toute la paroisse, et même ailleurs, comme un gars qui
recherchait la belle, car il devenait pressé de se marier.
Après tout, il n’existait pas beaucoup de précédent concernant les
cultivateurs célibataires. Mais quelle belle lui ferait signe
qu'elle était prête à accueillir ses avances et à devenir madame Omer
Thibault? Et accepter de vivre au sud du lac? Au même moment, il devait
mettre au point son cheptel, ensemencer les champs qui avaient été labourés
l'automne précédent et assumer pleinement son rôle de cultivateur. Mais
comme il n'avait personne pour lui faire la popotte, et laver son linge, il
continua de demeurer chez-nous jusqu'à ce qu'il emménage chez-lui avec sa
nouvelle dulcinée. Il était assez rare que quelqu'un se marie d'abord, et
ensuite cherche à s'installer (expression qui voulait dire; avoir sa propre
terre). Le père aidait son jeune fils à acquérir sa propre terre que l'on
cultivait en famille jusqu'à ce que le jeune trouve femme, car, à quelques
rares exceptions, il était impensable d'exploiter une ferme sans l'aide
précieuse d'une femme. Pour l'héritier de la ferme paternelle les choses
étaient différentes. Parfois, la ferme était cédée au fils seulement lorsque
celui-ci était marié. Le fait qu'il puisse demeurer avec ses parents comme
il le faisait depuis sa naissance évitait de précipiter les choses. Par
contre, la jeune femme savait qu'elle devrait partager une maison avec les
beaux-parents durant un certain nombre d'années en attendant, dans la
plupart des cas, que le père se trouve assez vieux pour aller vivre au
village; plus près des services communautaires et autres.
Omer qui n'était pas de nature
gênée souffrait d'une timidité chronique lorsqu'il rencontrait une fille qui
aurait pu l'intéresser. Il ne savait plus comment s'y prendre et les trous
de mémoire lui raclaient la gorge. Mon père le mettait en contact, sans le
lui annoncer préalablement, avec des filles qui auraient été susceptibles de
l'intéresser. Mais il ne parvenait jamais à entreprendre, ni à maintenir la
conversation avec elles, encore moins à créer une relation quelconque. Je
n'ai jamais su pourquoi, mais je suis persuadé qu'il avait arrêté son choix
sur Agnès depuis un bon moment sans le mentionner à mon père, car il savait
qu'Agnès n'aurait pas été le premier choix de son frère. Il était normal
qu'un gars aussi timide ait arrêté ses recherches dès qu'il eut trouvé la
perle disponible, prête, et possédant toutes les qualités d'une bonne femme
de cultivateur. Elle n'était sûrement pas au goût de mon père
intellectuellement et physiquement, mais papa avait senti que Omer avait des
goûts différents. Constatant que son frère se dirigeait droit vers le pied
de l'Autel, il s'abstint de lui faire d'autres suggestions ou de lui faire
sentir qu'il existait des filles qui avaient beaucoup plus à offrir
selon son estimation personnelle. Après tout Omer devait faire son propre choix selon ses propres
critères et sa propre expérience.
Omer et Agnès convolèrent en
justes noces et, le père Georges en profita pour peindre les bâtiments à la
chaux blanche, et faire partout, un ménage bien mérité; le buggy bien
verni, la jument bien étrillée, le poil bien lisse, la croupe bien ronde
d'un animal bien traité, les fers neufs et les boucles d'attelage bien
astiquées au Brosso. Tout était prêt à l'extérieur, et à l'intérieur, les
femmes avaient nettoyé les planchers au caustique et posé du prélart bon
marché dans le salon. On avait ajouté à la table familiale, qui était déjà
assez grande pour quinze personnes, de longues tables bien garnies. Je ne me
souviens pas du repas de noces particulièrement; mais pour donner une idée
des habitudes du temps et, aussi parce que je me souviens bien des habitudes
de la famille, je dirais qu'il y avait au menu: une soupe de tous les
légumes du jardin, un rôti de porc frais qu'on avait abattu pour la
circonstance, de la viande de chevreuil et d'orignal entourée de tranches de
lard salé. Viande sauvage que le père Georges avait marinée depuis sa
dernière chasse. Et au dessert; de bonnes tartes gonflées de gadelles,
groseilles, cerises, cassis ou pommes, comme seules ces fermières savaient
les faire, avec tous les produits que cette terre riche leur offrait
généreusement, et en abondance.
Rien qu'à y penser, ça met
l'eau à la bouche! Je suis persuadé que tous ont mangé plein leur soûl
(expression à maman) et qu'il en est resté plein la table. Un repas de
noces; cela signifiait quelque chose que l'on n’oublie pas. On y mettait le
paquet, mais on n’achetait presque rien. Tout se faisait à partir de
produits cultivés sur la ferme. Les femmes se surpassaient à la cuisine, et
plus les invités mangeaient, plus elles étaient heureuses de constater
l'appréciation de tous.
En ce temps-là, les voyages de
noces n'existaient presque pas. Je ne me souviens pas s'ils ont respecté la
coutume; aller passer quelques jours chez la parenté dans une paroisse
voisine ou, s'ils sont entrés directement à la maison et commencé
immédiatement à apprécier leur intimité. Quoi qu'il en soit, leur nid
d'amour et le reste de la maison étaient prêts pour les accueillir et, ils
ne perdirent pas de temps pour s'y installer. Un poêle à bois, une table,
des chaises droites et berçantes meublaient la cuisine. Un lit, de bonnes
couvertures qui faisaient partie du trousseau d'Agnès, et une grosse commode
rustique de style canadien avaient suffi pour aménager la chambre des
nouveaux époux. La coutume voulait que les futurs couples recherchent les
ventes aux enchères pour se procurer les meubles dont ils auraient besoin,
car il faut se rappeler que le commerce du meuble n'était pas très
florissant à l'époque. Peu de gens, et à plus forte raison les jeunes
couples, ne pouvaient s'offrir des meubles neufs. D'ailleurs, le style,
l'agencement et la décoration n'étaient pas encore des critères importants.
Tous les meubles de cette région en cette époque se ressemblaient; tables
robustes et chaises de bois, fabriquées à la main par les fermiers avec le
peu d'outils qu'ils possédaient. Lits en tuyaux de métal courbés, sommiers à
lames sur lesquelles on étendait soit un matelas pour le lit des parents,
soit une paillasse pour les lits des enfants.
La population venait de vivre
les affres de la crise de 1929, et avant même d'avoir réussi à s'en sortir,
elle avait vécu le rationnement du temps de la guerre de 39-45. Les jeunes
qui se mariaient durant ces années n'avaient pas eu à regarder dans le
dictionnaire pour connaître la signification du mot rien. On n'avait
connu que misère et privations. Heureusement encore, que les fermes
pouvaient produire presque toute la nourriture; ce qui n’était pas le cas
des citadins qui manquaient de vivres, en plus de l’habillement et le reste.
L'important était d'avoir une table, un lit, une commode. Bien sûr, un
vaisselier en guise d’armoires de cuisine et autres meubles qui servaient de
garde-robes. En ce temps-là, les maisons n’étaient pas construites selon les
mêmes normes que nous connaissons aujourd’hui; très rares étaient celles qui
possédaient des armoires et garde-robes construites à même les murs comme
cela se fait maintenant. Il serait toujours temps plus tard de changer tout
cela, si jamais leurs moyens financiers leur permettaient d’en avoir le
goût.
Le nouveau couple était
heureux et savourait sa lune de miel un peu plus chaque jour. Omer berçait
son Agnès, (prononcé à l'époque; Agnaize) caressait ses belles grosses
cuisses, et lui donnait de petites tapes d'amour sur ses belles grosses
fesses. Cela frisait presque l'indécence, aux yeux des non initiés, au sans
gêne des touchers intimes. Mais cela ne semblait pas inquiéter Omer qui
semblait au contraire raffoler des nombreuses sensations que le bout de ses
doigts transmettait à son cerveau d’heureux esclave de ses instincts
sexuels. Agnès lui en mettait plein les bras, et le soleil ne brillait que
pour eux. Il semblerait que lorsqu’ils étaient seuls, ils se livraient à une
intimité encore plus complète et satisfaisante. Bientôt, trop tôt, Agnès
était partie pour la famille, elle attendait du nouveau. Cela
s'est bien passé, et ce fut une fille, Murielle, qui venait d'ouvrir la
porte à une grande famille. Douze enfants en moins de quinze ans. Cela
n'avait rien d'extraordinaire, tous les couples, à moins d'être malades ou
que l'un des deux soit stérile, mettaient au monde un nouveau petit chaque
année. Dans le cas d'Omer, son exploit fut digne de mention, non seulement
il eut 12 enfants, mais de ces 12, trois arrivèrent après qu’il eut été
amputé des deux bras. Heureusement que ses doigts avaient connu de si
douces sensations avant. Bien sûr, il argue qu'on ne fait pas les enfants
avec ses bras! Mais, même cette réplique semble simpliste et nous impose les
réflexions qu'il aurait dû s'imposer alors.
Murielle était un beau bébé.
Elle avait ce petit nez un peu pointu de certaines de ses tantes Thibault.
Peut-être aussi avait-elle leurs yeux intelligents. Quand elle fut devenue
adulte, je lui ai plutôt trouvé des yeux de Rousseau et, pourquoi pas des
yeux de Boulanger. (Je ne sais pas si ces yeux de Rousseau venaient de la
famille de leur mère ou celle de leur père car je n’ai connu de la famille
Rousseau, personne d’autre que le père George. Par contre je me souviens
des grands-parents Boulanger, mais je n’ai aucun souvenir de leurs yeux;
j’étais trop jeune pour remarquer cela). Certains autres traits de son
visage étaient l’héritage des Rousseau. Comme toujours, le mélange en
faisait un beau bébé. Je me souviens de l'avoir vue dans son berceau toute
vêtue de blanc, baignée dans une mer de langes roses et blancs immaculés.
Agnès avait ses goûts et son orgueil, le blanc ne pouvait être autrement
que blanc immaculé.
Les enfants d'Omer étant plus
jeunes que nous ne sont pas devenus nos amis de jeux. Murielle devait être
de l'âge de Béatrice ou à peu près. Alors elle n'avait commencé l'école
qu'un an avant notre départ de St-Mathieu. Je me souviens de ces enfants
lorsqu'ils étaient très jeunes, mais après les avoir perdus de vue durant
quelques années, avant que je sois assez vieux moi-même pour retourner à
St-Mathieu par mes propres moyens, je ne pouvais plus reconnaître que
Murielle et Gérald. J'en connais quelques-uns maintenant grâce à quelques
rencontres plus récentes lors de passages à Vancouver, avec ceux qui sont
là-bas ou lors de différentes rencontres ou rassemblements de familles. La
plupart se sont mariés et ont eu quelques enfants. Ils vivent éparpillés
presque à la grandeur du Canada depuis la Colombie-Britannique jusqu'à la
Gaspésie. Ce n'est pas toujours vrai, quelques-uns d'entre eux semblent un
peu nomades et reviennent périodiquement à leur lieu de naissance.
La cabane à
sucre
L'acériculture n'a vraiment
rien de commun avec l'agriculture, sinon que l'érablière est normalement
située sur la ferme, dans la partie non défrichée; où l'on a conservé une
superficie boisée pour subvenir aux besoins en bois de toutes sortes.
L'érablière n'est souvent qu'une petite partie de la terre à bois, où le
terrain et le sol sont propices à la croissance des érables. La période de
production d’une érablière ne dure qu'une très courte période à chaque
printemps. Pour l'agriculteur, cela représente un revenu d'appoint, qui
arrive à un moment où le travail de la ferme n'est pas encore commencé,
alors que les bûchages et toutes les corvées sont terminées; dans une
période morte, quoi! Le temps des sucres est pour les habitants de la chaîne
de montagnes des Appalaches ce qu’est la pêche aux phoques aux Madelinots,
ou la pêche à la morue aux habitants de la côte atlantique. A chaque année à
l'approche des sucres, chacun sortait de sa léthargie; mon père guérissait
de tous ses maux, le beau-père rajeunissait de dix ans et se sentait
fringuant comme dans sa jeunesse. J’ai rarement vu, activité plus attirante et
plus envoûtante pour les hommes qui nous ont précédés. J'ai souvent entendu
dire que l'an prochain, on ne ferait plus de sucre, c'était beaucoup trop de
travail et, ça ne rapportait pas de revenus, mais le temps venu, la maladie
du printemps regagnait ses quartiers et il fallait entailler de nouveau.
Je me souviens, quand nous
sommes arrivés à Beaumont, il n'y avait qu'une petite érablière de 600
entailles, une petite cabane abandonnée et un camp pour le cheval; abandonné
lui aussi, rien d'autre. A l'approche du premier printemps, mon père
tournait en rond. Il lui manquait quelque chose, comme s'il avait arrêté de
fumer. Même sans argent, il acheta un petit évaporateur de deux pieds de
large sur huit pieds de long. Il apprit de Lévis Roy, qui travaillait au
collège de Lévis, qu'on disposait là-bas de six ou sept cent boites de
conserve de trois pintes, on n'avait qu'à aller les chercher, enlever les
couvercles, percer des trous pour les accrocher aux chalumeaux, et la saison
des sucres était en marche. Assez curieusement, dès que mon père eut pris sa
décision et même avant qu'il ait eu le temps de trouver les équipements
nécessaires, ses malaises le quittèrent et sa santé, à l'instar de la
température à ce temps de l'année, s'améliorait de jour en jour.
Les plus beaux souvenirs des
printemps de mon enfance sont sans contredit ceux qui viennent de St-Mathieu.
Dans cette érablière dont je vais me remémorer les souvenirs fidèlement dans
les paragraphes suivants.
Au printemps de 1981; trente
ans après notre départ de St-Mathieu, je suis retourné visiter cette
érablière (que possédait toujours Jean-Paul Vaillancourt, qui l'avait
achetée de Philippe Ouellet; à qui nous l'avions vendue) et, à mon grand
étonnement je n'y ai pas trouvé de grands changements. On avait récemment
agrandi de nouveau la cabane, pour faire place à un plus gros évaporateur,
mais le réservoir à eau acheté par mon père en 1950 était toujours là. La
cuisine n'avait à peu près pas changé à l'exception du poêle à bois. La
cueillette de l'eau se faisait maintenant avec des tracteurs de ferme montés sur
chenilles pour l'hiver, et on voyageait en motoneige; ce qui est beaucoup
plus rapide et moins fatigant qu'à pieds. Le modernisme des tuyaux de
plastique n'était pas encore apparu.
C'est avec beaucoup d'émotions
que j'ai retrouvé cette érablière de mon enfance, située tout au bout de
notre terre, à environ vingt-cinq arpents de la maison seulement. Et si loin
à la fois; parce qu'il fallait faire un détour jusque chez le troisième
voisin (l'oncle Omer) pour s'y rendre à travers forêts et montagnes. Juchée
au haut de plusieurs montagnes successives, mon père disait que lorsque nous
étions sur la côte en face de la cabane, nous étions à environ cinq mille
pieds au-dessus du niveau de la mer. C'était un site merveilleux, pour celui
qui aime regarder et admirer les grands paysages que la nature offre si
généreusement, dans ces territoires parsemés de lacs, de rivières, et de
montagnes. Au printemps, en l'absence de feuilles dans les arbres, on
pouvait admirer à l’œil nu le St-Laurent, qui étend la profondeur de ses
eaux jusqu'à la côte du nord sur une distance de vingt-cinq milles, laissant
flotter sur sa surface houleuse, obéissant aux horaires précis des marées,
les plus beaux et les plus gros paquebots. Ce majestueux St-Laurent qui
recèle dans ses fonds marins d'immenses richesses, où l'homme a puisé pour
se nourrir, depuis de nombreux millénaires. Le fleuve, que tous appellent la
mer, tellement il est large à partir de Rivière du Loup, était à environ
cinq milles au nord de notre érablière. A cette distance, il était déjà
difficile de distinguer les mouvements des glaces, même si par temps clair
nous pouvions distinguer les gros bateaux; qui devaient naviguer à plusieurs
milles du rivage.
Entre l'érablière et le
fleuve, le paysage se composait d'une immense forêt, très dense, qui
semblait s'étendre sur un terrain dévalant une pente régulière et
décroissante, car la densité de la forêt ne permet pas à l’œil de
distinguer les collines, les vallées, les bas-fonds et les pentes très
abruptes, qui composent le territoire saccadé de la chaîne des Appalaches.
La cabane était construite
sur une pente douce, où il était possible de trouver un endroit relativement
plat et, au niveau, afin d'y ériger cette construction très rustique. A
quelques pas du versant nord de la cabane, s'estompait une pente très à pic
vers le nord, penchant naturel à cet endroit. A quelques centaines de mètres
au sud s'élevait brusquement une haute colline en guise de promontoire d'où
nous pouvions admirer ce merveilleux paysage. A l'ouest, toujours en
remontant cette pente douce quelques centaines de respirations plus loin, on
atteignait un terrain plus plat (d'est en ouest), c'était l'érablière du
vieux Félix Rioux, qui ne s'était jamais départi de cette petite terre à
bois et pour cause! Je me souviens qu'il a entaillé ses érables jusqu'aux
dernières années de sa vie. Pour nous les enfants, Félix Rioux était très
vieux. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il dépassait sûrement la
soixantaine; il était peut-être plus prêt des quatre-vingt que des
soixante-dix. Sans être considéré comme parent avec nous, il était
certainement assez proche parent avec mon grand-père car, d'après mes
souvenirs il avait le même style, même caractère: bon bonhomme, jovial, sans
malice, un timbre de voix doux, jamais agressif. Mon plaisir était d'aller
me placer près d'où il passait avec son cheval et sa voiture car je me
faisais le pari que je l'entendrais chanter. Il devait fredonner même quand
il dormait. Nous allions le visiter à sa cabane le printemps. Il prenait le
temps de nous recevoir, de jaser avec nous et de nous montrer ses réussites.
A son âge, un homme est aussi fier de montrer ses humbles réussites que les
enfants le sont quand ils commencent à se fabriquer eux-mêmes certains
jouets. Sa cabane était petite et vieille mais il savait qu'elle lui
survivrait quelques années. Il avait élevé sa famille sur notre terre qu'il
avait vendue à Jean-Baptiste Jean, celui de qui nous l'avions achetée. Je ne
sais pas quand il a acquis cette érablière qui ne faisait pas partie de
notre terre, (son ancienne terre) mais qui était plutôt une partie de la
terre d'Edmond Dionne, et qui d'ailleurs enlevait à ce dernier plusieurs
centaines d'érables. Un jour lorsque j'étais encore très jeune, on ne l'a
plus jamais revu. Je crois que c'est Edmond Dionne qui acheta cette
érablière afin de reconquérir ce qui appartenait à sa terre, car si je me
souviens, la cabane fut démolie et personne d'autres que Edmond Dionne
entailla ces érables. (Ceci me fut confirmé, être vrai, par Armand Rioux --fils de Félix-- en 1998).
Ensuite, c'était celle
d'Edmond Dionne, dont les érables et le site étaient identiques à ceux de
chez-nous, mais produisaient deux fois plus, tout comme son évaporateur qui
était deux fois plus efficace que ceux des autres. Edmond Dionne n'était
pas menteur pour vrai. Il se contentait de ne jamais dire la vérité.
C'était peut-être une façon de dire aux autres de se mêler de leurs affaires
ou encore de chercher à provoquer des réactions et de s'en amuser. L'oncle Omer lui avait répliqué à la porte de l'Église, un dimanche matin, devant
une foule qui attendait les meilleures répliques, «toi Edmond, tu penses que
ça coule chez-vous, c'est rien ça, tu devrais venir voir chez-nous, moi je
ne fournis plus, je ne peux plus ramasser l'eau avec des chaudières de cinq
gallons, je me promène avec deux barils de quarante-cinq gallons au bout des
bras». Tout le monde riait, surtout Edmond, c'était une réplique à son goût. Omer pensait l'avoir planté comme il faut et tout le monde qui l'approuvait
aussi, mais quand il a vu l'expression sur le visage d'Edmond, il a sûrement
compris que son compère n'exagérait pas tous ses propos pour mentir mais
pour recueillir ce genre de répartie, qui de toute évidence lui avait
beaucoup plu.
Revenant à notre point
d'intérêt; notre cabane, il fallait redescendre cette pente douce,
(d'ailleurs beaucoup plus agréable à parcourir dans ce sens) de quelques
centaines de pieds plus à l'est, et plus au nord, pour atteindre la cabane
des Rousseau. En fait notre érablière s'insérait à l'intérieur d'une
superficie de quatre arpents de large(de front) sur autant de profond. Les érables
étaient très longs et à ma grande surprise, je les ai trouvés exagérément
longs quand je les ai revus en 1981, trente ans plus tard. Ils avaient
également grossi à chaque année, en même temps qu'ils avaient allongé. J'ai
constaté qu'un très grand nombre portait maintenant deux ou trois
chaudières. Ces érables qui boisent les pentes vers le nord produisent
beaucoup moins que ceux que l’on retrouve dans les côtes qui penchent vers
le soleil. Ils dégèlent plus tard et ne coulent que quelques heures par jour
et, même s'ils continuent de produire quelques jours après les autres, il en
résulte que les températures de fin de saison ne sont pas aussi propices aux
bonnes coulées et, l'eau ne possède plus la fraîcheur des meilleures
semaines. Ces gros et grands érables sont beaucoup plus lents à dégeler. Ils
commencent à donner leur plein rendement lorsque les petits commencent déjà
à s'épuiser. Ils sont plus résistants aux rayons du soleil et à la chaleur,
grâce à l'énorme épaisseur de glace à l'intérieur de leur tronc et, surtout,
à l'étendue de leurs racines dans le sol; ce qui leur permet de produire une
eau de qualité plus tard dans la saison, assurant de ce fait une récolte et
un produit fini de meilleure qualité.
Les Rousseau avaient une
grande cabane, bien organisée. De plus ils étaient plusieurs grands garçons,
et de ce fait, ne manquaient pas de main d’œuvre. Le père Georges qui
n'aimait pas tellement autre chose que la chasse et la pêche, venait
quand même de temps en temps prêter main forte à ses garçons. Je parle des
garçons car on avait l'impression dans ce temps-là que seuls les garçons
étaient utiles, mais il ne faut pas oublier Irène qui sans être plus
masculine que les autres, était tout aussi habile que les garçons, et
accomplissait les mêmes tâches avec autant de plaisir et d'ardeur. Et
heureusement car un jour alors que Henri était encore jeune Victor s'enfuit
de la maison, Benoît demeurait aux études et Mathieu lui, avait décidé
d'entailler la petite érablière sur la terre de Voisine que son père avait
achetée avec l'intention de la lui céder lorsqu'il se marierait. Mathieu
sortait avec Lucie Rioux, cousine de maman, et le père Georges trouvait
qu'elle avait les plus belles jambes du monde, et cela le rendait très
sympathique à l'endroit de son fils qui avait si bon goût pour les filles.
L'érablière de Mathieu était
située juste au bas de la plus haute côte au-dessus desquelles étaient
perchées les autres érablières. C'était de jeunes érables de petites
tailles, et mêlés de plaines; ces faux érables qui produisent un excellent
sirop, et qui coulent autant que les autres. Mathieu était le seul à réussir
un produit aussi clair et aussi bon (ce qu’on appelle du sirop gradé extra
clair). Bien sûr, un bon emplacement, de jeunes érables et de l'équipement
neuf et efficace, étaient responsables de cette réussite. Et comme on le
disait dans le temps; Mathieu voyait à son affaire.
Entre la terre des Rousseau et
celle de l'oncle Omer, il y avait celle de Gérard Gagnon. Je ne sais pas
pourquoi, mais cette terre ne possédait pas son érablière. On avait dû
bûcher ce bois précieux pour fabriquer du contre-plaqué ou pour s'assurer
des revenus avec le bois de chauffage après y avoir épuisé tout le bois de
sciage.
L'oncle Omer possédait lui
aussi son érablière située tout au haut de cette horrible côte, où on
coupait un arbre en haut, et descendions en bas pour l'ébrancher.
Heureusement, car il était impossible de sortir le bois de cet endroit
autrement qu'à force de bras d'hommes. Les érables étaient de dimensions
moyennes et en bonne santé. J'ai eu le cœur serré en 1981 lorsque je suis
arrivé au village juste en face de la terre de l'oncle Omer, et que j'ai vu
une grande clairière, comme une cavité de quatre arpents de large sur une
longueur que je ne pouvais déceler du point où j'étais. Jacques Ouellet qui
avait acheté cette terre et qui en était toujours propriétaire avait fait
coupe à blanc de tout le bois situé en haut de la côte; quel sacrilège!
Spécialement pour un membre d'une famille de prêtre et de religieuses dont
la grande dévotion faisait dire au monde qu'ils étaient déjà des saints. Ils
n'ont jamais pensé que de détruire ainsi la nature était beaucoup plus
pécher et mal envers l'humanité, que les petits péchés d'impureté dont ils
devaient se confesser.
L'oncle Omer produisait du bon
sirop mais il ne réussissait pas à faire mieux que son beau-frère Mathieu
Rousseau, dans l'érablière voisine, au pied de la côte. L'oncle Omer était
un peu trop loin de nous pour rivaliser avec ceux de notre entourage. Ce
n'était pas très loin mais assez pour nous empêcher de se rendre visite trop
souvent. Il était plus facile pour lui de comparer avec son voisin
d’érablière immédiat; Omer Ouellet, qui par hasard avait acheté seulement
l'érablière lorsque Voisine vendit sa terre en deux parties, soit une partie
au père Georges, et la sucrerie à Omer Ouellet. Ce boisé était situé juste
en haut de la côte derrière l'érablière de Mathieu Rousseau et voisin de
celle d'Omer Thibault. Les deux érablières étaient identiques, comme
d'ailleurs le terrain sur lequel elles reposaient. Omer Ouellet demeurait
presque à l'extrémité est du quatrième, juché au haut de la côte
derrière Ti-Charles Dionne. Son seul voisin était Elzéar Lagacé à l’est. Il
devait donc parcourir une distance de plus de deux milles pour se rendre à
la sucrerie. Le chemin n'était pas entretenu l'hiver entre l'école et
l'oncle Omer, ce qui obligeait Omer Ouellet à ouvrir ce chemin au printemps
afin de pouvoir voyager avec un cheval et une voiture. Comme cela était très
incommodant, il décida un printemps de ne pas entailler. Cette décision
était venue aux oreilles des Rioux qui n'avaient rien à faire durant cette
période de l'année. Ils se sont donc empressés de lui offrir de la lui louer
pour le temps des sucres. Donc, à chaque jour nous voyions passer nos trois
compères: Edgar, Dominique et Bertrand, qui étaient la plupart de temps
suivis de leur petit frère Léo, et d'un beau chien collie doré. Un soir
lorsqu'ils retournaient à la maison, je les vis passer avec un chien noir et
ceci piqua ma curiosité. Le lendemain matin je les attendais car je désirais
avoir le plaisir de faire connaissance avec ce nouveau chien. Je fus surpris
de constater que ce beau chien noir déteignait lorsque je le flattais. On a
bien ri de mes mains noires, et j'ai compris que mes trois oncles que je
croyais adultes sérieux, s'adonnaient encore à des jeux ridicules, que nous
les enfants, n'osaient même pas faire. Bien sûr, je les avais vus jouer à se
salir avec de la suie de la cheminée quand ils étaient venus à notre cabane.
C'était les jeux de jeunes amoureux qui s'agacent ; mais le chien! Cela
dépassait mon entendement.
L`érablière des Rioux étant
encore plus loin que celle de l'oncle Omer, il nous était impossible de
visiter nos oncles durant le printemps. Surtout que le printemps ne dure pas
longtemps lorsque nous n'avons que les samedis et les dimanches de
disponibles. Heureusement que je pouvais aller leur parler chaque matin et
chaque soir lorsqu'ils passaient par chez-nous, car pour moi, mes oncles
étaient un peu comme de grands frères, à qui je vouais une grande affection
et surtout une grande admiration. Ces gars déjà adultes connaissaient des
tas de choses, que déjà j'anticipais apprendre à mon tour. Même quarante ou
cinquante ans plus tard, alors qu’on ne se voit que très peu souvent, rien
n'a changé; je suis toujours le petit gars à Yvette et ils sont toujours
comme mes grands frères. Quelle belle famille!
Ce printemps-là, je n'avais
pas pu aller visiter cette érablière, mais j'y étais déjà allé. Un samedi
d'hiver lorsque papa bûchait avec Omer, chez Omer; Viateur, Germain,
Jean-Paul et Fernand Gagnon et moi étions allés glisser dans l'horrible
grande côte chez Omer. Côte dans laquelle les hommes avaient ouvert
un chemin pour le charroyage du bois qu'ils étaient en train de couper. Ce
chemin qui faisait un canal profond dans la neige devenait pour nos
traîneaux une glissade rapide et sécuritaire. Mais comme j'étais curieux et
que j'étais toujours le leader du groupe, j'avais entraîné les autres à
venir visiter la cabane d'Omer Ouellet avec moi. Même s'il avait fallu
parcourir ces quelques arpents, aller et retour, en marchant dans la neige
jusqu'au ventre; la curiosité l'emportait sur l'effort. La cabane n'était
pas barrée, car je n'ai aucun souvenir que des barrures quelconque aient
existé dans mon enfance; encore moins pour les portes des cabanes à sucre.
Omer Ouellet y avait construit une belle cuisine avec armoires de rangement
et une table, des bancs, un poêle, et toute la vaisselle nécessaire bien
rangée. Nous y avions aussi trouvé une grosse boite d'allumettes de bois
comme on en utilisait partout dans ce temps-là. Comme tous les enfants
curieux et fascinés par les allumettes, j'ai pris la boite, l'ai ouverte
pour voir s'il en restait dedans. J'ai constaté qu'elles étaient très
humides. Alors nous avons essayé de les faire allumer, mais sans succès.
Munis de l'inconscience de tous les enfants et n'ayant aucunement l'idée d'y
mettre le feu, car j’en connaissais très bien le danger et les conséquences,
nous avons laissé traîner les allumettes qui n'avaient évidemment pas pris
feu, et nous avons bien pris soin de refermer la porte correctement en
repartant. Quand Omer revint à la cabane et qu'il vit les allumettes, il
crut que peut-être quelqu'un avait essayé d'y mettre le feu; ce qui semblait
invraisemblable. Mais pour confirmer ce qu'il croyait le plus vraisemblable,
il demanda à nos parents s'il eut été possible que leurs enfants se soient
rendus visiter sa cabane. Aucun de nous n'a osé trahir ce secret que nous
savions être une chose banale. Les allumettes auraient-elles été sèches, que
jamais nous n'aurions eu l'idée d'essayer de les allumer. Aussi nous
savions que si nos parents avaient découvert que nous étions les auteurs de
cet incident, il s'en serait suivi des histoires que nous ne voulions pas
vivre.
Lorsque j'étais très jeune, on
cueillait l'eau d'érable à pieds lorsque la neige était dure, et nous
chaussions les raquettes lorsqu'elle devenait fondante. Nous utilisions des
chaudières de bois comme cela se fait encore aujourd'hui à quelques
endroits. Par contre, on transportait l'eau avec des traîneaux tirés par les
hommes. On fixait un baril de vingt gallons sur un traîneau, qu'un homme,
marchant en raquettes devait tirer ou retenir selon le relief; au grand
déploiement de toutes ses forces. Cela comportait de grands dangers et tous
les jours ne se passaient pas sans incident. Je me souviens que nous devions
pelleter un chemin en diagonale à travers cette grande côte en face de la
cabane; afin de réussir à descendre cet attelage chargé d'eau, et
l'acheminer jusqu'à destination ; le réservoir qui alimente l'évaporateur.
Siméon, qui avait empli son
baril s'apprêtait à gravir lentement le chemin en diagonale de la pente
abrupte. Il était attaché solidement à ses menoires, dans une
imitation parfaite de l'attelage du cheval (à l'exception des attelages de
chien qui étaient très semblables, nous n'avions pas d'autres modèles sur
qui nous pouvions copier) et il était placé en position pour retenir sa
charge qui, il s'en doutait, le pousserait de toute sa pesanteur.
Normalement cela ne lui causait pas de problème mais ce jour là, la neige
était plus douce et donc plus glissante qu'à l'accoutumée, et cela
bien sûr, confirmait ses craintes. Dès que la charge derrière lui (beaucoup
plus lourde que son propre poids) s'engagea dans la descente, Siméon était
incapable de la retenir et ses raquettes lui servaient maintenant de ski (et
considérant la situation dans laquelle il se trouvait filant à grande
allure) il se préparait mentalement et physiquement à ne pas manquer la
courbe, très prononcée vers la droite, juste au bas de la pente. Sinon il
avait toutes les chances d'aller faire la bise à un de ces gros érables qui
l'attendaient en bas --à bras ouverts--. Il a réussi sans accident. Mais la
peur que ressent l'homme traqué, pris au piège par les éléments, qui doit,
durant quelques éternels instants jouer, le tout pour le tout, pour assurer
sa survie, le faisait trembler de tous ses muscles. Ses jambes, renforcées
par l’adrénaline, qui n'avaient pas cédé durant toute cette dangereuse
descente au rendez-vous incertain, ne le supportaient plus. Jeune homme
d'expérience et déjà endurci par la vie difficile de son époque, il ne lui
fallu que quelques secondes pour repartir, ajoutant ainsi à son crédit un
autre gain contre les évènements.
Ce n'était pas tout de
cueillir l'eau; il fallait d'abord entailler, transporter des piles de
chaudières de zinc très lourdes insérées les unes dans les autres. C'était
avant l'arrivée des nouvelles chaudières d'aluminium. Ces contenants
n'étaient que d'un gallon (4.5 litres), difficiles à laver et à entretenir.
Le métal sensible à la chaleur du soleil ne conservait pas longtemps la
fraîcheur de l'eau. Les chaudières d'aluminium, plus grandes, un gallon et
demi, plus légères aussi, améliorèrent grandement la manutention de l'eau.
De plus, l'aluminium étant un métal transporteur de froid, il conserve plus
longtemps la fraîcheur de l'eau.
Une autre amélioration
importante se produisit lors de l'arrivée des évaporateurs. Ces gros poêles
servant à faire bouillir l'eau jusqu'à ce que l'ébullition donne un produit
fini respectant un pourcentage de sucre, déterminé selon les besoins; soit
qu'on veuille en faire un simple sirop ou encore d'autres produits. Ces
évaporateurs modernes remplaçaient les anciennes bouilloires qui n'étaient
que de grandes casseroles à fonds plats et de dimensions variées selon les
besoins des acériculteurs, (c'est-à-dire; selon le nombre d'érables
entaillés dans une érablière donnée) que l'on couchait sur un poêle dont la
structure ressemblait beaucoup à leurs successeurs. Mais, étant donné la
forme du fond de la casserole, l'espace par où passait la flamme était
beaucoup plus grande, et l'intensité de la chaleur se perdait dans le tuyau
servant de cheminée. Je me souviens que lorsque l'eau coulait plus
abondamment, papa ou Siméon, devaient à tour de rôle coucher à la cabane
pour faire bouillir 24 heures sur 24.
L'évaporateur lui,
accomplissait en quatre ou cinq heures ce que la vieille casserole faisait
en 24 heures. Sa bouilloire divisée en quatre sections reliées par des
siphons amovibles, au besoin, recevait l'eau par l'arrière, en provenance du
réservoir, et la transférait vers l'avant via ces siphons, à mesure que
s'accomplissait l'ébullition. De cette façon, l'eau fraîche ne se mêlait
jamais au liquide, dont une partie de l'eau avait déjà été extraite, et qui
devenait de plus en plus sucrée vers l'avant, là où le concentré devient le
produit fini qu'on appelle sirop.
Le principe de l'évaporateur
est que seule la casserole avant est à fond plat. Les autres sont munies de
dents de plus en plus profondes de l'avant vers l'arrière qui comme un
radiateur laissent passer à travers elles les flammes qui sont tirées par
l'énorme cheminée. Ces genres de doigts d'environ un pouce et demi de
large, remplis d'eau, comprennent des espaces d'un pouce et demi également
qui laissent passer les flammes, permettant ainsi à l'eau, un contact direct
avec le feu; provoquant ainsi une ébullition très rapide. Ces méthodes de
division de l'eau fraîche et du concentré, ainsi que la rapidité de
l'ébullition, évitent de bouillir deux fois la même eau, assurant ainsi une
qualité supérieure du produit fini.
L'arrivée des chaudières
d'aluminium et de l'évaporateur constituait de grands changements. Et, le
modernisme n'arrive jamais seul. Les chaudières plus grandes obligèrent
l'acériculteur à cueillir l'eau à l'aide d'un cheval pouvant tirer un plus
grand baril, (barils de vin en chêne, appelés tonnes de 45 gallons) sur un
traîneau. L'utilisation du cheval obligeait aussi l'entretien d'un chemin
carrossable jusqu'à la cabane. Ensuite, il fallait ouvrir des chemins à
travers l'érablière; permettant ainsi à l'homme muni de raquettes, de
transporter un seau d'environ cinq gallons, sans avoir à marcher trop loin,
avant de pouvoir vider son contenu dans le baril tiré par le cheval.
Presque à tous les printemps,
la neige trop abondante dans ce coin de pays, et les épaisseurs de verglas
qui s'y était accumulé et conservé intact, empêchait souvent le cheval de
battre seul son chemin. La moitié de son corps s'enfonçait dans la neige de
surface, plus volage, et ses pattes prises dans les couches de verglas
successives, le forçaient à s'immobiliser; sinon il risquait de se casser
une patte, et son instinct l'en avertissait. Il fallait donc le dégager à
l'aide d'une pelle jusqu'à ce qu'il puisse se libérer. Il ne bougeait pas, à
moins que son maître ne l'en oblige, et je me souviens que mon père
respectait l'instinct de ses chevaux, qui eux aussi, réciproquement, avaient
entière confiance en lui. C'est probablement une des raisons pourquoi, il
n'a jamais aimé la mécanique, avec laquelle il ne pouvait avoir de
complicité mutuelle.
Bien sûr, le cheval possède un
instinct remarquable, et très souvent, ne fait qu'un avec son maître. Si le
maître et le cheval se font mutuellement confiance, le cheval ira où il sera
conduit. S'il ne peut aller plus loin, soit parce qu'il est fatigué ou,
qu’il sente qu'il est inutile d'essayer de bouger; il tournera la tête,
regardera son maître comme pour lui demander son approbation. Doit-il
encore essayer ou est-il préférable de ne plus risquer? Voyant s'approcher
son maître avec sa pelle, il n'a pas peur de se faire rudoyer. Bien au
contraire! Il reste calme et se repose pendant que son complice lui dégage
les membres de leur emprise. Lorsque le cheval est libéré, et que l'homme
reprend son souffle, il attend ses quelques tapes d'affection sur le cou ou
sur la croupe, et parfois, quelques bons mots d'encouragement avant de
repartir.
Mon père n'aimait pas ses
chevaux; il les adorait. Il les nourrissait bien, les brossait, les
flattait, leur parlait et leur faisait confiance. Il les connaissait bien,
savait de quoi chacun était capable; il les poussait souvent au maximum,
mais jamais il n'abusait d'eux. Je me souviens de Poney, ce petit cheval
rouge d'à peine mille livres, qui durant des années, nous a donné
généreusement le meilleur de lui-même. Un jour il était malade et il regarda
papa avec ses grands yeux mélancoliques, il avait l'air de dire, soigne-moi,
je suis malade. Papa alla aiguiser son couteau, entra dans l'enclos, lui
parla et le flatta. Il lui disait, n'ait pas peur mon Poney, je vais te
soigner, je ne te ferai pas mal, demain tu vas être bien, etc. Poney appuya
sa tête sur l'épaule de papa qui lui fit quelques incisions et enleva
l'abcès qui le faisait souffrir juste au bas du collier sur le poitrail; il
enduit la blessure d'un corps gras et referma la plaie. Ensuite il pratiqua
une incision sur la queue et lui fit perdre plusieurs pintes de sang afin
que le sang nouveau purifie son système. Le lendemain Poney était plein
d'énergie et retournait travailler. L'homme et l'animal dans leur
instinctive complicité mutuelle, avaient encore une fois gagné leur pari, en
se mettant tous les deux au service l'un de l'autre.
Pour éviter que le cheval se
retrouve trop souvent dans une position favorable aux blessures; (comme cela
arrivait souvent aux chevaux qui n'avaient pas encore acquis cette
expérience et, avec qui il fallait être beaucoup plus attentif) on devait
pelleter un canal de quelques pieds de profond, là où la neige était trop
épaisse, et s'efforcer de rompre quelques couches de verglas. Ceci
constituait un travail énorme, qui nécessitait beaucoup de main d’œuvre et
des jours de travail. D'ailleurs, il fallait attendre que le soleil de
l'après-midi et le temps doux amollisse la neige; la rendant malléable
pour la pelle, comme pour le cheval. Très souvent aussi, il fallait que les
hommes foulent la neige sur de grandes longueurs, là où le cheval n'y
pouvait rien.
Lorsque le cheval avait fait
ses pistes sur tous les parcours, on l'attelait à un traîneau, et lui
faisait fouler tous les chemins. Ceci, afin de les rendre carrossables, pour
transporter d'éventuelles tonnes d'eau à la cabane, dès que les érables
commenceraient à couler. Lorsque ces préparatifs sont complétés, on cueille
l'eau. La récolte s'appelle le sirop et le sucre, et déjà on a invité la
parenté, la famille de maman, à une fête à sucre.
Les Rioux n'ont pas
d'érablière, ça va leur faire plaisir, ainsi qu'à nous les enfants, qui
serons fiers de leur montrer toutes ces nouveautés. Car si on peut
maintenant inviter une grande famille, c'est qu'on a une plus grande cabane;
devenue nécessaire pour compléter la modernisation. Papa avait aussi doté
ses installations d'une cuisine avec armoires, et, un poêle à bois qu'on
avait amené de la maison, après l'avoir remplacé par celui qu'on avait
acheté de l'oncle Pierre Bélanger.
Un jour l'oncle Pierre dit à
papa qu'il avait acheté ou hérité d'un nouveau poêle plus nouveau et plus
moderne que le sien. Mais le sien était déjà beaucoup plus moderne que le
nôtre. Le nôtre était un de ces anciens poêles à bois, monté sur pattes et
châssis en fer chromé, tout arrondi, avec plein de dessins dans le métal.
Tout le reste du poêle était fait ainsi. La porte du four, les portes où on
mettait le bois, et celle où l'on retirait la cendre. Même la corniche et
le réchaud étaient décorés de ce métal incrusté de dessins. C'était très
beau et très lourd à la fois. Mais, si on n'avait pas à le déménager, il
semble que le plancher ne s'en plaignait pas. Celui de l'oncle Pierre était
d'une génération plus nouvelle. Il était entouré d'une tôle émaillée
blanche, jusqu’à environ quatre pouces de terre, pour laisser place au coup
de pied, qui lui, était peint en noir. La corniche et le réchaud étaient
également fabriqués de la même façon. C'était encore la nouveauté de
l'heure; il faut dire que dans ce temps-là, les choses ne changeaient pas
aussi vite et aussi souvent qu'aujourd'hui. La mode était beaucoup moins
exigeante que aujourd'hui. Papa attela son cheval à un bob-sleigh ;
sur lequel on installait une plate-forme, permettant de transporter nombre
d'autres choses; comme par exemple un poêle de cuisine, et comme cela était
souvent son habitude, il amena avec lui quelques-uns des enfants. En
l’occurrence, Viateur et Germain. Je n'avais pu y aller, je ne sais pour
quelle raison.
Les deux acolytes avaient été
bien impressionnés par ce voyage. Primo, c'était très loin avec un cheval en
hiver (de parcourir cette longue route, pour se rendre au deuxième de
St-Fabien, à l'est de la paroisse, et en revenir). Secondo, c'était la
première fois qu'ils voyaient Lucien (Ti'Luc), qui avait été affligé de la
Poliomyélite, et dont l'un de ses bras ne grandissait plus au même rythme
que l'autre.
Son bras, à partir du coude
n'était qu'à la grosseur de l'os. Les nerfs étaient si petits qu'ils ne
laissaient passer presque aucune force. Cet enfant s'était habitué à
composer avec son infirmité, et il se débrouillait très bien; à tel point
qu'un jour il était venu installer des convoyeurs derrière les comptoirs
d'Air Canada à l'aéroport de Québec. Durant les trois jours où il a
travaillé parmi mes copains et copines de travail, personne ne s'est aperçu
de son infirmité; même moi qui le savais, je l'oubliais. Viateur et Germain
étaient restés marqués par ce bras différent, cela dépassait leur
entendement. Le poêle fut quand même amené à la maison et il prit place dans
la cuisine, là où était son ancêtre. Ce dernier continua sa carrière à la
cabane à sucre dès que les chemins permirent son transport vers ses nouveaux
horizons.
Il n'était pas facile de
transporter d'aussi lourdes cargaisons de la maison vers la cabane. On avait
l'habitude de faire exactement le contraire, c'est-à-dire; qu'on
transportait généralement du bois, à partir de différents endroits, depuis
le fronteau (trait carré) de la terre jusqu'aux bâtiments. Mais ceci se
faisait toujours dans le sens des côtes; en descendant, car les montagnes
des Appalaches penchent presque exclusivement vers le nord; vers le fleuve.
Alors pour aller à la cabane, on disait monter à la cabane. Il faillait donc
monter les côtes avec une voiture chargée contrairement à l'habitude, et
cela était très dur pour les chevaux; spécialement les nôtres qui étaient de
petits chevaux. Mon père les préférait aux gros, pour leur vigueur et leur
résistance, mais lorsqu'il fallait beaucoup de poids pour améliorer la
traction, les petits chevaux n'étaient plus à la hauteur.
Le vieux poêle prit la place
qu'on lui avait désignée dans la nouvelle cuisine. Il semblait tout fier de
pouvoir être encore de service pour plusieurs années; tout en se sentant
plus apprécié qu'il ne l'avait été, là où on l'avait pris pour acquis
durant de nombreuses années. Là où on lui faisait sentir qu'il était déjà un
peu vieillot.
On avait dû aussi libérer
l'espace dans la vieille cabane pour faire place au nouvel évaporateur. De
plus avec ce genre d'engin moderne et efficace, il fallait un grand
réservoir d'au moins 200 gallons, comme réserve d’eau. L'espace disponible
étant occupé par le bois de chauffage, il fallut construire une extension du
côté nord, qui servit de remise à bois. L'autre extension du côté sud
servait de cuisine. En plus du poêle à bois et des armoires, nous avions une
table et des chaises, et un grand banc, qui s'avérait très utile lorsque
nous recevions des invités. Nous avions aussi un autre petit poêle que l'on
utilisait pour faire bouillir le sirop pour le façonner en sucre, car dans
le bas St-Laurent, dans ce temps-là, nous vendions surtout le sucre dur et
très peu de sirop.
Par un des plus beaux
samedis du printemps, les Rioux s'amenèrent. Ils étaient aux moins une
vingtaine. Les gars et les filles, accompagnés de leurs amis, et les autres,
de leurs maris ou de leurs femmes. Ce fut un beau jour! Chacun avait réussi
à noircir la face de l'autre avec de la suie (façon de s'amuser à ces jeux
de jeunesse, pour mieux se prouver son affection et sa bravoure) Ils
avaient tous, été très braves, car ils étaient tout noirs, sans fausse
modestie et sans rancune. Le réduit (concentré juste avant qu'il devienne
sirop, dans lequel on trempe des bouchées de pain qu'on déguste chaud)
était bon et à point ainsi que la tire sur la neige et le sucre. Tous
trempaient la palette dans le sirop bouillant et les amoureux, faute de
pouvoir s'embrasser exagérément, se partageait la même palette avec délice.
Les «beans»
et le pain de ménage avaient été dévorés avec enthousiasme, et aucun ne se
plaignait d'indigestion, après une journée d'activités aussi intenses.
La cabane à sucre est probablement
et à juste titre l'endroit qui rappelle à tous les enfants de la campagne,
petits et grands, les plus beaux souvenirs d'enfance et de jeunesse. Je ne
me souviens pas être allé à la cabane une seule fois à reculons. Chaque
fois, ce fut un plaisir. Pourtant, c'est un travail dur, dans des conditions
difficiles. Les revenus sont médiocres et l'investissement important. Bien
sûr ces derniers critères ne concernent pas les enfants mais je n'arrive
quand même pas à comprendre pourquoi la cabane à sucre attire tant les
enfants; ceux d'aujourd'hui comme ceux d'autrefois, ceux de la ville comme
ceux de la campagne. Il y a sûrement là une façon unique de s'amuser, et de
se sentir en parfaite harmonie avec la nature, et ça, les enfants le sentent
et veulent le vivre.