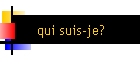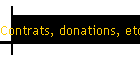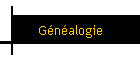|
Qui suis-je?
Acte de
naissance
Historique (résumé de mon histoire)
St-Mathieu,
Comté de Rimouski, Prov. Qué. Canada,
21 janvier
1938
Acte de naissance
de Fernand Thibault
Le vingt-deux janvier mil neuf cent
trente huit, nous prêtre soussigné, curé de cette paroisse, avons baptisé
Joseph Fernand, né la veille, fils légitime de Donat Thibault, journalier,
et de Yvette Rioux de cette paroisse. Parrain Philippe Rioux, marraine Domithilde Roussel, épouse du parrain, grands parents de l’enfant, qui ont
signé avec nous ainsi que le père. Lecture faite.
Philippe Rioux, Domithilde
Roussel
Donat Thibault Charles
Pelletier, Ptre, curé.
Paroisse de St-Mathieu, de Rimouski
Je suis né ce jour là, à la
maison, comme la plupart des enfants de ce temps-là. Je fus amené en ce
monde par une de ces nombreuses sages-femmes comme il en existait beaucoup
alors.
Je suis né à la maison comme
le voulait l’expression courante dans ce temps-là. Cette maison où je suis
né c’était celle de Ti’mond Jean et son épouse Alexina Fournier. Cet
automne-là mon père et Edmond Jean avaient décidé de partir pour les
chantiers. Donc ma mère aurait été seule dans la maison de Félix Rioux et,
Alexina seule chez-elle. Il y avait à ce moment-là des couples qui
attendaient de trouver un logis. Il s’agissait de mon oncle Donat Boucher et
Adrienne Thibault ou encore de Cyprien Bélanger, l’oncle de papa qui venait
de se marier justement à la fille de Félix Rioux. Maman a donc emménagé chez
son amie pour l’hiver. C’est donc là que je suis né dans la chambre coin sud
ouest de la maison. Plus tard ils déménagèrent dans la maison voisine et y
vécurent jusqu’au déménagement sur la ferme du quatrième ran


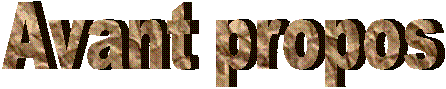
Ce résumé de mes souvenirs
depuis ma plus tendre enfance, constitue en fait mon autobiographie. Le
lecteur, spécialement s'il est quelqu'un qui a vécu cette période ou qui
fut témoin de ces évènements, n'aura pas à se formaliser si les souvenirs et
les situations que je décris ne sont pas exactement vrais ou précis. Car il
s'agit ici de souvenirs déjà lointains, que je décris de la façon dont
l'enfant que j'étais, à l'âge que j'avais, voyait et percevait ces
évènements ou situations et, analysait les conversations qu'il entendait.
J’écris ces histoires dans la façon typique et originale de s’exprimer
dans la région du Bas du Fleuve, qui m’a été enseignée par mes parents. Ce
n’est pas toujours correct grammaticalement, mais c’est comprenable.
Quant aux différentes expressions typiques de la région, je les mets en
italique, pour faciliter
la lecture. Je n'ai aucunement cherché à trouver la vraie histoire.
L'important pour moi, est de réussir à exprimer tout ce qui a besoin de
s'extérioriser depuis le plus profond de mon âme. Je le fais, peut-être par
besoin ou par égoïsme, je ne sais pas. Mais je le fais présentement pour moi
seul. Peut-être aussi pour laisser à mes enfants ce que nos ancêtres n'ont
pu nous laisser à nous; une histoire si difficile à découvrir, mais combien riche!
A bien y penser, je vais dédier cette histoire à mes enfants qui sont ma
raison de vivre, et à mes futurs petits enfants que j'aime déjà, même ceux
qui
ne sont pas encore nés.
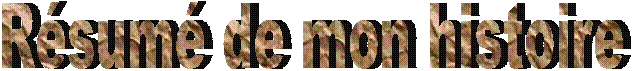
Le 4 janvier 1937.
C'est encore la grande
dépression de 1929 qui n'en finit plus; et qui n'a d'égal que la grande
misère qu'elle entraîne sur son chemin; cette SAINTE misère
contagieuse, qui n'épargnera aucune famille.
Mais, c'est bien connu, ni les
guerres ni les grandes dépressions n'arrêtent les cœurs des jeunes de battre
et de s'aimer, comme si la misère et l'insécurité ont pour effet de
rapprocher d'avantage ceux qui en sont les victimes.
Au beau milieu de ces temps
sans avenir où seul le désespoir semble présent et futur, Donat Thibault et
Yvette Rioux unissent leurs destinées par le mariage. Sans biens, sans
emploi et sans beaucoup d'espoir, entreprennent -croyant sans doute que le
Tout-puissant ne les laisseraient pas tomber- de fonder un foyer et d'y
élever une famille.
Cent dollars en poche! Tout
l'avoir de mes parents, et peut-être alors un montant considéré comme
raisonnable, devait leur assurer la survie jusqu'au jour où il serait
possible de trouver un emploi.
La chambre de mon père au
deuxième étage de la maison familiale devint à la fois le lieu intime et
l'appartement de mes parents; qui devaient aussi partager la table
familiale. Car mon père était jusque-là, celui qui avait pris charge de
cultiver la terre, et de nourrir la famille depuis le décès de son père en
1933.
Avec l'arrivée du printemps,
mon père réussit à dénicher un emploi chez les Dionne et Dionne de
St-Mathieu, à la fabrique de boites à beurre de Réal. Maman se souvient du
salaire journalier de 2.75$. Ils décidèrent donc de déménager au village de
St-Mathieu dans une maison appartenant à Félix Rioux. Le prix du loyer
était de 4.00$ par mois.
Plus tard, mes parents s'étant
liés d'amitié avec Edmond Jean (Ti’mond) et sa femme Alexina Fournier,
(fille d’Arthur) qui avaient fait l'acquisition d'une maison. (Maison qui
avait été construite par le père d’Edmond en 1925 lorsqu’il s’est installé
au village pour sa retraite, je suis né dans cette maison, dans la chambre
au coin sud-ouest). Ils décidèrent d'aller demeurer avec eux un certain temps,
indéfini; afin d'économiser quelques dollars. Mais la vraie raison était que
Timon et mon père avaient décidé de partir pour les chantiers (pour utiliser
une expression commune à cette époque) donc, il était logique que les deux
femmes demeurent ensemble pour s’entraider, soit à éviter soit à partager
l`ennui. Maman m’a raconté qu’elle et Alexina se mirent à pleurer comme des
Madeleines et qu’à la troisième journée, leurs hommes étaient revenus
bredouille et, elles avaient pleuré tout cela pour rien comme deux belles
folles! Mais les deux couples demeurèrent quand même ensemble durant tout
l’hiver; ce qui permit aux deux consœurs de développer une amitié qui durera
jusqu’à leur mort. Plus tard, la maison voisine devint libre, et mes
parents y emménagèrent jusqu'à ce qu'ils achètent la ferme du quatrième
rang.
Environ un an et quelques
poussières après ma naissance, qui eut lieu le 21 janvier 1938, une petite
fille est née. On l'avait appelée Olivette. Elle mourut trois jours après la
naissance, probablement d'une malformation au cœur ou de ce qu'on appelle un
cœur mou. Viateur aussi, est sûrement né dans cette maison, que j'ai
toujours appelée, la maison d'Auguste Thibault (aucune parenté connue, mais
après recherches j'ai découvert qu'il était lui aussi descendant de
Hilarion, le premier Thibault à s'installer à St-Simon, également notre
ancêtre) qui
en fut propriétaire par la suite jusqu'à sa mort.
Au printemps 1941 papa acheta
une petite terre côteuse, criblée de roches, au sud du lac, en face de la
route en provenance de St-Simon. Sans le sou et de santé très précaire, il
avait dû lutter très dur pour en obtenir le financement. Personne au comité
de crédit de la Caisse Populaire de St-Mathieu n'acceptait de lui faire
confiance ou de risquer de subir des pertes en lui prêtant de l'argent;
même sur hypothèque avec garantie, «à un homme malade». Seul Gérard Ouellet
(celui qui devint député créditiste du comté de Rimouski dans les années
soixante) lui accordait sa confiance et réussit à convaincre la majorité des
membres du comité. Je me souviens d'ailleurs de sa force de persuasion; sa
parole était presque un droit de veto. Papa obtint alors le prêt, et de tout
son orgueil et sa fierté, il entreprit de prouver à tous qu'il était un
homme de confiance. Le prêt de vingt-cinq ans fut remboursé en quatre ans; grâce à sa grande détermination et au bois de sciage, qui faisait la
richesse de cette petite terre montagneuse.
Quelques années plus tard,
Papa acheta un petit lopin de terre à l'extrémité sud-ouest du lac. La ligne
du coté est, n'était qu'à quelques cent pieds du ruisseau froid. C'était
aussi en face de la ferme de l'oncle Paul-Emile Beaulieu située du côté nord
du lac. On appelait ce lopin de terre, un circuit, probablement parce que
le sentier pour s'y rendre, sillonne le tour du lac vers le village de Ste-Françoise, bifurque ensuite vers la ville de Trois-Pistoles,
constituait ce que les ancêtres appelaient un circuit routier, qui donnait
accès à ces terres qui appartenaient jadis au grand fief de la seigneurie du
Seigneur Nicolas Rioux.
Quelques générations plus tard, c'est tout ce secteur qu'on avait surnommé,
le circuit. ( A la lecture de nombreux anciens contrats j’ai constaté que le
terme circuit s’appliquait bel et bien à cette sorte de petit lopin de
terre, à certains endroits, où il n’y avait plus entre deux rangs la
longueur nécessaire pour former des terres complètes. L’arpentage se faisait
à partir d’un cours d’eau majeur, eg, Le fleuve à Beaumont et la rivière
Boyer à St-Charles. Le rang des fiefs est coincé entre les deux rangées de
terre de quarante arpents de longueur. Les lopins de terre dans cette pointe
sont appelés des fiefs; un autre terme utilisé près de Québec, tout aussi
approprié et légal. (En vieux français les deux termes sont utilisés
différemment selon les régions. On disait aussi bien seigneuries et fiefs,
que l'on concédait à des seigneurs. En principe le rang des fiefs aurait dû
être concédé à un seul censitaire et porter le nom de son propriétaire, mais
ce ne fut jamais le cas, il a toujours fait partie de la seigneurie de
Beaumont qui s'étendait jusqu'aux limites de St-Gervais).
Ensuite papa acheta une terre
de Romuald Jean. Il n'y avait plus sur cette terre à cette époque ni
résidence ni résident. Il est possible qu'il n'y en ait jamais eu
d'ailleurs. Cette terre était située à l'ouest de la ferme principale
d'Edmond Dionne. Elle était bornée à l'ouest par le reste des terres
d'Edmond Dionne, qui se prolongeaient jusqu'à la Pointe du lac. Ces terres
et le circuit devaient représenter quelques quarante à cinquante arpents de
terre cultivée et peut-être une centaine d’arpents en forêt. De quoi
nourrir une douzaine de bêtes à cornes qui, avec quelques porcs et quelques
poules, sans oublier le grand potager, permettaient à une famille de vivre convenablement. A chaque printemps, l'érablière apportait aussi sa
petite, mais non moins importante contribution. Le bois de sciage et de
chauffage, quand à lui, permettait de rembourser les prêts hypothécaires
des années à l'avance.
Papa avait réalisé son plus
grand rêve; il était devenu un vrai bon cultivateur de son époque. Pour lui,
nulle autre profession n'était aussi noble tout en lui permettant de se
réaliser pleinement. Mais ses ambitions ne s'arrêtaient pas là. Il croyait
qu'il était possible d'acquérir une belle terre planche, et exempte de
roches, où il pourrait vivre de l'agriculture et non de la coupe du bois.
Après quelques années de
discussions avec ses frères et amis, un groupe de six formé des trois frères Ouellet; Omer, Réal et Mathieu, et de Siméon Thibault, Romuald Rioux et
mon père) se mit à la recherche de meilleures terres. Ils se laissèrent
tenter par la propagande de Duplessis qui voulait coloniser l'Abitibi à tout
prix. Ils allèrent visiter cette terre de Caïn oubliée par les Dieux. Les
frères Omer et Réal Ouellet ont mordu à l'appât. L’autre, Mathieu, ne se
décida pas. Accompagnant mon père, mon oncle Siméon et mon oncle Romuald
Rioux s'arrêtèrent visiter des terres à Beaumont, sur le chemin du retour.
Papa acheta à Beaumont. Mathieu acheta lui aussi à Beaumont quelques mois
plus tard, la dernière ferme du rang St-Roch ou la première dans Lauzon. A
l'exemple de ces deux compatriotes, Louis-Philippe Jean (un autre de leurs
amis de St-Mathieu influencé par leur décision) acheta lui aussi une ferme
à Beaumont dans les mois qui suivirent.
Dès le retour de papa, ce fut
l'euphorie pour nous, les enfants. La vente de la terre, la perspective du
déménagement, une nouvelle vie, de nouveaux amis, etc.
Mais pour les parents, qu'en
était-il ? Il fallait tout vendre; un lopin de terre à l'un, quelques
arpents de forêt à l'autre, la maison à un autre et ainsi de suite. Un
grand encan pour les instruments aratoires, les animaux (nos vaches
laitières étaient dans les mieux cotées de la paroisse selon leur
orgueilleux propriétaire) et tout ce qu'il ne serait pas possible de
déménager. Nous devions partir le 18 juin 1951, et tout devait être prêt
pour cette date. Il nous restait une vache que mon père n'avait pas
vendue parce qu'il ne pouvait se défaire de sa championne. Si je me
souviens bien, il en avait confié la garde à l'oncle Edgar en attendant
qu'il nous l'amène lui-même à Beaumont avec d'autres animaux que Papa lui
avait achetés. Alors dans la grosse "vanne" de Léo Théberge, nous
réussirent à charger tout le ménage de maison ainsi que la voiture couverte,
dont je ferai sûrement la description dans un autre chapitre, et moi je
voyageai dans la cabine avec Léo et son employé. Les neuf autres enfants,
(Lise avait alors 10 mois) papa et maman prirent place dans la Ford 1949
avec Bertrand Rioux, et le reste avec Léo.
Ma mère qui n'était pas allée
visiter cette nouvelle ferme avec mon père ne savait pas où elle s'en allait
ni dans quel genre de maison elle allait emménager. La Foi en Dieu, c`était
aussi la Foi en son mari. Dans ce temps-là, l'homme décidait et la femme
suivait, point! L'arrivée à Beaumont fut un choc pour elle. Elle regrettait
de ne pas être venue visiter, mais cela aurait-il changé quelque chose? Elle
n’avait encore jamais pris ou influencé une décision concernant leur vie
jusqu’à ce moment, et après tout, ce sont les hommes qui mènent ! Elle
sortait d’une maison dont le grenier venait d’être aménagé en chambres à
coucher pour les enfants. Nous avions l'eau courante et les toilettes et
certaines autres commodités. Maman avait laissé tout cela pour retrouver une ancienne
petite maison à demi finie, sans aucune commodité et, de plus il n’y avait
même pas de chambre pour coucher les enfants. Nous n'avions d'autre choix
que de vivre durant quelques temps dans ces conditions, bien qu'il fallu
rénover avant que l'hiver n'arrive.
Lévis Roy nous avait laissé
une seule vache. Et la plupart du temps quand nous allions pour la traire,
elle s'était déjà tétée elle-même. Il fallait donc aller acheter du lait des
voisins pour combler les grands besoins d’une famille de jeunes enfants.
Nous n'avions aucun revenu, et
il nous fallait vivre; en plus de tout rebâtir sur cette ferme délaissée.
Heureusement, c'était l'année de la reconstruction de la route 2, devenue la
132. Josaphat Morency, homme du parti de Duplessis dans la paroisse, avait
pris mon père en amitié dès le premier contact, alors que papa avait eu
recours à ses services et connaissances lorsqu'il était venu visiter les
terres à Beaumont la première fois. M. Morency était aussi ce qu’on appelait
encore en ce temps-là, un agent des terres. Aussi sa femme était une Rioux
de St-Simon que papa et maman connaissaient très bien; c’est pour cette
raison d’ailleurs qu’il s’était adressé à lui. Lorsque nous eûmes réussi à
nous installer convenablement, M. Morency vint offrir à mon père du travail
à la construction de la route; offre que papa accepta avec plaisir. Cet
argent nous permettrait de survivre jusqu'à l'hiver.
Le premier hiver on coupa (mon
père et moi, car on avait décidé qu'il était plus important d'utiliser mes
services pour faire vivre cette famille nombreuse que de me faire instruire
et en retirer les dividendes plus tard) deux cent cordes de bois de
chauffage; du beau hêtre bien sain, qu'on n'a eu aucune difficulté à vendre.
Mon père qui avait l’habitude de vivre des produits du bois s’était trouvé
béni d’avoir un peu de bois sur cette terre où la partie boisée était si
petite. C’était la comparaison avec les terres de St-Mathieu dont la partie
cultivée était de 25 pour cent et le reste en forêt. A Beaumont, c’était
exactement le contraire. Mais heureusement ce boisé n’avait pas été bûché
depuis très longtemps contrairement aux terres voisines qui ne pouvaient
faire plus que fournir le bois de chauffage nécessaire aux besoins de la
maison. Lui, pouvait au moins compter sur ce petit revenu d’appoint, et
combien important!
Le printemps venu, la fièvre
des sucres l’avait convaincu d’acheter l’équipement nécessaire pour
exploiter l’érablière. Il avait acheté un petit évaporateur Cantin de deux
pieds de largeur par huit pieds de longueur. Et, Lévis Roy qui travaillait
au Collège de Lévis avait ramassé pour nous 600 boites de conserves de
trois pintes. On n’avait qu’à enlever les couvercles et percer des trous
pour les accrocher au chalumeau. Et oups, on a fait du sucre et du sirop que
je suis allé vendre moi-même avec Viateur Blouin (alors deuxième voisin et
dont la femme Lucienne Marceau est devenue ma tante par alliance) à Lauzon
dans les rues de Gaulle et Ménard en particulier. On n’a pas fait fortune
mais c’était du profit net.
Avec le retour de la belle
saison, nous décidâmes que le seul moyen d'acquérir de l'expérience dans la
culture de la fraise était d'en planter de grands champs, même si ceci
constitue un investissement qui ne rapporte qu'un an plus tard. Cela ne nous
inquiétait pas car nous savions que l'an prochain et les années subséquentes
nous pourrions compter sur ces revenus importants.
Dès le printemps suivant,
Paulo Bégin vint informer papa qu'il serait intéressé à reprendre la culture
de sa ferme s'il pouvait compter sur notre aide. Papa a accepté; 0.70 $
l'heure pour lui et 30 cents pour moi (que j'étais fier! Être payé et
pouvoir conduire un tracteur, et en plus, il nous apportait des liqueurs
douces et des gâteaux). Nous avons bûché, labouré, semé, aménagé la grange
en porcherie et gardé des cochons, chargé et déchargé des camions de poches
de moulée, peinturé les granges, fait des clôtures, etc. A travers tout
cela, papa avait réussit à aider les Vallières (deux vieux garçons qui
demeuraient dans la maison tout près de la route St-Charles—la 25 à ce
moment-là ) à faire les foins pendant que nous, les petits gars, avions fait les
foins de presque tous les fiefs du bout du rang; que personne n'avait plus
le temps de cultiver. C'était bien le fun car nous avions le petit tracteur Farmall A, le moteur de côté, derrière lequel on accrochait les vieux
instruments pour chevaux qu'on avait modifiés. Les tracteurs des années
quarante ne faisaient que remplacer les chevaux, car, à l’exception des
tracteurs de marque Ford-Ferguson, aucun n’était muni de leviers
hydrauliques. On se contentait de modifier les instruments aratoires conçus
pour les chevaux et de les faire tirer par un cheval de fer, qui était plus
fort et plus endurant que le cheval de chair.
C'est quand même grâce à ces
petits gains et à l'effort de tous qu'on a survécu sans jamais manquer de
nourriture.
Au printemps 1954 l'idée vint
dans mon cerveau d'adolescent que je devais quitter la maison et me trouver
du travail. Était-ce par besoin d'indépendance, par besoin d'autonomie ou à
cause d'autres idées inconscientes qui sommeillaient dans ce cerveau
depuis longtemps? Je ne saurais dire. Ce fut très dur pour papa de me voir
partir. D'ailleurs je n'ai jamais oublié ce que j'ai vu, même de loin, sur
son visage, lorsque je suis parti. C'était la consternation, même si j'avais
décelé dans ses yeux une lueur d'espoir qu'il y avait une chance que je
revienne bredouille le soir même. Je m'étais promis de réussir ce jour là.
Je suis revenu le soir, mais ce n'était que pour repartir le lendemain
matin avec mon linge.
Je comprends aujourd'hui ce
que cela représentait pour lui. Il se sentait de plus en plus malade et
j'arrivais à l'âge où je pouvais prendre la relève, et sans qu'il s'en fut
douté un instant, tous les espoirs qu'il avait mis en moi s'écroulaient. Son
ulcère le faisait maintenant souffrir atrocement, et sentant qu'il ne
pouvait plus vivre longtemps comme ça, il opta pour l'opération, même si les
médecins lui prédisaient seulement 40% de chances de succès. La première
opération n’a pas réussi, et après la deuxième il y eut perforation des
tissus, ce qui l’entraîna dans la mort à la suite d'un excès de fièvre le 8
décembre 1954 à l'âge de 42 ans.
La saison d'été étant terminée
à l'Institution Mgr. Guay où j'avais travaillé depuis le printemps; on
m'avait licencié quelques semaines avant que papa entre à l'hôpital. Ceci
me permit d'aller seconder ma mère pendant ces semaines très dures pour
elle. Suite au décès de papa, le jeune homme de seize ans que j'étais,
aîné de la famille, fut accablé de responsabilités que j'aurais beaucoup de
difficultés à assumer encore aujourd'hui.
Cet hiver de 1954-55 je restai
à la maison, m'efforçant d'appliquer ce que j'avais appris avec les
spécialistes de cette grande ferme que possédaient les religieuses du Bon
Conseil pour assurer les besoins en nourriture des orphelins qu'elles
gardaient dans leur institution. Les animaux étaient soigneusement gardés,
et l'étable était d'une propreté impeccable. J'étais sûr de posséder la
vocation de fermier jusqu'à ce que je trouve un emploi dans un garage et
découvre jusqu'à quel point la mécanique me passionnait. Je continuai quand
même à cultiver la ferme le soir et les fins de semaines avec l'aide des
plus jeunes. Mais je ne pouvais laisser le garage car nous avions besoin de
ces revenus, si modestes fussent-ils! J'avais même changé le tracteur
avec François Goulet. J'avais acheté un Ford avec levier hydraulique, en
échange du vieux tracteur et de la petite jument. Le petit Prince quant à
lui était devenu trop vieux pour être échangé ou même utilisé pour
effectuer des tâches astreignantes. On le gardait parce qu'on l'aimait, on
avait développé des sentiments pour lui comme on en développe pour ses
frères et sœurs. On a dû le faire tuer l'année suivante avant qu’il ne meure
de vieillesse; on ne pouvait endurer de le voir souffrir.
A l'automne je fus encore
licencié du Garage Labrie à Beaumont. Alors pour gagner un peu d'argent,
j'allai bûcher avec Elzéar Bélanger. Elzéar était le frère d'Albert qui
demeurait dans notre rang, et aussi de ma blonde Lucille. Nous sommes
partis le 24 septembre pour un camp de bûcherons dans le parc des
Laurentides de l'autre côté de l'Étape. Le camp était situé sur le bord d'un
charmant petit lac. Nous pouvions voir les orignaux qui venaient s'abreuver
le matin près du camp. Nous pouvions aussi voir leurs pistes dans la belle
gelée blanche au lever du soleil. Nous nous levions dès cinq heures du
matin, et nous nous rendions immédiatement à la cuisine pour y prendre un
copieux déjeuner composé de fèves au lard (beans) et de pankakes
en plus du pain, des patates et des autres variétés qu'on nous offrait.
C'était les déjeuners typiques des travailleurs de la forêt. Dès midi, nous
étions revenus pour le dîner qui comprenait des variétés plus diversifiées
que les déjeuners, mais non moins lourdes. Nous aimions le camp et la
nourriture mais le bois était très mauvais. Il était donc impossible de se
faire des salaires convenables. Aussi après quelques jours nous repartîmes
et nous dirigeâmes vers les camps de la Rivière à Pierre, là où il y avait
un jobber que Elzéar connaissait. Le gars était bien sympathique et il
nous a offert de bûcher dans des boisés beaucoup plus avantageux que ceux
que nous avions connus au premier endroit. De plus, dès le souper, nous
avons rencontré Ti-Paul Leclerc et les deux frères Lacasse, qui tous trois,
demeuraient tout près de chez Elzéar à St-Gervais. Ces deux compères que nous
connaissions bien à l'époque nous ont rassurés sur la justesse de notre
choix, et dès le lendemain matin nous nous sommes mis à l’œuvre. Le
Jobber nous avait assigné à un boisé en bordure d'un lac dans une
petite colline pas trop abrupte où le bois était plaisant à bûcher. Même si
je n'avais pas l'expérience des chantiers, notre équipe avait réussi à
bûcher un petit peu plus que les Lacasse et aussi plus que les deux petits
Arseneault, Ghyslain et Jeannot qui sont demeurés mes amis depuis ce temps.
Mais, je n'ai pas développé de passion pour ce genre de vie. Un mois plus
tard, nous sommes revenus passer une fin de semaine à la maison comme
c'était la coutume pour Elzéar. Lui s'ennuyait de sa femme et de sa famille
et moi de Lucille. Une fois de retour, j'ai décidé que c'en était fait de ma
carrière de bûcheron.
Alors je pris le train et
me rendit à Montréal. J'allai demeurer chez Monique Rioux. Je trouvai un
travail de forcené dans un entrepôt du port de Montréal. On cherchait des
surhommes et je leur ai dit que je n'étais pas intéressé à briser les
records dans ce genre d'entreprises. J'avais déjà contacté Jos Thibault
(cousin de mon père qui, chaque année venait nous visiter à St-Mathieu
durant les vacances d’été) qui m'introduisit à un de ses amis qui était en
charge du garage de la compagnie Morgan's; devenue La Baie depuis. M.
Leblanc m'engagea sur le champ et je travaillai dans des conditions
excellentes tout l'hiver. Le printemps venu, un genre de fièvre s'empara de
moi et je fus incapable de demeurer à Montréal un jour de plus. Je laissai
l'emploi, qui achevait de toute façon, et je retournai chez-moi entailler
les érables et vérifier de plus près ce qui n'allait plus avec ma blonde
Lucille. J'ai découvert que quelqu'un (un frère de Camille Gagnon) m'avait
vu au Forum (j'étais allé voir les Ice Capades) avec ma petite cousine
Lucille Thibault, fille de Jos. Elle ne m'a jamais pardonné d'avoir parlé à
une autre fille et je n'ai jamais accepté cet excès de jalousie.
Pendant ce temps Viateur était
lui aussi arrivé à Montréal. Il pensionnait chez Jacques Delisle qui lui
avait trouvé un job d'apprentie plombier alors qu'il avait à peine 16 ans.
J'étais revenu à la maison
avec l'intention d'y cultiver la terre mais les revenus étaient si bas que
je dus retourner travailler dans un garage et continuer de cultiver la terre
les soirs et les fins de semaines avec l'aide de Germain et Jean-Yves alors
âgés d'environ 14 et 15 ans.
Cette année là, j'avais
travaillé dans un garage de la côte de la pente douce (rue Franklin) où le
propriétaire M. Hébert, voyant que je possédais un talent pour la mécanique
m'avait promis de faire de moi un bon mécanicien. Cela ne m'impressionnait
pas trop car je n'avais pas l'habitude de coller longtemps au même endroit.
Et j'avais raison. Deux mois plus tard, j'avais déniché un emploi de
mécanicien chez Tanguay Auto à Lévis. Et pour moi ce changement devenait
très important pour deux raisons en particulier. Premièrement; travailler
chez Tanguay permettait d'acquérir rapidement de l'expérience, grâce à un
personnel hautement qualifié et à l'outillage que possède un
concessionnaire, et pour moi, c'était aussi plus prestigieux. Deuxièmement,
je me rapprochais de chez-nous, ce qui d'une part allait m'économiser temps
et essence et d'autre part me laisserait plus de temps pour m'occuper de la
terre. A l'approche des Fêtes, M. Tanguay dut se résigner à mettre du
personnel au chômage en commençant bien sûr par les derniers arrivés dont je
faisais partie. Étant assuré de recevoir mes chèques de chômage durant
l'hiver, je n'avais pas à m'en faire. Je pouvais réussir à survivre avec un
gros 30.00$ par semaine. Donc, je m'en allai opérer le garage Fina à
Beaumont,-- alors loué par Anthonin Bilodeau de St-Lazare-- avec Alphonse
Blouin qui n'avait ni emploi ni endroit où demeurer. Une des deux toilettes
à l'extérieur lui servait de garde-robe, et un vieux camion panel lui
servait de chambre à coucher. La roulotte à patates frites et à hot-dogs
laissée dans la cour du garage, par Antonin Bilodeau nous servait à tous les
deux de cuisine. Le peu de travail que je trouvais auprès de ceux qui me
connaissaient et me confiaient leur voiture me permettait d'assurer ma
survie.
Dans le courant de l'été
suivant, je décidai de louer moi-même ce garage. Je vendais l'essence et
faisais la mécanique. Les premiers mois étaient encourageants. Mais lorsque
vint l'automne, je dus assumer les frais de chauffage et de déneigement.
Vers la fin décembre, il n'y avait plus d'essence dans les réservoirs et je
n'avais plus un sou pour les remplir. Il n'y avait que la machine à Coke qui
générait des profits que Germain, qui était avec moi durant toute cette
expérience, n'avait aucune difficulté à dépenser. C'était d'ailleurs le seul
salaire que j'ai réussi à lui verser. Le 21 janvier, jour de mon
anniversaire, bien sûr, je reçus une lettre de la compagnie Fina qui
m'avisait qu'elle devait annuler mon contrat de location. La station
fermerait en attendant de trouver un autre locataire. J'avais environ cinq
mille dollars de dette et deux mille dollars de comptes à recevoir, dont je
n'ai jamais collecté un seul sou. Au printemps, j'allai travailler pour
Laurie Martel qui possédait une station de service en face du garage Trans-Canada
à Lauzon. J'y faisais la mécanique en plus d'entretenir l’autobus d'écoliers
et souvent d’y servir de chauffeur.
Le commerce de Laurie Martel
qui était un mélange de garage, restaurant et bar clandestin, en plus des
autobus d'écoliers, rendait la vie intéressante. Je passai une très belle
saison à cet endroit, et je ne me souviens plus, pour quelle raison j'avais
quitté. Je retournai au chômage jusqu'à mon départ pour Sept-Iles.
Germain s'envola vers
Montréal à son tour, lui aussi apprenti plombier, suivant ainsi les traces
de son frère Viateur. A ce moment là, Viateur était retourné au travail
après sa longue convalescence causée par son genou fracturé lors d'une chute
de 45 pieds dans un trou d'ascenseur. Ils partagèrent le même appartement et
le même travail dans une station de service les fins de semaines, cela, en
plus de leur travail en plomberie.
Étant donné le handicap de
Jean-Yves, il ne nous était pas venu à l'idée qu'il pouvait être destiné à
un avenir prometteur. On lui a obtenu une pension avant même de lui chercher
un emploi qui lui convienne. Il fut très vif à réagir, se trouvant un emploi
et annulant de ce fait cette pension qui, automatiquement le qualifiait
d'invalide. Il a prouvé à tous depuis cette expérience que la détermination
et le courage ne souffrent jamais de handicap.
Béatrice étudia chez les sœurs
de Jésus-Marie et devint institutrice jusqu'à ce quelle se marie; trop
jeune, tout comme la plupart de ses nombreuses autres sœurs. Jacqueline
devint secrétaire jusqu'à son mariage. Nina, Claudette, Lise et Nicole
travaillèrent dans des super-marchés ; seules Lise et Nicole y sont
demeurées longtemps. Raymonde n'a pas dû travailler longtemps avant de se
marier, je ne m'en souviens pas, et Louisette a appris à faire des enfants
avant même d'apprendre quelque chose d’autre.
Maman se remaria en 1974 à
Philippe Asselin. Elle avait auparavant eu une relation très sérieuse avec
Adjutor Asselin (cousin de Philippe et de Jean-Baptiste) qui finit par
mourir des suites d'un accident de travail en 1973. Philippe s'introduisit
dans sa vie lors des funérailles d'Adjutor. Ils commencèrent à se fréquenter
quelques mois plus tard et leur mariage eut lieu en 1974.
Après qu'elle eut vendu la
ferme à Jean-Yves en 1971, Maman demeura dans un petit appartement à
St-Charles. Les dernières de la famille étant toutes parties, elle se
sentit entièrement libre de refaire sa vie; d'autant plus que Philippe
possédait une maison neuve et avait de quoi vivre à l'aise. De plus Philippe
était un grand-père idéal que tous nos enfants, qui n'avaient forcément pas
connu leur propre grand-père, ont tout de suite accepté et aimé, comme nous
tous d'ailleurs. Ce pauvre Philippe nous a quittés à la suite d'un cancer le
20 avril 1984.
Maman étant une personne qui
ne regarde qu'en avant, ne s'est pas attardée longtemps à ruminer sur ses
malheurs passés. Jean-Baptiste (frère de Philippe) avait perdu sa femme
depuis environ un an. Le hasard voulut que Jean-Baptiste ait, avec Maman,
autant d’affinités que Philippe, sinon beaucoup plus. Homme doux, attentif
et bon vivant, il n'eut pas de gros efforts à faire pour décider Maman à
faire un bout de chemin avec lui. Le 25 janvier 1986 Maman se remariait
pour la troisième fois. Maman et Jean-Baptiste ont eu la chance de vivre
treize ans de belle vieillesse ensemble. Tous deux étaient en très bonne
santé, rien ne les empêchait de sortir aussi souvent qu’ils en avaient le
goût, et on sait que maman était toujours prête à partir soit pour sortir ou
pour aller n’importe où, à dix ou à cinq cent kilomètres de chez-elle, cela
n’avait aucune importance. Quand ils eurent tous les deux passé le cap des
quatre-vingt ans, on les vit diminuer lentement. Maman avait des troubles
avec sa vue, à cause des cataractes. A cause de sa mauvaise vue, elle tomba et
se fractura la hanche. Elle fut plus tard opérée à un œil, ce qui améliora sa vue,
mais le glaucome continua de lui causer des problèmes périodiquement.
Jean-Baptiste qui venait d’une famille où on souffre d’asthme commença à
souffrir de cette maladie à son tour. Cela l’amena à souffrir d’insuffisance
cardiaque lui causant des oedèmes pulmonaires. Un jour il a dû être opéré à
l’aorte, il avait 84 ans. Les médecins l’ont cru en assez bonne condition
pour subir cette opération très délicate. Ils lui ont dit que c’était la
première fois qu’ils décidaient d’une si difficile opération sur un homme de
son âge, c’était à cause de sa bonne forme. L’orgueil l’a envahi et il s’en
vantait à tous. Il a assez bien survécu à l’opération mais une grippe
survenue quelques semaines plus tard, l’a amené dans la mort. Il mourut le 10
février 1999.
haut de page
Du village à la ferme
Lorsque j'eus trois ans et
quelques mois, mon père acheta une terre. La terre de Jean-Baptiste Jean,
qui lui, l'avait achetée de Félix Rioux. Cette terre du quatrième rang, au
sud du lac était située juste en face de la ferme d'Etienne Ouellet située
au nord du lac, et à environ un quart de mille à l'ouest du village. Ou
encore, depuis environ 1948, la route qui arrive de St-Simon arrive en ligne
droite avec la maison de nos voisins les Rousseau; c’est-à-dire, environ
trois à quatre cent pieds de notre maison.
Nous avons emménagé au sud du
lac au printemps 1941. Mon père, devenu co-propriétaire avec la Caisse
Populaire, était allé chercher un cheval, attelé à un "bob-sleigh"
pour transporter les quelques meubles que le jeune couple avait accumulés
depuis son mariage. Ce dont je me souviens particulièrement, c'est quand on
m'amena en voiture pour cette longue randonnée du village à la ferme. Ce
n’était qu’à quelques kilomètres, mais en hiver sur des chemins de neige
durcie, il fallait sûrement compter une bonne demi-heure de route. Pour un
enfant qui ne se souvenait pas avoir fait d’autre voyage avant et qui au
surplus avait hâte de voir où il vivrait dorénavant, cette randonnée lui
parut très longue.
Une maison nouvelle, ça
n'avait rien d'excitant. Mais, la grange! Il y avait des veaux naissants que
j'étais allé flatter dans leur enclos au grand plaisir de papa qui me
guidait et me rassurait de toute sa psychologie paternelle afin que je ne
m'effraie pas, Mais non! J'aimais les animaux; il y avait des poules, et
bien sûr des œufs, des cochons, de très petits et de très gros, des vaches
et des chevaux. J'étais émerveillé et ébloui à la vue de tant d'animaux. Je
n’étais pas né fils de cultivateur.
Si je me souviens bien, la
famille de Jean-Baptiste Jean n'était pas encore partie, et nous avons dû
partager la maison avec eux quelques jours. Cette maison était facile à
partager car elle comprenait deux parties; l'ancienne et la nouvelle.
L'ancienne partie était divisée en deux; d'un côté, une grande cuisine sans
évier ni chambre de bain; ce qui n'était pas inhabituel dans ce temps-là, et
l'autre partie, une grande chambre à coucher qui pouvait accueillir au moins
deux grands lits, et une garde-robe dans le coin. Donc, on pouvait y vivre
facilement, à condition d'utiliser au besoin l'évier dans la nouvelle
partie. Lorsque papa avait effectué des réparations à la vieille partie, il
avait trouvé dans les murs, servant d’isolant, de vieux journaux datés de
1918. La nouvelle partie, beaucoup plus récente, a dû être construite par
Félix Rioux au début des années 30.
Heureusement que l'hygiène
n'occupait pas dans ce temps-là la place qu'elle occupe aujourd'hui. Car les
tuyaux qui acheminaient l'eau courante à la maison gelaient en hiver, et
bien sûr, il fallait y puiser l'eau au ruisseau, avec des chaudières, pour
la consommation domestique. On s'accommodait très bien de ce système pour
les besoins de la cuisine. Heureusement qu'on ne connaissait pas encore les
douches et les bains car on aurait eu beaucoup de difficultés à se résigner
à faire sa toilette avec une débarbouillette et un bassin d'eau tiède dans
l'évier de cuisine. Cela manquait un peu d'intimité mais c'était quand même
un genre d'intimité sur lequel personne n'abusait indûment. Nous n'avions
pas encore connu d'ailleurs les toilettes à l'eau courante. Nous avions,
soit des bécosses à l'extérieur de la maison et l'hiver bien sûr, ces bons
vieux pots de chambre qui embaumaient de leur odeur ces vieilles maisons du bon vieux
temps.
La nouvelle partie était plus
grande. Il était évident que la première partie avait été construite par les
premiers défricheurs. Elle reflétait les besoins d'autres temps et d'une
civilisation déjà différente. Cette nouvelle partie était plus grande que
l'ancienne, mais elle était, elle aussi, divisée en deux. D'un côté; la
cuisine et une très grande salle à manger qui servait aussi de lieu de
séjour, comme c'était la mode du temps. De l'autre côté, une chambre à
coucher et un salon; qu'on utilisait aussi comme chambre à coucher,
spécialement l'hiver car les chambres dans l'ancienne partie étaient trop
difficiles à chauffer, avant que papa y installe une grosse fournaise au
bois dans la cave.
Les planchers étaient en
petites planches de bois franc, ce qui aurait été très joli si on les avait
vernis plus souvent, mais à quoi bon quand on a une trâlée d'enfants qui les
utilisent comme terrain de jeu? Le manque de vernis les faisait se salir
plus rapidement. Maman les lavait à l'eau et au savon fort, au moyen de
brosse à plancher, en frottant ardemment jusque dans le fond des petites
fentes entre les planches. Malheureusement, plus elle frottait, plus le bois
devenait terne et grisâtre.
Le poêle à bois était placé au
fond de la cuisine, à gauche entre la fenêtre nord, (vue-sur-le-lac !!!),
et la porte de la chambre des maîtres. La porte d'entrée principale arrivait
à la gauche de la cuisine face à l'escalier conduisant au deuxième étage;
sous lequel était placé l'escalier pour descendre à la cave. Cet escalier
droit aux nombreuses marches était muni d’une main courante de beau bois
franc.
Durant l'hiver, l'étage
supérieur n'ayant pas encore été fini à ce moment-là, nous devions fermer
l'ouverture avec une grande trappe. L'escalier ne servait plus qu'aux
nombreux enfants qui s'asseyaient dans les marches les uns en haut des
autres, bien placés pour voir ce qui se déroulait dans la cuisine, quand il
y avait quelqu'un à la maison. Et chez-nous, il y avait toujours des
visiteurs ; un voisin, un ami, un parent, nous n'étions jamais seuls.
Certains venaient se faire
couper les cheveux. D'autres venaient acheter du bois ou autre chose.
D'autres encore, venaient parler de coopération, de coopérative, de caisse
pop, de politique, de religion. D’autres enfin, venaient tout simplement
pour venir quérir les sages conseils de ce moraliste inné qu'était papa, et
sur qui, semblait reposer la responsabilité d'écouter, d'aider, de sécuriser
et remettre sur le bon chemin tous ceux qui vivaient des problèmes
nécessitant son aide. Je me souviens de sa grande disponibilité. Il n'a
jamais hésité non plus à s'interposer comme médiateur entre deux parties en
conflits. Dans sa jeunesse un certain prêtre se servait de lui pour
accomplir un apostolat laïque parmi une jeunesse qu'il croyait alors
dévergondée. Pour l'encourager, le prêtre l'appelait son apôtre. Fort de cet
appui, papa pratiqua longtemps un militantisme religieux zélé qui n'a eu
d'égal que son militantisme coopératif.
Chaque enfant s'asseyait dans
sa marche et, chaque année une nouvelle marche trouvait preneur. On a bien
ri des autres dans cet escalier. Notre proie préférée était le père Georges,
qui venait volontairement se faire remettre à sa place par mon père, après
qu’il savait avoir commis des erreurs impardonnables de père de famille,
avec ses garçons. Après s'être fait durement sermonner, il fredonnait ses
petites chansons, en essayant de digérer cette vérité qu'il était venu
chercher. Que de fois papa et maman ont été gênés de nous voir rire! Malgré
cela, nos hôtes ont toujours semblé demeurer très indifférents à l'égard de
ces petits comiques. Plusieurs années plus tard, lorsque nous étions à
Beaumont et que je prenais maintenant ma place sur une chaise, j'ai vu à
maintes reprises la même scène se reproduire de la même façon. La seule
différence était que maintenant, il ne s'agissait plus seulement du groupe
de garçons, mais aussi des petites filles qui étaient encore plus ricaneuses
que nous.
A la fin du printemps lorsque
les routes redevinrent carrossables, Jean-Baptiste Jean avait sorti du
hangar sa belle voiture de modèle carré, noire et à quatre portières,
semblable à toutes les voitures du temps. Cette voiture m'avait bien
impressionné pendant que les enfants de Jean-Baptiste se faisaient un fier
plaisir de me montrer tout ce qui pouvait intéresser le petit gars curieux
que j'étais.
haut de page
LES VOISINS
Les voisins; c'était en particulier les Rousseau. Les
Voisine, ce n'était pas les filles du voisin mais bien une famille du
village qui portait ce nom un peu bizarre bien avant que ce nom acquière
une notoriété internationale, grâce au chanteur Roch Voisine. L'autre voisin
immédiat du côté opposé était Edmond Dionne. On disait les Rousseau, et
Edmond Dionne, afin de ne pas confondre les familles de Dionne.
Les Rousseau étaient cette grande famille
qu'on disait de descendance
iroquoise (on disait iroquois mais j’en doute, il n’y a
presque jamais eu d’iroquois
dans le bas St-Laurent. J’ai lu qu’il y avait eu tour à tour les algonquins
et les hurons. Victor-Lévy Beaulieu parle des Malécites, je crois que je devrais parler d’Indiens ou comme on dit maintenant
d’Amérindiens) de par le père Georges, petit-fils d'indien pur, qui avait
conservé une partie des coutumes et traditions de son peuple: Coureur des
bois, trappeur, chasseur, il ne vivait pas du bois, mais tirait sa
subsistance dans les forêts. Comme presque tout le monde à cette époque, il
possédait sa ferme pour subvenir aux besoins de sa famille, mais pour lui,
c'était la chasse et la pêche, qui comblaient les besoins pécuniaires,
contrairement aux autres, pour qui c'était la coupe du bois.
Note: Je n'ai
rien trouvé qui justifie la thèse que les Rousseau venaient ou étaient de
descendance autochtone. Les Rousseau sont arrivés de France au dix-septième
siècle. C'est sûrement le fait que le père Georges et son père ayant été des
hommes de bois, de chasse et de pèche ont acquis des manières de vivre
comme les indiens qui a poussé la population à inventer cette fausseté.
Le père Georges, comme tout le monde l'avait surnommé, ne
s'adonnait pas très bien aux travaux de la terre. Il avait lui aussi
défriché, labouré, semé, irrigué, bûché et pris soin des animaux. Mais il
avait le cœur à la forêt. Dès que ses fils furent en âge de vaquer aux
travaux de la ferme, il leur confia de plus en plus de tâches pendant que
lui partait en forêt durant plusieurs jours; pour y revenir chargé de
fourrures. Ce qui lui rapportaient de meilleurs revenus que la production de
la ferme. Chargé d'un sac à dos plein de pièges, il pouvait demeurer en
forêt plusieurs jours; dormir à la belle étoile, et se nourrir d'animaux
sauvages; en un mot survivre dans les bois comme les indiens l'ont fait
durant des siècles. Il pouvait marcher durant des jours et parfois des
semaines sous le fardeau de son équipement de trappeur, et la récolte de ses
captures. Infatigable, la jambe sûre, il était son propre véhicule. Je l'ai
revu lorsqu'il avait 86 ans, après qu'on lui avait changé l'os de la hanche
pour un bout de plastique. Il avait demandé à Omer de le conduire au
quatrième, et de là, il effectuait encore une marche d'environ 12 milles
avec ses pièges sur le dos. Omer revenait le chercher quelques heures plus
tard. Il faisait cela presque tous les jours. Il est décédé à Trois-Pistoles,
dans un foyer pour personnes âgées à l'âge de 91 ans.
Mme Rousseau était issue de la seule famille de Boulanger
de St-Mathieu. Ses frères on dû quitter la paroisse en bas âge, car il n'y
avait plus aucun Boulanger dans la paroisse dans les années 40. Peut-être à
l'exception des vieux parents de Mme Rousseau, que j'ai bien connus avant
leur mort. Mme Rousseau tout comme sa fille Agnès--épouse d'Omer-- était une
personnalité discrète, effacée, retirée et engloutie dans son rôle de mère
de famille, dont elle s'est acquittée avec dévouement toute sa vie durant.
En plus d'avoir mis au monde et élevé une grande famille, elle garda ses
vieux parents à la maison durant les dernières années de leur vie. Je me
souviens qu'ils sont morts tous les deux à moins d'un an d'intervalle. Ils
devaient avoir dans les 80 ans. Ils nous semblaient si vieux--lorsqu'on
est
enfant-- qu'ils devaient avoir vécu depuis toujours. Ils n'ont pas quitté ce
monde tout à fait ensemble, pas plus qu'ils n'étaient arrivés ensemble.
Comme cela se passe dans la vie de plusieurs couples qui ont vécu
côte à côte durant 50 ou 60 ans, lorsque l'un
part, l'autre semble s'empresser d'aller rejoindre son défunt conjoint. Mme
Rousseau jouissait d’une santé extraordinaire. Malgré ses grossesses et
accouchements, elle n'a jamais
connu l'hôpital. Une gangrène l’a quand même obligée à se faire amputer un
pied jusqu'à la mi-jambe lorsqu'elle était au début de la soixantaine. Elle ne put s'habituer aux
béquilles et, elle fut confinée au fauteuil roulant pour le reste de ses
jours.
Note : Les Rousseau et les Boulanger étaient deux grosses
familles. Tous les enfants des deux familles à l’exception de Georges et de
Rose sont allés vivre aux USA comme plusieurs québécois
durant cette période.
Agnès me dit que la plupart des garçons sont revenus marier des filles de la
paroisse, parties vivre avec leur mari
pour ne jamais revenir.
Omer et Marie étaient les deux aînés. Lorsque nous sommes
arrivés au quatrième, Omer était déjà parti vivre à quelque part en
Matapédia. Bien qu'il soit sûrement revenu à la maison, je ne l'ai jamais
vu. Je l'ai rencontré chez Omer Thibault en 1979 à l'occasion du 60ième
anniversaire de mariage de ses parents. Lui et sa femme n'ont jamais eu
d'enfants et vivaient depuis de nombreuses années près de Montréal.(Dans
le Nord)
Marie, la grande Dame! C'est comme ça que je l'ai
toujours vue; quelle que soit l'occasion ou l'endroit, elle était toujours,
la grande Dame. Dotée d'une personnalité imposante, fière, humble, généreuse
et distinguée, elle donnait l'impression d'avoir été parachutée d'une autre
planète dans cette famille modeste et non instruite comme
les autres de son temps . Elle n'était pas faite pour
la forêt. Les grandes maisons luxueuses semblaient lui convenir davantage.
Elle n'était, par contre, ni snob ni hautaine. Au contraire, elle était
toujours prête à aider tout le monde et, elle était très chaleureuse. Elle
laissa même son emploi à Québec pour venir au chevet de son grand-père dans
les derniers mois de sa vie. Elle lui assura une présence de tous les
instants jusqu'à son dernier souffle; dispensant tous les soins requis auprès
d'un malade alité et incontinent attendant la mort. Elle s'acquittait de sa
tâche avec amour et humilité dans le décor simple d'une chambre de la
vieille maison aux murs de planches non peints; ce qui ne lui enlevait pas sa
dignité de grande Dame.
Un jour, elle épousa un monsieur Murphy, un homme de
petite taille, déjà beaucoup plus âgé qu'elle, de santé fragile,
fonctionnaire de carrière, issu de bonne famille du quartier St-Sacrement à
Québec. Je me souviens, rue des Érables, où elle demeurait. J’y suis allé
avec Omer Thibault. Le père Georges, au comble du bonheur à la pensée que sa fille
aînée, se marie, qu’elle ait su rencontrer un homme bien, de personnalité
agréable, mis en branle tous les préparatifs pour le grand jour. Le grand
ménage de tous les bâtiments fut exécuté avec plus de soins qu'à l'habitude.
Il avait chaulé la grange et les deux hangars si blancs, qu'il était
impossible de regarder les murs sous le soleil brillant. Il avait peint la
maison et les galeries, verni le buggy, astiqué les attelages des chevaux, à
l'huile et au brosso. Les chevaux, bien nourris, bien étrillés
complétaient le décor.
Comme d'habitude, les femmes avaient préparé plus de
nourriture qu'il n'en fallait. Succulentes soupes, viandes sauvages
et domestiques, tartes et gâteaux remplissaient les longues tables qu'on
avait aménagées dans les deux grandes chambres communicantes; salle de
réception pour l'occasion. Ce fut une journée mémorable où nous les enfants
n'avions manqué de rien pour satisfaire notre curiosité et remplir nos
estomacs de friandises et de bons desserts.
J'ai eu le bonheur de la revoir (Marie) à Québec vers les
années 1954 ou 1955, grâce à Omer qui rendait visite à sa belle-sœur
lorsqu'il venait à Québec pour rencontrer les fonctionnaires du ministère du
travail qui étaient responsables de lui fournir ses bras et crochets
artificiels. Il se rendait à Beaumont en autobus et de là je m'occupais de
lui.
Je l'ai revue
(Marie) comme tous les autres lors du 60ième
anniversaire de ses parents. A 58 ans, les cheveux blancs, elle n'avait rien
perdu de cette allure simple qui souvent caractérise les grandes
personnalités. J'ai causé longuement avec elle et je dois dire qu'elle m'a
simplement impressionné. Son savoir, ses connaissances et ses activités
l'avaient grandie, la réalisation de sa vraie personnalité s’était
accomplie.
Les autres, c'était d'abord, Agnès dont j'ai parlé dans
le mariage d'Omer, où j'en avais fait le portrait, je n'ai pas à y revenir.
Ensuite, c'était Mathieu, Benoît et henri. Mathieu et Henri se
ressemblaient, en ce sens qu'ils avaient tous deux cet héritage paternel, de
nature un peu sauvage, au sens positif du mot, tout comme Victor d'ailleurs, qui semble ne jamais
s'être adapté à la vie des villes même s'il y a vécu tout le reste de sa
vie.
Mathieu, travailleur énergique, fort physiquement, de
caractère déterminé, épousa Lucie Rioux, fille de l'oncle (noncque
Joseph, c’est comme ça que la famille Rioux appelaient leurs oncles),
Joseph donc, cousine de maman. Déterminé à accomplir le désir de Dieu et
d'obéir à son pasteur, il dépensa tous ses surplus d'énergie à pratiquer la
procréation avec cette jolie jeune femme séduisante qui semblait accueillir
avec ardeur cette responsabilité partagée.
Nous avons souvent entendu bien des conversations et des
chuchotements concernant les ébats amoureux de ces ceux tourtereaux. Le
bonheur débordait le confinement de la chambre à coucher. Les rires,
chuchotements et soupirs de satisfaction se faisaient entendre dans toute la
maison. Le bonheur était grand, il fallait le partager. La discrétion était
impossible. Car comme je l'ai déjà mentionné, ils demeuraient chez l'oncle Omer
Thibault qui leur avait loué un petit appartement au rez-de-chaussée de sa
maison, qui était composé d'un grand espace servant de salon et
cuisine-salle-à-manger, et d'une chambre à coucher adjacente à celle-ci.
L'hiver, Mathieu coupait du bois de sciage et du bois de
chauffage. Au printemps, il faisait les sucres de l'érablière de la terre à
Voisine, surnommée ainsi à cause du nom du dernier
propriétaire-cultivateur-résidant. Il avait vendu à Raoul Vignola, un
villageois qui ne s'y était installé que temporairement. Il vendit au père
Georges qui avait l'intention d'y installer un garçon et le hasard voulut
que ce soit Mathieu.
Environ six ou huit mois après leur mariage, Mathieu et
Lucie emménagèrent dans leur nouvelle demeure. Cette très petite terre ne
suffisait pas aux ambitions et aux besoins de Mathieu qui dut continuer de
travailler à l'extérieur. Il construisait des maisons et autres bâtiments en
plus d'accepter tous travaux de menuiserie qui lui étaient offerts.
Éventuellement, il vendit cette petite terre en tout ou
en partie ou la laissa se reboiser. Il acheta une bonne terre dans le bas de
la paroisse où il devint un bon cultivateur avec l'aide de ses nombreux
enfants; résultat de ses pratiques répétées et continues avec Lucie. Il
continua néanmoins à travailler dans la construction car d'une part sa santé
lui permettait de travailler dix-huit heures par jour et d'autre part, il
avait besoin de cet argent pour nourrir une famille qui se faisait de plus
en plus grande chaque année.
Dès qu'un de ses fils fut capable d'acheter la ferme,
Mathieu construisit une maison au village sur le terrain même de l’ancienne
petite maison de sa grand-mère, la veuve Ouellet, mère d'Etienne qui épousa
en deuxième noces Majorique Rousseau, père de Georges. Même le terrain était
devenu très petit après que le père Georges eut utilisé presque tout
l'espace vacant pour y asseoir sa grosse maison à deux logements faite de
blocs de ciment; ce qui était une première dans la paroisse.
(On est en 1948 ou 1949)
Mathieu et Lucie ont toujours été l'image du bonheur
malgré les années difficiles et les contraintes de la vie lorsqu’on élève
une grande famille. Ce fut un couple uni dont l'amour semble toujours frais
comme au premier jour. Ne se lassant pas l'un de l'autre, ils ont eux aussi,
traversé des jours maussades sans maugréer.
Ce petit bout de femme enjouée, rieuse, douce et
énergique, vivante, toujours débordante d'affection
--comme beaucoup d'autres
Rioux de la famille de maman-- possédait les plus belles jambes de la terre,
disait le père Georges, sur un ton de connaisseur. Lucie est "cousine-frérot"
de maman, une vraie Rioux avec tout ce que cela comporte de bon, dans cette
descendance dont je suis si fier de faire partie; sinon par le nom, au moins
par le sang.
Henri n'était que dans la jeune vingtaine quand nous
sommes partis en 1951. Le père Georges avait dû emménager dans sa nouvelle
maison, mais je ne me souviens pas comment Henri se débrouillait avec la
ferme en attendant de se trouver une femme. Plus de vingt ans plus tard
alors que j'étais en voyage dans le bas St-Laurent avec Yolande, je décidai
d'essayer de rencontrer Henri que je n'avais jamais revu. Je descendis donc
la grande montée, très à pic et étroite. Je constatai qu'il y avait là une
nouvelle maison qu'Henri avait construite. Henri n'y était pas,
seule sa femme et quelques enfants nous ont reçus.
Je me suis senti mal à l'aise. Je n'osais pas parler ni
même regarder. Je me sentais mal de voir ces gens qui m`étaient inconnus,
qui avaient l'air de me prendre pour un intrus, dans un endroit où j'avais
été chez-moi, bien avant qu'ils ne soient nés. Je ne pouvais plus penser. Je
suis reparti, à peine capable de dire bonjour. Je n'avais plus le goût de
voir Henri, je m'en allai.
Henri n'a jamais été plus cultivateur que son père. Et ce
n'est pas par amour de la terre qu'il a toujours refusé obstinément de
quitter son lieu de naissance. La municipalité et la commission scolaire ne
voulaient plus dépenser de fortes sommes d'argent pour entretenir la route
et transporter ses enfants à l'école. On lui a offert résidence et frais de
déménagement, mais rien n'y a fait. Il a prouvé à toute une population que
personne ne pouvait déloger une famille de ses racines, aussi longtemps
qu'il s'acquittait de ses responsabilités de contribuable.
A l'instar de son père, Henri n'avait pas l'intention de
gagner sa subsistance en tant qu'agriculteur. Par contre, il n'était presque
plus possible de gagner sa vie des produits de la chasse. Henri avait appris
très jeune à bûcher et c'est ce qu'il fit toute sa vie. Les quelques
produits de la ferme et ses revenus de bûcheron lui permirent de nourrir,
d'habiller sa famille, et de subsister bien pauvrement, à cause du trop
grand nombre de bouches à satisfaire. J'ai finalement revu Henri lors du
60ième anniversaire. Il était un vieux de 49 ans, fatigué
et déjà usé.
Benoît qui dépassait les 50 ans lors du 60ième
anniversaire était déjà au cœur de sa deuxième carrière. Homme doté d'une
personnalité attachante et généreuse, il avait aussi beaucoup de facilité à
communiquer et à comprendre les humains. Ayant terminé une carrière dans les
forces armées, il était maintenant directeur du personnel dans un hôpital
d'Ottawa. Il est le seul de la famille qu’on aurait pu comparer à Marie.
Benoît n'avait pas le goût de la terre ni de la forêt. Il
fut le premier de la famille à n'avoir qu'une chose en tête;
acquérir une
éducation. Il fit sa huitième et neuvième année au couvent de la paroisse,
et ensuite, continua ses études au collège de Rimouski. Son goût de
l'aventure et la possibilité de parfaire son éducation dans les collèges
militaires le conduisit dans les rangs de l'Aviation Canadienne. Les Forces
lui permettaient de voyager, de vivre dans différentes villes, même sur
différents continents. De vivre aussi des expériences uniques, et d'acquérir
un bagage de connaissances à la hauteur de ses aspirations. Fort de son
talent et muni d'expériences valables, il pu obtenir son poste
d'administrateur à la fin de sa carrière militaire.
Ayant séjourné dans des milieux anglophones européens
autant que canadiens, il devint aussi à l'aise dans le monde anglophone que
francophone. Il épousa une britannique d'environ son âge et aussi de sa
taille même s'il mesure environ six pieds. Durant les quelques minutes où
nous avons jasé ensemble, je lui ai trouvé une très belle personnalité,
simple et naturelle, même si physiquement elle était loin d'être
jolie. J'ai
vu en elle une personne qui avait vécu de la même façon et pour les mêmes
raisons que Benoît. Tous les deux se sont rencontrés lorsqu'ils ont atteint
l'âge où l'on veut se caser et mettre un terme à la vie d'aventure; une
sorte de retraite, quoi?
Ils ont fini par divorcer plus tard et Benoît vie
maintenant avec une jolie dame dont il s’est empressé de nous montrer la
photo. Elle avait l’air d’être beaucoup plus jeune que lui mais il a fait
comme réplique, sourire en coin, que cela était le résultat de nombreuses
heures de maquillage.
Benoît était si différent du reste de la famille qu'on
aurait dit qu'il n'y avait entre lui et les autres aucun lien de parenté;
exception faite de Marie et Adèle, l'aînée et la cadette. Cécile et Alice,
qui suivaient Henri étaient destinées à devenir de bonnes
mères de famille et de bonnes fermières. Je les ai rencontrées, elles
aussi lors du 60ième anniversaire, et même si je les connaissais depuis ma
petite enfance, je ne les ai pas reconnues.
Irène, l’avant-dernière, qui n'a que cinq ans de plus que
moi, devint ma tante par son mariage avec Siméon
Thibault. Elle, c’était toute autre
chose. Nerveuse et pleine d'imagination, elle ne réussit pas à parler assez
rapidement pour suffire à la rapidité de son cerveau. Sûre d'elle en toutes
occasions, elle est douée d'une débrouillardise extraordinaire. Avec moi,
elle exerçait plutôt ses talents maternels, elle était en cinquième année
lorsque je commençai à fréquenter l'école du rang; elle s'occupa de moi
durant deux ans sans jamais faillir à sa tâche.
Préférée de son père qui lui accordait une confiance
aveugle et ne lui refusait rien, elle acquit, contrairement à Victor, une
assurance quasi exagérée. Elle aimait les chevaux en particulier et elle
savait les manier avec adresse. Atteler un cheval à une voiture est
normalement une tâche ardue pour une fille de douze ans. Mais, pour elle,
mettre la bride ou le collier n'était qu'un jeu. Elle aimait beaucoup les
animaux et la vie sur la ferme. Cela ne l'empêcha quand même pas de marier
une gars qui n'avait pas été élevé sur la ferme; et qui n'avait pas
l'intention de devenir cultivateur non plus; mon oncle Siméon. Elle était
prête à s'ennuyer de la terre pour épouser l'homme qu'elle aimait. Elle ne
pouvait pas se douter non plus que Siméon serait tué dans un accident à
peine trois ans plus tard. Il lui fallut de nombreuses années pour éponger
sa peine. Quelque dix ans plus tard, elle rencontrait un vrai cultivateur et
retournait finir ses jours sur une ferme.
Durant ses années de peine, elle se dédia exclusivement à
ses deux enfants. Son père, sympathique à son état d'âme lui céda la moitié
de sa grande maison, qu'elle habita jusqu'à ce qu'elle marie ce vieux
garçon, cultivateur, dont la personnalité était tout à l'opposé de sa beauté
physique. Il est le plus laid bonhomme que j’aie rencontré, mais sa
personnalité nous le faisait vite oublier.
Cet homme donnait à Irène la chance de refaire sa vie, de
réaliser son rêve de retourner sur une ferme, d'exercer à nouveau son rôle
maternel, en ayant d'autres enfants et de connaître à nouveau la vie à deux;
ce qui devait être très important pour une femme aussi chaleureuse qu'elle.
Une femme que la fatalité avait obligée aux privations (affectives) si longtemps ?
Cette femme d'expérience, forte, travailleuse, leader, a pu enfin réussir sa
vie grâce à cette petite terre côteuse et rocheuse de Squatec, exactement
comme celle sur laquelle elle avait été élevée.
Le père Georges avait très tôt décelé chez Irène ce
talent de conduire et ce besoin de dominer. Il pouvait compter sur elle;
aussi, il lui confiait des tâches qu'elle accomplissait bien. C'est elle qui
conduisait les enfants du rang à l'école l'hiver; en berlot. Elle se
rendait responsable de tout ce petit monde ainsi que du cheval qu'elle
devait dételer de la voiture, mettre dans la petite grange prêtée par
Alphonse Desjardins, et s'assurer qu'il ait de quoi manger et boire.
Tout cela se passait à l'école primaire avant qu'elle
n'atteigne treize ans. Elle était forte et parfois elle semblait même un peu
garçonnière. Mais quand elle voyait un garçon, toute la féminité instinctive
qu'elle possédait se dévoilait pour annoncer clairement ses talents de
séductrice. Les garçons étaient très rares dans ces rangs de campagne peu
peuplés. Aussi lorsque Siméon commença à venir chez-nous régulièrement, et
ensuite presque en permanence, elle ne lui donna pas la chance
de rencontrer d'autre fille. Elle attirait son attention par tous les moyens,
et elle ne lui donna pas de répit. Il était le seul garçon disponible, elle
l'aimait, elle le voulait, elle l'aurait. A l'époque, les anticonceptionnels
n'existaient pas, on ne couchait pas ensemble avant le mariage, mais elle
n'avait pas besoin de lui offrir la vie sexuelle pour le capturer et
s'assurer sa fidélité. Dans le langage du temps, on pouvait dire qu'elle
était ratoureuse. Siméon lui, qui n'était pas sûr qu'Irène fut bien la
sienne fit la rencontre d'une autre jeune fille qui lui plut beaucoup. Irène
a vite senti le froid, mais elle n'était pas femme à s'y laisser geler.
De toute la détermination de son tempérament intempestif
et dans ce cas possessif, elle n'hésita pas à prendre les choses en main et
à dominer la situation. Elle connaissait bien les faiblesses de Siméon qui
était bien plus un dominé (surtout par mon père, c'était évident) qu'un
dominant. Elle vint le chercher chez-nous et lui joua le jeu de l'ultimatum:
Ou il cesse de courir deux lièvres à la fois ou elle lui donne son congé.
Siméon, surpris de voir celle qui était menacée de perdre son amoureux lui
servir une telle semonce en perdit son latin et compris que la preuve en
était faite. C'était maintenant lui qui avait peur de la perdre. Siméon
savait qu'il aurait besoin dans la vie d'une femme comme elle; beaucoup de
cran et capable de décisions rapides. Car, il ne serait pas toujours sous
l'aile protectrice de son grand frère et idole Donat, à qui il vouait un
dévouement sans borne. Vers la fin des années 40, il était évident que nous
quitterions St-Mathieu et ceci ajoutait à l'insécurité de Siméon. Nous
sommes partis en juin 1951 et nos deux tourtereaux s'épousèrent.
Adèle, la dernière de la famille avait été ma meilleure
amie d'enfance et pour cause. Elle était la seule fille du rang ayant
presque le même âge que moi; un an de plus seulement. Nous découvrions les
mystères de la vie ensemble; les premières odeurs sous les aisselles, les
seins qui se développent, les érections qui surprennent et embarrassent,
etc.
J'ai de la difficulté à la décrire. Nous étions comme
frère et sœur jusqu'à l'âge de 13 ans; elle 14. Je n'ai connu d'elle que
l'enfant et, les enfants ne se connaissent pas. Ils s'aiment ou se détestent
comme ils sont, ils ne s'étudient pas, ne s'analysent pas. Leurs rapports
sont simples et ne se formalisent pas de toutes ces complications
d'adultes.
Je ne peux même pas décrire ce qu'elle était physiquement. Les enfants ne se
voient pas, ils se perçoivent. Faites-leur faire un dessin de trois
personnes différentes et ils vous dessineront trois bonhommes identiques.
Par contre, ils vous diront, lui il est gentil, il m'a donné des bonbons,
lui je l'aime parce qu'il nous a montré des jeux nouveaux, etc.
Adèle et moi étions copains. Jamais on s'est bagarrés, on
s'aimait comme des frères. Les seins d'Alice m'excitaient déjà mais ceux
d'Adèle si elle en avait un peu ne me dérangeaient pas plus que ceux de ma
mère. Avant le 60ième anniversaire, je ne l'avais jamais revue et je n'avais
aucune idée de ce qu'elle avait fait durant ces trente ans. Nul besoin de
dire que je ne l'ai pas reconnue. On a du me la présenter. Je l'aurais crue
plus grande, plus grosse avec un visage qui ressemblait aux autres, mais
non, j’imaginais mal. Elle était toute menue, à peine cent livres, à peine
plus de cinq pieds. Son visage ressemblait de loin à ceux d'Agnès ou d'Alice
moins la graisse. Ses yeux intelligents rappelaient plutôt ceux de Marie ou
de Benoît. Elle avait une très belle grande fille, gâtée, un mari trop bien
nourri qui manquait d'exercice. D'allure calme et détendue, il possédait une
personnalité agréable et évoluée.
Elle avait, à l'instar de Benoît, continué ses études.
Comme Marie, elle avait le goût d'aider les autres, elle devint
garde-malade. Elle travaillait dans un hôpital d'Ottawa où elle et sa
famille résidaient depuis longtemps. Je fus très heureux de la rencontrer,
et je crois que si l'occasion se présentait, nous deviendrions à nouveau de
bons amis.
Les (Edmond) Dionne
De l'autre côté, loin de nous au pied de la côte, presque
flottant sur le lac était notre autre voisin Edmond Dionne. A cause de la
situation géographique de sa résidence --complètement à part et loin des
autres--, cette famille n'a jamais partagé les activités ni participé à la
vie communautaire des habitants du haut de la côte. Étant situé juste en
face de la passe, il était tout près de son frère de l'autre côté du lac, là
où il était né. Cette famille nous semblait vivre seule dans
l’autosuffisance. Ses enfants eux, eurent la chance de fréquenter l’école du
village , celle-ci étant beaucoup plus près d’eux que la nôtre. Edmond avait
un tracteur, et un camion, et vers la fin des années 40, une auto, grâce à
son frère dépositaire Ford à Rimouski. Edmond était une demie génération
plus âgée que mon père et il venait d'une famille plus à l'aise qui n'avait
pas connu la pauvreté chronique. Une partie de ses avoirs lui avaient été
cédée par héritage et donc il était déjà mieux nanti que nous, mais ce
n'était pas pour ces raisons qu'il ne vivait pas avec nous sur le plan
social.
Je me souviens d'une seule fois où nous sommes allés
veiller chez eux. On ne se voisinait pas comme c'était la coutume avec les
autres. Par contre, ils étaient de très bons voisins avec qui nous n'avons
jamais eu aucun démêlé, même si nous possédions des terres au beau milieu
des siennes en plus d'être voisin de bâtiments. (Quand même à cinq ou six
arpents de distance; eux en bas et nous en haut de la côte, donc,
complètement isolés les uns des autres) Avec toutes ces terres de quatre
arpents de large, divisées en champs de deux arpents, cela faisait beaucoup
de clôtures à entretenir. Et de plus il fallait souvent amener nos vaches
aux pâturages de notre autre terre, située de l'autre côté
--à l’ouest-- de
celle d'Edmond et, souvent nous passions sur sa ferme en haut des côtes, ce
qui raccourcissait le chemin de moitié. Edmond Dionne était un grand
bonhomme de plus de six pieds. Toujours souriant, il se payait la tête des
autres en leur racontant les pires exagérations, que personne ne croyait et
n'avait le courage de contester. Il s'était bâti la réputation du meilleur
menteur de la paroisse, à l'exception peut-être de Louis-Philippe Jean.
Parfois la compétition entre les deux beau-frère, était vive. Il s'agissait
d'inventer le mensonge --il s’agissait plutôt de bons gags-- le plus original
et le plus invraisemblable. C'était un jeu sans malice, un jeu d'adresse.
Jamais ces deux originaux n'auraient menti en affaires ou pour nuire à
quelqu'un. Mais comme il était bon chasseur et surtout braconnier, la
réputation d'Edmond le servait bien. Il possédait de nombreuses terres dont
la superficie presque entière était boisée. Ses terres comptaient une
douzaine de lacs et autant de rivières et ruisseaux. Il défrichait de
petites clairières à différents endroits, en plein bois, et il y semait de
l'avoine. Lorsque l'avoine atteint une certaine maturité, les chevreuils
viennent s'y nourrir, et c'est là que le braconnier attrape facilement ses
victimes en temps prohibés. Pour Edmond comme pour le père Georges, qui
avaient appris de leurs ancêtres à chasser pour se nourrir, il n'y avait pas
pour lui de temps où l'on devait mourir de faim parce qu'il était défendu de
chasser pour se nourrir. Par contre il savait que d'attirer le chevreuil de
cette façon et d'aller le tuer au petit matin à l'aide de lumières fortes
qui attirent sa curiosité et le mobilisent, c'est illégal, mais quand Dieu a
créé l'homme il lui a dit qu'il allait dominer sur les animaux, l'important
était de ne pas se faire prendre.
Il faisait sécher les peaux au soleil sur le toit de la
laiterie à quelques pieds de la route. Les quelques rares passants les
voyaient bien, et nous aussi. Le dimanche sur le perron de l'église, il s'en
vantait publiquement, le racontait même personnellement au garde-chasse.
Personne ne le croyait. Même pas le garde-chasse, qui n'aurait pas osé aller
vérifier, étant persuadé de se faire tourner au ridicule. Edmond s'était
fait une réputation qui lui permettait de raconter la vérité là où d'autres
se seraient parjurés pour ne pas être punis.
Ils étaient plusieurs enfants, y compris deux couples de
jumeaux. A part Mathieu dont j'ai parlé dans d'autres
textes, et que j'ai eu le plaisir de
rencontrer souvent durant mes années de travail dans les aéroports, mon
souvenir des autres est plutôt vague. J'ai rencontré Rosaire, (un des
premiers jumeaux, l'autre est décédé), lors du 60ième anniversaire des
Rousseaux. Rosaire, prêtre, était venu célébrer la cérémonie religieuse. Il
avait déjà cinquante ans. Travailleur acharné, dévoué, il était le
touche-à-tout ce qui se passait à l'Archevêché de Rimouski. Roland, Hilaire
et son jumeau et les quelques filles dont je n'ai aucun souvenir; je ne les
ai jamais revus. Ils étaient nos voisins et pourtant certains d'eux nous
étaient aussi étrangers que les enfants des autres rangs ou du village.
Lorsque papa mit ses terres en vente au printemps 1951,
Edmond acheta la partie de la terre où étaient les bâtiments, à partir du
chemin du Rang 4 jusqu'au lac, en plus de la terre de Romuald Jean qui
séparaient ses propriétés. Il a cultivé ses terres et gardé des animaux à
bœuf jusqu'en 1980 environ. Il est décédé en 1992; il avait l'âge du siècle,
92 ans.
haut de page
LES NAISSANCES
Même si à prime abord, on avait tendance à croire que
c'était les activités sexuelles des couples qui étaient responsables du
grand nombre d'enfants par famille (de 12 à 18 et, dans certains cas même
davantage) il en était souvent tout autrement.
D'une part, le contrôle des naissances était inconnu des
catholiques! D'autre part, les curés encourageaient les grandes familles et
faisaient tout en leur pouvoir pour garder la population dans l’ignorance.
Ils refusaient de leur donner accès aux connaissances qui auraient pu leur
permettre de contrôler leur destinée. A la seule idée que tout exercice
sexuel autre que l’acte de la procréation, était péché, et que le péché
conduit directement en enfer, ces mères de famille très chrétiennes
passaient les trois-quarts de leur vie enceinte. Plusieurs d’entre elles
étaient plutôt faibles, et de santé délicate. Elles se sentaient toujours
faibles et, les moins résistantes, moins robustes, mouraient prématurément.
( Aucun curé n’a jamais été accusé de meurtre, pourtant, ils en furent
souvent responsables; ces remplaçants de Dieu sur la terre).
Après la naissance d'un enfant, le couple devait observer
une période d'abstinence sexuelle totale de quarante jours, afin de laisser
à la mère le temps de se refaire un peu. Le processus physique de guérison
n'a pas changé et il demeurera toujours nécessaire. A l'époque, les femmes
enceintes ne visitaient presque jamais leur médecin. Elles ne savaient pas
non plus que durant la grossesse, elles auraient dû suivre une certaine
diète afin d'éviter des problèmes au bébé autant qu'à la mère. De plus elles
accouchaient à la maison et bien souvent, le bébé arrivait avant le médecin,
avec l'aide de voisines qui étaient devenues d'habiles sage-femme;
bien
malgré elles. Parfois s'il y avait complications, il s'ensuivait d'énormes
souffrances pour la mère. Le nombre de bébés mort-nés était effarant et les
mères qui mouraient lors de l'accouchement étaient trop nombreuses. Mais on
acceptait cette fatalité comme on accepte aujourd'hui la mort par le cancer.
Il ne faut pas négliger le fait que les femmes
travaillaient beaucoup aux champs et à l'étable. Leurs corps étaient
entraînés aux gros travaux. Elles ne changeaient pas leurs habitudes jusqu'à
la dernière journée de la grossesse. Leurs muscles rendus souples et forts
par l'exercice s'acquittaient de l'accouchement à froid sans défaillance.
Physiquement en forme, elles revenaient à la vie normale rapidement. Je me
souviens de maman qui s'était fait ruer par une vache quelques jours avant
l'accouchement. Étendue de tout son long dans l'allée derrière les vaches,
de gros bleus aux bras, elle mit au monde quelques jours plus tard un beau
bébé bien en santé.
Les petites femmes de ville d'aujourd'hui, gâtées, qui
n'ont qu'une petite maison à entretenir, (même si de plus en plus d'elles
travaillent dans des bureaux et ont la chance d'avoir un mari qui partage
les tâches familiales) ne pourraient pas comprendre comment leurs
grands-mères pouvaient enfanter à chaque année, aller à la grange matin et
soir, travailler aux champs, faire de grands jardins, préparer de nombreux
repas, produire elles-mêmes la plupart des produits servant à nourrir la
famille. Laver les couches, les piqués de (pissant lits) expression courante
à cette époque, sans laveuses ni sécheuses. Conserver sa nourriture sans
réfrigérateur. Faire la cuisine sans cuisinière électrique. Sans aucun
accessoire électrique si indispensable aujourd'hui. A l'époque, nous allions
à l'épicerie pour acheter du sucre et de la farine. Nous produisions tout le
reste à la ferme, sans quoi nous n'aurions jamais pu nourrir ces nombreux
enfants.
Après la quarantaine d'abstinence, les petits maris qui
avaient réussi à compléter l'épreuve, voulaient s'en donner à cœur joie,
mais la femme qui parfois ne sentait pas la guérison complétée et qui, par
surcroît avait la peur de retomber enceinte au premier toucher, devait agir
avec beaucoup de prudence, et ralentir les ardeurs de son amoureux. La
crainte de redevenir enceinte était souvent la source de nombreux problèmes
sexuels et conjugaux. Les femmes les plus chaleureuses devenaient souvent
froides et les maris frustrés. Mes tantes me disent encore aujourd’hui que
du temps de leur mère et avant, elles concevaient très souvent sans s’en
être rendu compte, leur mari les prenant très souvent durant leur sommeil.
Plusieurs mères nourrissaient leurs bébés. Premièrement
pour le bien du bébé, deuxièmement parce que la plupart ne devenaient pas
enceintes pendant qu'elles nourrissaient. De cette façon, on espaçait les
naissances et donnait à la mère le temps de se rétablir et de reprendre ses
forces avant la prochaine grossesse. Cette méthode anti-conceptionnelle
naturelle n'était pas contestée par l'Église et, c'était la seule qu'on
connaissait. Vers la fin des années 40 les prêtres enseignèrent aux parents
que parfois, pour certaines femmes, pour qui il était devenu dangereux pour
sa santé de mettre d'autres enfants au monde, la méthode Ogino était
acceptée par l'Eglise. Cette technique du thermomètre n'était pas sûre mais
elle pouvait dans certains cas éviter des naissances aux couples qui ne
pouvaient pas pratiquer l'abstinence totale.
L'allaitement, qui retardait l'ovulation et permettait à
la mère un temps de repos n'a pas empêché mes grands-mères de mettre au
monde chacune dix-huit enfants. A cette époque, les filles se mariaient
souvent très jeunes, vers les quinze ans, ce qui leur laissait environ
trente ans de production pour 15 à 18 enfants sans compter les jumeaux. Nous
avons connu les belles grandes familles. Même chez-nous, nous sommes douze.
Il existe dans les grandes familles une fraternité, une unité; je ne saurais
vraiment l'expliquer, mais il s'agit d'une atmosphère et peut-être un
sentiment d'appartenance qui n'est possible nulle part ailleurs.
Chez-nous, on ne faisait pas exception à la règle, un
nouveau-né se présentait tous les ans: Moi, en janvier, Olivette en février
(décédée trois jours plus tard), Viateur en mars, Germain en août, Jean-Yves
en octobre, Béatrice en avril et ainsi de suite pour treize naissances en
seize ans.
Maman était petite et fragile. Au début de ses
grossesses, elle vomissait durant plusieurs mois. C'était peut-être une
réaction de frustration à l'idée d'être encore enceinte avant même d'avoir
eu le temps de se refaire un peu le corps et les forces physiques. J'imagine
que la révolte ne l'aidait pas, et pouvait même lui causer bien des
malaises; même ses crampes aux jambes. Je comprends maintenant ses
frustrations et déceptions devant un problème sans solution et, l'obligation
que la femme avait sous peine de péché mortel de satisfaire son mari même si
cela pouvait mettre sa vie en danger.
Pour nous qui n'étions pas au courant de toutes ces
implications, la vie semblait bien normale. Des sujets comme le sexe ou les
grossesses étaient tabous. On n'en parlait pas vraiment et surtout pas
devant les enfants. De toute façon, nous étions même trop jeunes pour
réaliser que notre mère était enceinte. Un beau soir, on nous amenait
coucher chez un voisin parce que maman aurait un nouveau bébé cette nuit-là.
Nous comprenions que nous n'avions pas le droit de voir
ni d'entendre ce qui se passait. Aussi, sans poser de questions, nous
allions chez un voisin, et c'était pour nous la fête; car les occasions de
coucher ailleurs étaient rares. Au réveil du lendemain matin, on nous
annonçait la venue d'une autre petite fille, annonce à laquelle on s'était
habitués. Exception faite des heures de repas où il était un peu bizarre de
retrouver quelqu'un d'autre que notre mère pour nous servir, le reste de la
journée se déroulait comme à l'habitude. C'était toujours amusant de
regarder un nouveau bébé mais la vue de notre mère au lit, incapable de voir
à nos besoins semblait nous désorienter un peu.
Il fallait se tourner vers une de ces jeunes filles que
l'on engageait pour relever maman après les accouchements. Souvent, seules
les filles de 14, 15 ou 16 ans étaient disponibles. Les autres étaient soit
mariées, soit parties travailler en ville. Ce furent très souvent les sœurs
de maman qui vinrent nous dépanner. Je me souviens en particulier d'Armandine,
pour sa douceur qui la rendait presque pareille à maman. Sérieuse pour son
âge et attentive à nos besoins, elle avait aussi la patience requise pour
contrôler les petits et se faire écouter comme une vraie maman; ce qu'elle
se préparait à devenir. Elle était appréciée de tous et particulièrement de
mon père qui ne se lassait pas de jaser avec elle jusqu'à très tard le soir.
Un jour, nous avons eu Monique: 14 ans, hyper énergique,
follette et énervée pour les garçons, elle ne savait encore rien faire à la
maison. Encore sans autorité, elle se chicanait avec nous plutôt que
d'essayer de nous calmer. Elle ne pensait qu'à jouer et à s'amuser et elle
ne voyait nullement le travail à accomplir. Elle faisait un peu les lits, le
lavage et l'entretien de la maison, de façon à s'en débarrasser le plus vite
possible. Elle ne savait pas faire la cuisine. Mon père aurait voulu la
gifler lorsqu’elle prenait une demie livre de beurre pour faire cuir un
oeuf.
Papa acceptait difficilement qu'à 14 ans une fille soit
aussi inutile. Il ne semblait pas comprendre qu'elle était une des dernières
de la famille, et qu'on ne lui avait jamais demandé quoi que ce soit. Les
autres étaient toutes occupées, il nous fallait accepter cette solution de
moindre mal. Parfois nous avions des filles un peu plus âgées, qui voulaient
faire un genre de stage dans une famille avant de se marier, afin d'acquérir
l'expérience dont elles auraient grand besoin prochainement. Une de
celles-ci fut Imelda Beaulieu,-soeur de Monique, la femme de Romuald Rioux-,
qui épousa peu de temps après Roland Rioux, cousin de maman.
Imelda était vraiment la personne idéale et la mère de
famille exemplaire. Notre affection pour elle était réciproque et encore
aujourd'hui il m'arrive d'aller lui dire bonjour, même si ce n'est que pour
me rappeler ces doux souvenirs. Le fait qu'elle demeure à Beauport depuis de
nombreuses années me donne la chance de la rencontrer occasionnellement.( Au
jour de l’An 2002, elle a 74 ans, se teint en blonde platine et elle est
plus follette que lorsqu’elle était jeune, ce n’est plus drôle, c’est
triste. Roland lui, est très dur d’oreille, fume toujours à la chaîne et ne
peut plus boire autant.)
Je ne peux pas me souvenir de toutes les filles qui ont
travaillé chez-nous. Il est arrivé souvent que maman ne soit pas assez bien
pour vaquer à ses nombreuses occupations. Il lui fallait de l’aide. De plus,
tout un chacun passait ses quelques jours chez-nous; Thérèse, Aline, Siméon,
Omer, Grand-mère, faisaient partie des temporaires réguliers. Les Rioux
venaient très souvent nous visiter, mais jamais ils ne restaient pour
coucher. Après la naissance de Béatrice, maman ne remontait plus la pente et
le Docteur Catellier qui la croyait atteinte de tuberculose, à cause entre
autre, de sa petite toux coutumière, décida de l'hospitaliser. Après
quelques semaines de repos, elle reprit ses forces et sa petite toux
s'atténua, alors que les tests de tuberculose s'avéraient négatifs.
Je répète ici que dernièrement j’ai appris par Béatrice
qu’il ne s’agissait pas de tuberculose comme on avait semblé le laisser
croire aux enfants, mais que maman avait eu un kyste à un sein qui fut
traité à l’hôpital et qui finit de guérir à la maison
Papa qui s'était inquiété exagérément de la maladie de
maman avait pris les dispositions pour s'assurer que maman ait de l'aide à
sa sortie de l'hôpital afin qu'elle se remette complètement. Pendant ce
temps, l'angoisse avait réveillé ses ulcères et ce fut à son tour d'aller se
faire traiter. Heureusement qu'il avait l'aide de Siméon et d'Omer sur qui
il pouvait toujours compter. Lentement, les choses reprirent leur cours
normal: mais ce fut un été triste.
haut de page
L'achat
d'une deuxième terre
Quelques années après notre
arrivée au quatrième rang, mon père achetait une toute petite terre presque
au bout du lac, au sud ouest, en face de la ferme de l'oncle Paul-Émile
Beaulieu (marié à la sœur de mon grand-père Rioux, donc l'oncle de maman)
qui demeurait lui, du côté nord du lac, dans le troisième rang non loin des
limites de Trois-Pistoles. Il n'y avait pas plus de trois ou quatre arpents
de terre en culture. Les quelques arpents non défrichés ne l'avaient pas été,
justement, parce qu'ils étaient pratiquement impropres à l’agriculture.
La forêt qui jadis y abondait avait été coupé jusqu'à son moindre petit
sapin. Il aurait fallu patienter au moins durant deux autres générations
avant de voir renaître cette forêt et attendre qu'elle n'arrive un jour à sa
maturité.
Je me souviens que c'était
très loin pour l'enfant que j'étais. C'était encore durant la guerre et
quand je demandais à maman si c`était dangereux, la guerre, elle me disait
que non, ce n'était pas dangereux pour nous parce que la guerre, c'était
très loin. Alors, je lui demandais toujours; si c'est loin la guerre, est ce
que c'est au circuit? Parce qu'on appelait ce lopin de terre, le circuit.
C'était loin pour un enfant, en voiture à cheval, spécialement à partir de
la pointe du lac où il fallait parcourir quelques milles de chemin en forêt
très rocailleux, traverser des collines très abruptes. Nos petits chevaux
avaient beaucoup de difficultés à tirer la charge, et encore davantage à la
retenir dans les descentes. Ces voyages de foin qu'on avait pris soin de
bien fouler et entasser dans ces petits paniers montés sur nos waguines,
(ces voitures à quatre roues de bois, entourées de ce qu'on appelait; un
bandage de fer). Ces voitures, contrairement à celles qu'on nous montre dans
les films américains, n'avaient pas de frein, alors, même quand on arrêtait
le cheval pour le faire reposer, il fallait quand même qu'il retienne
sa charge. Après quelques minutes, son souffle se stabilisait et on pouvait
de nouveau le faire avancer. Pour ceux qui prenaient place sur le voyage de
foin, traverser ces collines boisées constituait toute une aventure. Le
sentier était étroit et les branches des arbres se rejoignaient de sorte
qu'on ne voyait pas le soleil; les feuilles très denses l'empêchant de pénétrer
cette espèce de toundra. Les trous et les roches, très fréquents dans ces
sentiers, faisaient souvent basculer la voiture de telle façon, qu'il
devenait très difficile pour les petits voyageurs de s'agripper pour ne pas
tomber de cette hauteur très importante pour des enfants. Parfois nous
passions sous un merisier sauvage, et papa s'arrêtait pour nous laisser
cueillir des merises, et souvent aussi, pour cueillir des cerises à grappes
que l'on dégustait avec appétit. Par contre, étant à la hauteur des
branches, il arrivait souvent qu'une branche s'accroche à une partie de la
voiture. Lorsqu'elle échappait, elle nous lançait un de ces coups de fouet à
la figure qu'on ne serait pas prêt d'oublier.
On ne transportait que
quelques voyages de foin l'été car il y avait sur cette petite ferme une
grange qui pouvait emmagasiner les trois-quarts de la récolte. Il y avait
aussi une petite cabane étable (un campe) où l'on pouvait garder un cheval;
ce qui permettait de laisser à un des chevaux quelques heures
supplémentaires de repos, n'ayant pas lui aussi, à marcher l'aller et le
retour à la maison. L'oncle Paul-Émile Beaulieu avait construit ces
installations parce que l'été, il était à environ cinq milles de distance de
cette terre. Mais l'hiver, il était à moins d'un mille en traversant le lac
sur la glace. De cette façon, il pouvait faire le minimum de travail durant
l'été, laisser les chevaux et les équipements là durant les quelques jours
de la récolte, traverser en canot à rames pour économiser du temps. Et
l'hiver lorsqu’on n’avait presque plus rien à faire sauf le train
soir et matin, on pouvait tout à loisir transporter la récolte sur cette
courte distance glacée. Le lac était pour nous la meilleure route à l’année
longue. Même si, de l’endroit où nous étions situés, la distance vers les
points qui nous concernaient était la même l'hiver que l'été, mon père
préférait de beaucoup le transport d'hiver sur un lac plat, qui offrait une
voie plus avantageuse en tous points, que la route terrestre.
L'achat
d'une autre terre
Les affaires de mon père
semblaient progresser rapidement, alors décida-t-il d'acheter une autre
terre dont Romuald Jean avait décidé de se départir avant de quitter
St-Mathieu pour aller s'établir ailleurs (je ne sais où, probablement pour
aller travailler avec ses beaux-frères, les Dionne Automobiles de Rimouski).
(Il s’agit de Albert –frère de Edmond—décédé en 2001, le 5 février à l’âge
de 95 ans 8 mois)
Edmond Dionne, notre voisin,
possédait deux terres de quatre arpents de large, entre chez-nous et cette
terre. Ce n'était donc pas loin, mais la guerre étant finie, j'avais oublié
cette relation de distance. D’autant plus que j’avais vieilli de quelques
années. Il y avait sur cette terre une autre grange à foin, sans étable, car
on gardait les animaux à la ferme principale. Il y avait aussi une petite
cabane pouvant accommoder deux chevaux et un genre de chalet, où une
personne seule aurait pu y vivre, en ermite peut-être, mais convenablement.
En somme, toutes ces petites terres qu'on achetait afin d'agrandir sa ferme
principale avaient été aménagées de la même façon. C'était la mode du temps,
une mode qui comblait les besoins du temps dans une civilisation qui nous
semble déjà presque à l'âge de pierre, en comparaison de ce que nous
connaissons aujourd'hui; à peine cinquante ans plus tard. Que de
changements,,,,,, positifs!
Entre le chemin et le lac,
face à la grange, il y avait un beau petit terrain plat, enfin ! (Dans ces
pays de montagnes, on ne sait jamais si l’illusion d’optique nous triche
l’œil) où on y avait cultivé avant nous une bonne dizaine de rangs de
fraises, qui produirent pour quelques années encore de belles grosses
fraises rouges, juteuses, qui faisaient bien notre bonheur car elles étaient
tellement plus faciles à cueillir et plus agréables à manger que les petites
fraises des champs; si difficiles à trouver à travers le foin. D'autant plus
qu'elles sont toujours éparpillées un peu partout au hasard et, même avec
l'habitude et l'instinct, il n'est pas toujours évident qu'elles seront en
quantité là, où nous le croyons. Mais voilà, pour les fraises cultivées, il
en était tout autrement, elles étaient là, où on les avait plantées en
belles rangées bien droites que le foin a fini par envahir après quelques années sans sarclage et sans nouvelles plantations. On
apprendrait à cultiver la fraise quelques années plus tard lorsqu'on
arriverait à Beaumont.
Ce petit terrain, sans
pouvoir être qualifié de pointe, semblait s'avancer dans le lac, et sa plage
sablonneuse s'allongeait sous l'eau jusqu'à une certaine profondeur. On ne
se baignait pas tellement là, parce que le lac était grand et les endroits
de baignades nombreux. On se baignait surtout près de la maison et, pour
les grandes occasions, je veux dire quand la visite venait en vacances de
Montréal, on attelait le cheval au buggy et, tout le monde s'en
allait à la pointe du lac où la plage était grande, d'un sable doux comme un
caresse, et de surcroît; on pouvait s'avancer à des centaines de pieds
avant d'arriver en eau trop profonde, sans même trouver un seul cailloux.
Chose rare dans ce pays.
Les bienfaits de la nature
étaient omniprésents sur cette petite terre. Des sources d'eau pure et
fraîche jaillissaient à travers le tuf à plusieurs endroits. On pouvait s'y
abreuver en tout temps, ainsi que les animaux au pâturage. Ces sources
alimentaient de petits ruisseaux qui ne tarissaient presque jamais. Au bout
de la partie cultivée se trouvait, à quelques cent pieds dans la forêt, un
ruisseau qui prenait sa source à la pointe du lac et, qui allait déverser
dans la grande coulée en face de l'école sur une des terres appartenant à
Désiré Dionne. (Environ 5 kilomètres plus loin) On a souvent pêché dans ce
ruisseau, de petites truites roses, très rusées, qui avaient l'habitude de
nager dans le courant fort et qui savaient taquiner le ver au bout de
l'hameçon plusieurs fois avant de s’y laisser prendre. On s'est bien amusés
même si les truites étaient la plupart du temps plus intelligentes que nous.
Il y avait, à quelques arpents
en haut de la première côte, une roche très spéciale. Elle était faite comme
ces bâtiments à toits ronds que nous voyons partout aujourd'hui, avec la
différence qu'elle était ronde tout le tour. Elle avait aussi la dimension
d'un de ces bâtiments, c'est-à-dire, peut-être cent et quelques pieds de
long sur une quarantaine de pieds de largeur et haute d'une bonne douzaine
de pieds et peut-être davantage. Une mini montagne au beau milieu d'un
champ. Son roc était lisse et chauve, comme ma tête, et poli comme s'il
avait été transporté durant des milliers d'années par les glaciers. Cette
mini montagne semblait avoir été érigée pour les enfants, dans des
dimensions qui leur ressemblent, à leur portée et selon leur âge comme ces
maisonnettes que l'on construit spécialement à leur intention. Mais dans ce
cas-là, la nature avait pensé aux futurs enfants qui feraient semblant de
jouer aux adultes sur de grands espaces imaginaires. Juchés sur cette
montagne, nous pouvions voir presque la moitié de la paroisse de l'autre
côté du lac et, admirer ce splendide paysage des plus belles fermes du
troisième rang de la paroisse; si bien cultivées sur le côté nord du lac.
(Vers l’an 2000 j’ai remarqué que la plupart de ces plus belles terres de
St-Mathieu avaient été reboisées, on n’avait conservé que les plus beaux
champs et, près de l’ancienne terre de l’oncle Paul-Émile Beaulieu on a
construit un club de golfe. En regardant cet endroit j’ai fait la réflexion
que souvent on doit aller ramasser ses balles en bas des côtes)
Cette terre comptait au moins
trente arpents cultivés. Quelques générations avant nos parents, d'audacieux
défricheurs, y avaient fait reculer la forêt plus en profondeur que ses
voisines, côté ouest. C'est pourquoi je ne comprends pas que les
descendants de ces défricheurs l'aient délaissée, car elle était assez
grande pour faire vivre un agriculteur au temps de la colonisation de ces
paroisses. Même les côtes, où les arbres poussaient presque parallèle à
l'escarpement du terrain, avaient été défrichées et cultivées. Papa y a
coupé le foin à la petite faux pendant quelques années, parce qu’il était
impossible d'utiliser la faucheuse à chevaux dans ces pentes abruptes. Quand
ces montagnes ont été défrichées, tout le travail était effectué à la faux
ou à la faucille, et le petit râteau de bois faisait lui aussi partie des
outils de ces pionniers. Avec ces outils, il importait peu que le terrain
soit en pente ou plat. Quelques générations plus tard, les instruments
aratoires firent leur arrivée. Même très rudimentaires, il n'en demeure pas
moins qu'il devenait impossible de les utiliser dans les pentes à
quarante-cinq degrés de dénivellation.
Quand j'ai visité la Suisse,
il m'a fallu reconnaître que nous n'avions pas su développer d'instruments
aratoires adaptés à ce genre d’agriculture. Je fus très surpris de voir ces
faucheuses, râteleuses, charrues, sarcleuses, presses à foin, et même
voitures à foin et autres utilités, toutes mues par des moteurs
stationnaires et conçues spécialement pour l'agriculture en montagne. Ce
n'est pas que les Européens soient en avance sur nous, c'est qu'ils ne
peuvent pas se permettre de fermer des territoires complets et laisser
retourner les terres à la nature, car contrairement à nous, ils vivent dans
de très petits pays surpeuplés.
Les agriculteurs comme papa et
l'oncle Omer, qui ne possédaient que des instruments mus par les chevaux se
sont entêtés à cultiver ces côtes impitoyables le plus longtemps possible.
Je me souviens de cette charrue à oreille basculante qui permettait de
labourer ces pentes. Mon père avait réussi à labourer la côte derrière la
maison. Il fallait être un surhomme pour réussir à tenir les manchons, et
les guides des chevaux, qui devaient tirer tout de travers afin de garder la
charrue au bon endroit; sans compter qu'à tous les quelques pieds, une
autre roche faisait sortir le soc de la terre et basculait la charrue et son
guide à quelques pieds plus bas. Le pauvre homme devait, à bout de bras et
de force physique, remonter son instrument là, d'où il avait dépiqué.
J'ai entendu sacrer l'oncle Omer aussi dans sa côte près du lac quand le soc
heurtait un caillou et que les manchons le fouettaient en plein sur la
gueule. Ils ont tous les deux mis de côté cette charrue maudite, et décidé
que dorénavant ces côtes retourneraient à leur vocation première;
c’est-à-dire, à la forêt.
L'été, lorsque la récolte des
foins était terminée, papa s'assurait que les clôtures étaient en bon état
et en profitait pour faire paître les vaches dans ces champs où l'herbe
nouvelle était abondante et de bonne qualité. Mais pour nous, les enfants,
ce n'était pas si agréable. Même si la nuit nous gardions le troupeau de
vaches près de la grange, matin et soir il fallait aller conduire ou aller
chercher les vaches là-bas pour la traite. Il s'agissait d'une marche dont
on aurait très bien pu se passer avant d’entreprendre une autre marche d’un
mille et demi pour se rendre à l’école.
Les animaux ne semblaient pas
détester les côtes. Ils allaient là où l'herbe leur semblait plus fraîche.
Il n'était pas rare de voir une vache à genoux en train de brouter et
soudainement elle se relevait et marchait très solidement sur ses quatre
pattes. On y élevait aussi des moutons et, nous les gardions tout l'été dans
les endroits les plus escarpés; lieux de prédilection des troupeaux d'agneaux. Mon père a finalement discontinué cet élevage qui n'était pas très
rentable. D'ailleurs, on pouvait se procurer de la laine à bon marché de nos
voisins. De plus papa était un homme qui aimait les vaches,
détestait les cochons mais tolérait les poules. Il
n’aimait pas les moutons, les boucs en particulier.
D’ailleurs, en voici une
anecdote. Après son mariage, l'oncle Omer avait acheté une belle carriole
fraîchement vernie, (digne de promener sa jeune épouse adorée), dans
laquelle son bélier se mirait, et croyant qu'il avait affaire à un rival; il
se lançait à belle allure dans un tête à tête, genre duel. Nul besoin de
vous dire qu'après quelques essais, il ne restait rien qui vaille derrière
cette merveille achetée à gros prix. Je ne me souviens pas de ce qui est
arrivé au bélier, mais si mes souvenirs sont fidèles, après cet incident
nous n'avons plus eu peur du bélier lorsqu'on passait chez l’oncle Omer
pour aller à l'école. Le bélier n'y était sûrement plus et la carriole a
fait ses beaux hivers avec son souvenir au derrière.
Je me souviens que Agnès
n’aimait pas le mouton, elle vomissait rien qu’à y penser. Je ne sais pas
s’il s’agissait du même bélier mais un jour le père Georges apporta un plat
de viande à sa fille lui disant qu’il avait tué un ours et que ceci était
une belle pièce qu’il avait fait cuire. Agnès avait mangé ce festin avec
grand appétit. Plus tard lorsque son père lui annonça que ce festin était du
mouton, elle l’a vomit au complet. Preuve que souvent c’est dans la tête que
ça se passe.
J'avais dans ce temps-là une
belle chatte qui passait l'hiver dans la grange, au chaud avec les autres
animaux. Mais dès l'arrivée de l'été, elle allait mettre au monde une portée
de petits dans la grange inhabitée de cette petite terre à quinze minutes
de chez-nous. Je la voyais souvent chercher de la nourriture pour ses
petits et j'allais la flatter, ensuite elle me conduisait à ses petits que
j'avais beaucoup de misère à caresser; car ils n'avaient jamais vu
d'humains. Mais, voyant que leur mère me faisait confiance, ils finissaient
par céder et se laissaient apprivoiser. Ce qui faisait le grand bonheur de
l'enfant que j'étais, qui s'est toujours confié à son chat chaque fois qu'il
avait de la peine. Mon chat me comprenait, il se courbait dans mes bras,
ronronnait et me caressait avec sa tête et j'étais consolé. Cela a duré
longtemps et avec différents chats, qui tous semblaient me comprendre. Même
après le décès de mon père, où, mort de fatigue avec tout ce monde à la
maison, je suis tombé en sanglots sur un lit et, quelques secondes plus
tard, voilà encore ma chatte qui vint s'étendre contre moi et me ronronner
sa plus belle musique. Encore une fois je fus consolé en quelques minutes,
mais ce fut la dernière fois. Ce n'est plus jamais arrivé depuis, même si
toute ma vie, j'ai gardé beaucoup d'affection pour ces amis que tant de gens
n’aiment pas avec autant d’affection, parce qu'ils n'ont pas découvert que
les chats possèdent une intelligence insoupçonnée et très subtile. Nous
avons eu de petits chiens que j'aimais beaucoup, mais les chiens sont
incapables de donner cette affection à caractère très intime, que les chats
dans leur égoïsme nous prennent et nous donnent à la fois.
Depuis les années soixante,
tous les beaux terrains qui bordent le lac, du côté sud, ont été vendus à
des mordus de villégiature qui y ont bâti des chalets. Dans les années
soixante-dix, on a remplacé le chemin étroit, qui avait été conçu pour la
circulation de voitures à cheval, par une route large, surélevée et bien
égale qu'on a pu recouvrir d'asphalte quelques années plus tard; les besoins
d'une belle route étant devenus de plus en plus pressants. Le grand nombre
d'habitants durant la saison estivale avait justifié la présence de quelques
commerces; épicerie/dépanneur, casse-croûte, restaurant et même un hôtel.
Avec l'arrivée de la moto-neige, on y a développé tout un circuit de
sentiers à partir de la pointe du lac. De plus, quelqu'un de brillant, y a
aménagé un très beau centre de ski alpin qui fait maintenant partie de ce
décor féerique, dans ce pays montagneux. Cet atout vint s’ajouter aux autres
vocations touristiques et ressources naturelles abondantes.
haut de page
La maison
paternelle
Il y avait,
toujours du monde à la maison, mais les figures variaient avec les saisons.
Certains printemps nous avions la visite des Rioux; Edgar, Dominique,
Bertrand et Léo, qui louaient une érablière voisine de chez l'oncle Omer.
Ils ne venaient pas demeurer chez-nous, mais jamais ils ne passaient sans
s'arrêter. Et nous les enfants, nous étions en admiration devant ce que
pouvaient faire ces jeunes adultes, que nous voyions déjà comme des grands.
L'été, nous avions la visite
des gens de Montréal: Jacques Delisle, Lucienne et les enfants. Rosaire
Doucet et Marie-Louise, qui finirent par adopter des enfants beaucoup plus
tard. Adrienne venait seule avec les enfants. Donat Boucher, étant menuiser
ne pouvait pas facilement laisser son travail pendant l'été. Les vacances
de la construction en juillet n’existaient pas à ce moment-là. Je me
souviens qu'il était venu quelques jours lors d'une occasion que j'ai
oubliée, avec une voiture de location, il devait ne posséder qu’une
camionnette pour son travail. Même Jos Thibault (cousin de papa) s'arrêtait
chez-nous durant ses vacances. Jos est le fils de l'oncle Siméon qui
avait hérité de la terre de son père, François-Xavier en 1907. Siméon avait
hérité de cette terre mais avec les contraintes imposées par son père dans
l’acte de donation, il lui aurait été impossible de vivre avec sa famille et
de tout donner les revenus à son père. Il l'a
habitée de 1907 à 1911 ou 12 après quoi, il l'a vendue et alla rejoindre son
frère, mon grand-père à Montréal.
Jos est le seul de cette
famille qui ait toujours gardé le contact avec ses cousins; la famille de
papa. D'ailleurs lui et papa étaient presque du même âge et, s'entendaient
mieux que deux frères. C'est grâce à lui aussi que j'ai trouvé un travail
dès mon arrivée à Montréal. Jos est devenu veuf, un jour, alors que ma tante
Alma elle, était déjà veuve depuis longtemps; l’oncle Ernest Caouette, son
mari étant décédé relativement jeune. Les deux cousins ont pensé qu'ils
avaient encore, à ce moment là, plusieurs années devant eux et ont uni leurs
destinées pour le meilleur et pour le pire, et cette relation dura
harmonieusement durant de nombreuses années. Joseph est mort le 03 mai 1994 et
Alma à peine deux ans plus tard. Ils sont décédés à quatre-vingt-trois et
quatre-vingt-deux ans respectivement.
Nous avions bien du plaisir à
recevoir les gens de la ville sur une ferme; spécialement Jacques Delisle,
le bouffon de la famille, qui connaissait toujours tout et
qui savait toujours tout. Heureusement, il n'avait pas objection à
participer à de nouvelles aventures. Papa a souvent pris de douces revanches
sur ce singulier personnage, sans malice! Il voulait apprendre à tirer
(traire) les vaches. Il ne savait pas qu'il apprendrait d'abord à recevoir
des coups de queue, en pleine face; qu'elles avaient bien pris soin de
tremper à l'avance de jus dans le canal derrière elles. Il avait appris
aussi que quand une vache urine, ce n'est pas un petit jet délicat qu'elle
expulse, mais presque une chute d’eau chaude qu'elle te fait couler dans le
dos, en se tournant comme par exprès; pour accueillir les étrangers. Papa
l'a fait assister à l’accouplement d'un petit taureau, avec une grosse
vache, sur un pavé très glissant. Nous savions que le taureau en retombant
sur ses pattes allait glisser et s'étendre de tout son long sur le dos, au
grand étonnement de Jacques; à qui papa faisait accroire que c'était
toujours comme cela. Il avait spontanément déclaré qu'il préférait de
beaucoup sa façon à lui de procéder. Il aimait venir fouler le foin dans les
voitures avec nous. Encore là, papa, Siméon ou Omer ne manquait pas de l'enterrer
sous une montagne de foin d’où il parvenait à émerger en sacrant; son
langage naturel et sans malice. Et je crois bien qu'à la fin il s'amusait
tout autant que nous tous. Je parle un peu plus de lui que je le fais des
autres, parce qu'il est le seul phénomène dans la famille qui mérite cette
attention particulière. Mais, nous l’avons toujours aimé et
affectionné d'une certaine façon. Il a peut-être parfois les grandes
qualités de ses grands défauts, qui nous font oublier sa façon de se
payer la tête des autres.
haut de page
Le départ
de Pit Desjardins
Gérard Gagnon acheta la
terre de Cyprien (Pit) Desjardins qui était jusque-là, celui avec qui papa
partageait les tâches lorsqu’il s'agissait de travaux qui nécessitaient plus
d’un homme pour leur exécution. Pit et papa s'entendaient comme deux frères,
non parce qu'ils étaient petits petits cousins par la grand-mère de papa,
mais plutôt, parce que les circonstances les
avaient rapprochés. Ils s'étaient mutuellement découverts des
caractéristiques compatibles. Papa pouvait difficilement s'associer avec
d'autre voisin. Il aimait bien Edmond Dionne, mais sa façon de travailler
était complètement différente; il avait déjà un tracteur et un camion, et
aussi de grands garçons pour l'aider. Quant aux Rousseau, le père Georges
était souvent parti et de toute façon, lui aussi avait ses grands garçons
pour l'aider. Avec le départ de Pit, papa se retrouvait seul. Gérard Gagnon
et papa s'entendaient bien comme voisins, mais il leur était impossible de
travailler ensemble. Gérard, qui n'avait pas nécessairement été élevé sur
une terre était, au dire de mon père, plutôt maladroit, particulièrement
pour bûcher, comme pour bien d'autres travaux. De plus, Gérard savait qu'il
lui serait difficile de gagner sa vie à cultiver. Se faisant, il était vite
retourné travailler là où il était habile; dans un moulin à scie où il
taillait les billes de cèdre en bardeaux. Ce gars-là ne s'est jamais coupé
un seul petit bout de doigt, ce qui est extrêmement rare pour un scieur de
bardeaux; preuve évidente qu'il pouvait exceller là où il aimait le travail.
Ce fut difficile pour papa de
voir partir son ami, mais Pit avait trouvé une façon d'améliorer son sort
et celui de sa famille. Les terres du sud du lac n’étaient autre chose qu’un
tremplin vers une éventuelle vie meilleure. Il y avait de belles terres à St-Léon le Grand pour ses fils et ses futurs gendres. Quant aux filles, à cette
époque, on ne pensait à elles qu'en fonction de leurs futurs maris. Un jour
de printemps, je m'en souviens, tous les voisins chargèrent le ménage dans
de gros camions et, après les adieux où l'émotivité n'à d'égal que les vrais
sentiments d'amitié, ils partirent pour ne plus jamais revenir.
Quelques vingt-cinq ans plus
tard lorsque j'étais à Sept-Iles, j'ai pu apprendre, par une amie,
Pâquerette Gagné, ce que plusieurs d'entre eux étaient devenus. Mathieu
exerçait tel métier, Gérard, autre chose, et Pit était décédé vers les années 64 ou 65.
J'ai revu Gérard lors des funérailles d'Omer. Il avait peut-être 72 ans ou
un peu plus, mais il était encore bien portant et se disait en bonne santé.
haut de page
L'arrivée
des Gagnon
Nous étions très contents de
voir arriver la famille les Gagnon. Ils étaient nos petits cousins de par
nos mères. (Cousine frérot) Je ne me souviens pas que le lien de parenté ait
eu une influence quelconque dans nos esprits d'enfants. Le fait qu'il y ait
toujours un enfant dans l'autre famille, du même âge qu'un autre dans la
nôtre, devenait le genre de lien le plus important.
Les Gagnon, c'était bien sûr,
Gérard; Homme un peu roger-bon-temps, sans malice, sans orgueil, qui
semblait prendre la vie du bon côté. Il avait presque toujours travaillé
dans un moulin à scie; quand il a acheté sa terre, il a continué de
travailler au moulin de Désiré Dionne comme scieur de bardeaux; sa
spécialité. Pourquoi avait-il acheté une terre? Je ne sais pas. Néanmoins, à
cette époque, presque tout le monde possédait sa petite ferme, la terre
ayant l’avantage de pouvoir nourrir de ses produits ces familles aux
nombreux enfants. Mais cela n'empêchait pas ces pères de famille de
travailler à l'extérieur de la ferme et, d'aller chercher cet argent si
nécessaire; surtout dans le cas de Gérard, qui n'avait pas sur sa terre,
comme mon père et bien d'autres, le bois de sciage qu'il aurait pu vendre
pour augmenter ses revenus.
Albina, cousine de maman était
une vraie Rioux, avec tout ce que cela comporte. Des caractères doux, un peu
trop tendres; qui semblent sans autorité mais qui réussissent toujours à se
faire écouter et respecter! Capables de dire tout ce qu'ils pensent sans
jamais froisser ni indisposer. Sans être d'une profondeur d’esprit visible,
ils ont quand même une âme d’une richesse appréciable, spécialement grâce à
leur positivisme presque désarmant. Possédant cette personnalité si
semblable à celle de maman, Albina n'était pas pour nous une étrangère.
Le plus vieux, de deux ans mon
aîné, était Fernand. Un autre Rioux, copie de son grand-père en tout point.
Non seulement, il en possédait tous les traits; il était de plus presque
aveugle comme lui. Fernand et moi étions les deux inséparables. D'ailleurs
durant toute notre vie, nous affichons l'un envers l'autre une amitié et une
affection mutuelle comme deux jumeaux identiques. Il ne nous est jamais
arrivé de connaître de différends; c'est un phénomène que je ne peux
m'expliquer moi-même, sinon que les traits de l’un complètent ceux de
l’autre. D’ailleurs, je lui ai dit dernièrement, je crois que lorsque nous
étions jeunes, si je marchais toujours devant de toi, c’est parce que
j’étais tes yeux. Et aussi parce que j'étais très grand pour mon âge et lui
était plutôt petit.
Jean-Paul était complètement
différent. Il avait tout de la famille de son père, de l'allure physique,
aux traits de caractère. Bien qu'il eut presque mon âge, nous n'avons jamais
pu être copains tous les deux; même s'il n'y eut pas entre nous
incompatibilité de caractère. On ne s'est jamais chicanés, engueulé ni
bagarrés; nous n'allions pas ensemble, c'était tout. Assez curieusement, Viateur, Germain et lui constituaient un trio très harmonieux; ils ne se
séparaient jamais, avaient les même goûts et aimaient les mêmes jeux. La
plupart du temps nous nous suivions tous les cinq; les deux Fernand en avant
et les trois autres derrière.
La première des filles était
Aline. Physiquement, elle était la répétition de Fernand. Surtout le
visage, qui était identique. Elle avait hérité les même gênes, à
l'exception de la mauvaise vue de son grand-père. Thérèse qui la suivait,
avait, tout comme Jean-Paul, hérité les traits de la famille des Gagnon. Une
autre fille, dont je ne me rappelle pas du nom parce qu'elle était plus
jeune, (je crois qu’il s’agit de Mariette) me ramène à la mémoire son
souvenir à cause du fait que celle-là n'avait pas pu se débarrasser de sa
suce et de sa bouteille de lait avant d'aller à l'école. Et même, je me
souviens qu’au début de l’année, elle cachait sa bouteille pas loin de
l'école pour pouvoir la reprendre le plus tôt possible à la sortie
l'après-midi. Léonard était le dernier des garçons dont je me souvienne. On
l’avait surnommé, le nombril, et pour cause; on avait mal rattaché son
cordon ombilical et il lui restait une grosse "bean" qui était
visible même au travers de son linge. Il l’a fait opérer, il était près de
la cinquantaine. Je ne peux pas parler des autres dans ce paragraphe car
étant plus jeunes ils ne représentaient pas pour nous des amis de jeu. Ils
étaient aussi des enfants encore trop jeunes, (ou pas encore nés) pour afficher leurs futures
personnalités; c'est pourquoi il m'est difficile d'en parler davantage.
Un an ou deux avant que Gérard
n’achète la terre au quatrième, il avait trouvé un emploi à St-Mathieu. Il
trouva un logement au village et décida de quitter la belle paroisse de
St-Fabien pour y installer sa famille dans une maison appartenant à Gérard
Belzil, voisin de la beurrerie appartenant aussi à Gérard Belzil, dans la
rue de la Beurrerie; Original!
Durant ce temps, nous avions
pris l'habitude d'aller déjeuner chez les Gagnon le dimanche matin. Le curé
donnait la communion vers les huit heures, (après avoir pris soin de nous
passer au confessionnal et nous faire accuser de péchés imaginaires) ce qui
nous laissait une heure et demie pour aller déjeuner avant la grand-messe.
Ce n'était pas un luxe. On s'en souviendra, à cette époque, nous n'avions
pas le droit de manger avant de recevoir le Christ dans son cœur. Nous
devions nous lever très tôt le matin pour faire le train des animaux, et il
va de soi qu'après avoir besogné durant deux bonnes heures, nous avions très
faim. L'Abbé Bérubé avait décidé de donner la communion plus tôt, afin
justement, de permettre au monde de déjeuner avant la grand-messe. Sinon, il
fallait attendre la fin de la messe, vers onze heures trente. Et, lorsque
arrivés à la maison avec les voitures à cheval, il devenait impossible de
dîner avant midi et demi aux moins, et cela était impossible à supporter
autant pour ces fermiers qui avaient déjà trimé dur le matin que pour les
enfants qui, comme on le sait, ont toujours faim. Nous apportions nos sanwiches mais Gérard et Albina nous offraient des Corn Flakes; que nous
n'avions jamais vus ni goûtés. Bon Dieu que c'était bon! il n'en fallait
pas plus pour que nous souhaitions la venue de cette famille dans notre
entourage.
La coutume voulait que nous
allions nous confesser au moins une fois par mois avant la communion. On se
cherchait des péchés imaginaires qu'on allait confesser en mentant pour
obtenir l'absolution. On nous enseignait à toujours dire la vérité, et on
nous forçait à mentir au confessionnal. Nos cerveaux d'enfants ne
comprenaient pas très bien ce genre de contradictions. Mais quand même, le
pardon de nos péchés imaginaires nous donnait droit à l'Eucharistie, ce
sacrement qui n'entrait que dans une âme purifiée et blanche. Mais les Corn
Flakes eux, entraient sans discrimination dans tous les estomacs qui avaient
faim, et nous avions hâte que finissent ces cérémonies que les adultes nous
avaient appris à prendre au sérieux sans se poser de questions sur leurs
raisons d'être.
Papa qui respectait souvent
certaines idées préconçues n'achetait pas de céréales comme les Corn Flakes;
il croyait que le gruau était beaucoup plus nutritif et soutenant. (Il faut
dire que dans ce temps-là, le gruau était le déjeuner standard des
Québécois, coutume acquise après la Conquête en 1760, car avant cette date
les canadiens ne cultivaient même pas l'avoine, n'en ayant pas besoin pour
leurs besoins personnels. On se nourrissait de pain fait de farine de blé
froment. On a même attendu un siècle et demi environ après les débuts de la
colonisation pour entreprendre la culture de la patate. La vraie culture de
la patate a commencé vraiment au Québec après les premières années du
défrichement de Baie-Des-Sables, là où le sol s'y prêtait si bien. La
paroisse de Baie-des-Sables a été peuplée par les habitants de Charlevoix,
de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick à partir de 1850 mais les vrais
pionnier étaient les enfants de Hilarion Thibault, premier Thibault et
première ou deuxième famille à s'installer à St-Simon, après une famille de
Jean, qui sont partis de St-Simon dans les années 1842 pour aller s'y installer.) Papa avait sûrement raison, mais nous aurions aimé avoir le choix
de temps en temps. Il ne voulait pas non plus que nous mangions notre pain
grillé, il croyait qu'alors, on en mangeait plus pour obtenir la même
valeur nutritive, et à la fin, il en coûtait plus cher, etc. Aussi par
principe, on devait se nourrir autant qu'il en était possible des produits
de la ferme et acheter seulement des produits essentiels qu'on ne peut pas
produire; comme par exemple, le sucre, la farine, qui, ajouté aux produits
de la ferme permettaient de confectionner toutes les recettes du temps.
Seuls entre nous, nos jeux
étaient limités, mais en joignant les deux familles, on pouvait former des
équipes pour la balle, le hockey ou l'attaque, même pour aller glisser en
traîneau dans nos magnifiques côtes! On s'amusait beaucoup plus en groupe.
Même si nous n'avions pas dans ce temps-là les jeux variés qui sont offerts
aux enfants d'aujourd'hui, on s'amusait ferme. Et, même si tous ces jeux
avaient existé, leur importance aurait été bien minime en comparaison de
l'arsenal de possibilités que la nature même, mettait à notre disposition.
Jamais K-tel, Kenners et compagnie fabriqueront forets, lacs, cours
d'eau ou patinoires naturelles de huit milles de long, collines, ruisseaux
frétillant de truites, cabanes à sucre, et autres milliers de choses qui
intéressent les enfants. Nous faisions semblant d'aller à la chasse avec des
semblants de fusils que nous fabriquions avec un bout de planche et nous
allions à la vraie pêche avec de vraies lignes et de vrais vers de terre;
que l'on appelait des anchois ou des anchais !
L'automne, nous attendions la
première glace sur le lac pour chausser les patins, empruntés à nos oncles;
souvent des patins qu'ils avaient mis de côté parce que trop vieux; avec des
lames qui ne coupaient plus. Aussi nous utilisions de vieilles lames sur
lesquelles nous fixions de vieilles paires de bottines de travail, qu'on
remplissait à l'aide de nombreuses paires de bas de laine. C'était chaud
pour les pieds, heureusement, car nous passions de grandes journées dehors
et le bas du fleuve n'est pas renommé pour son climat tempéré en hiver. Mes
enfants n'auraient pas patiné avec ce genre d'équipement, mais nous, nous
n'avions même pas l'idée de nous plaindre. Au contraire, nous nous
considérions privilégiés d'avoir des patins, et qu'importe le style,
l'important était que nous puissions nous amuser. Et de pouvoir patiner
quand la glace était là; c'était le summum du plaisir.
Ce fut vers l'âge de onze ans
que j'eus ma première paire de vrais patins. Bertrand Rioux m'avait cédé ses
patins presque neufs (un peu petits pour lui), pour dix dollars que papa
avait payés bien sûr. C'étaient des CCM, grandeur 9, que j'ai conservés
jusqu'à l'âge de trente ans je crois; même s'ils ont toujours été un peu
trop petits après que mes pieds eurent atteint leur grandeur normale. Nous
patinions sur le lac durant presque un mois avant qu'il devienne impossible
de déblayer la neige à cause des grands vents. Après, nous faisions une
petite patinoire derrière la maison des Gagnon. Cet endroit était plus
protégé des vents. Des puits de surface étaient aussi disponibles pour
l'arrosage.
L'arrosage était une tâche qui
nous incombait; tâche que nous devions exécuter les samedis ou les
dimanches. Les plus vieux qui aimaient bien venir patiner le soir, parfois
avec leur blonde, étaient occupés dans le jour et ne pouvaient nous aider.
Pour le déneigement, c'était un peu différent, parce que les plus vieux
aimaient venir patiner les soirs de semaine et, vu que nous passions la
journée à l'école, nous n'avions pas le temps de déblayer. Donc, les
patineurs devaient déblayer eux-mêmes s'ils voulaient profiter de ce loisir.
L'arrosage était une tâche très ardue. Nous utilisions le même style de
baril monté sur un traîneau, tiré par un cheval, que l'on utilisait pour
transporter l'eau d'érable le printemps à l'érablière. Nous devions déneiger
le puits afin d'ouvrir la trappe qui le recouvrait. Puiser l’eau et la
verser dans le tonneau n’était pas chose facile. Il était impossible de ne
pas s'arroser complètement le corps avec l'eau qui s'échappait durant le
transvidage; chose très difficile pour nous qui étions encore de trop
petite taille pour utiliser des outils conçus pour les adultes. Nous
devenions des bonhommes de glace. Heureusement que le linge très épais, en
étoffe du pays, imperméable que l'on portait dans ce temps-là, nous gardait
au chaud même dans les pires conditions. Autrement nous aurions toujours été
malades, et pourtant, je ne me souviens pas que nous ayons été affectés
d'autres maladies que des rhumes à l'occasion et certaines maladies
d'enfants.
La neige aussi, nous
permettait des jeux de toutes sortes. Nous avions des côtes aux pentes
variées et de dénivellations inégales. Nous pouvions glisser soit en
traîneau ou simplement sur des cartons épais ou encore en s'asseyant sur nos
raquettes; toujours dépendant des conditions de la neige et des pentes que
nous choisissions. Il fallait simplement harmoniser les équipements aux
conditions. Nous aimions aussi aller glisser dans les chemins de bois, dans
les grandes côtes, en forêt, que papa utilisait pour charroyer le bois avec
les chevaux. Les "bobsleighs" chargés de bois, auxquels il fallait passer
une chaîne transversale autour des patins, servant de freins dans les
grandes descentes, creusant un canal profond et sécuritaire dans la neige
durcie permettait à nos traîneaux de filer à des allures impossibles
ailleurs. Et comme c'est le propre de l'être humain de toujours vouloir
aller plus loin et plus vite, la grande côte chez le père Georges,
s'étendant sur quatre arpents de long, était notre préférée.
Étant donné que le bois était
un matériau que nous avions en abondance, nous avons appris, dès notre jeune
âge à fabriquer nous-mêmes nos jouets. Pour l'été, nous avions érigé
quelques balançoires tournantes (style grande roue dans les cirques) à deux
ou quatre sièges, et pour l'hiver; skis, traîneaux et toboggans, dont le
maître d’œuvre était Fernand
Gagnon, deux ans de plus que moi, excessivement doué et habile, malgré son
handicap visuel.
Avec des planches d'érable on
fabriquait des skis, d'allure plutôt rustique; qui glissaient quand même
très bien après les avoir enduits d'une bonne couche de paraffine,
remplaçant la cire. Les bottines de skis n'existant pas, du moins pour nous
dans ce temps-là, nous devions utiliser nos chaussures de tous les jours ou
encore nos chaussures de raquettes (pichoux blancs) que nous fixions à nos
skis avec des lanières de cuir. Exactement comme les attelages de
raquettes. Ce genre d'attelage n'était pas sécuritaire et le contrôle des
skis presque impossible. On jouait de chance; heureusement, on ne s'est
jamais blessé. Seul Siméon avait reçu le bout de son ski sur la gueule et
s'était fait casser le bout d'une dent en prenant une fouille très
spectaculaire en bas de la côte derrière la maison. Cela ne nous a pas
arrêté pour autant car plutôt d'avoir eu peur, nous avions ri aux larmes. Ah
que c'était une belle débarque! Un spectacle fort en émotions, qui
nous retint le souffle quelques instants, et hop ! Siméon s'était relevé
sans mal apparent. Cet instant fatidique avait déclenché le signal de
départ et tous se sont retrouvés en bas de la pente, pour partager avec le
héros l'émotion qu'il avait vécue durant cette aventure.
On se fabriquait aussi des
grattes que l'on fixait à l'avant de nos traîneaux pour entretenir nos
sentiers d'amusement, spécialement après les chutes de neige. Nous
fabriquions aussi ce qu'on appelait; des toboggans. ( On disait, des tabagans) En fait, il s'agissait d'une planche de tonneau de vin, déjà
courbée par le fabriquant, sur laquelle on fixait un banc d'environ quinze
ou dix-huit pouces de haut. (On s'asseyait sur ce cabarrouette et
descendions des pentes
très abruptes, courtes; à des vitesses effarantes, considérant ce genre de
véhicule primitif qui requiert beaucoup de souplesse et une grande habileté.
L'absence de peur doit laisser toute la place au seul goût de s'amuser. Les
adultes étaient incapables de glisser avec ces gréments.
Souvent, avec l'aide d'une
planche qui servait en même temps de siège, on pouvait relier deux toboggans
en un tandem De cette façon, nous pouvions faire des descentes à deux. Ce
genre de bicyclette sur skis se contrôlait bien et nous permettait quand
même des sensations fortes. Le danger de fouiller tête première dans
la neige était toujours présent, et quand ce genre d'incident se produit, il
arrive souvent que l'on se fasse très mal, mais heureusement on ne s'est
jamais cassé de membres. Il existe sûrement un Dieu protecteur d'enfants
pour cette marmaille inconsciente et sans peur.
Comme tous les enfants, on se
creusait des forts dans les bancs de neige ainsi que des tunnels qui les
reliaient les uns aux autres. Après quelques semaines ces labyrinthes
sentaient le renfermé et nous devions alors les aérer ou en creuser
d'autres. Nous aimions aussi sauter de très haut dans des épaisseurs de
neige volage fraîchement tombée jusqu'à ce que nous réussissions à nous
enfoncer jusqu'aux épaules. Souvent, il fallait l'aide de copains qui, avec
une pelle, devaient creuser autour de nous afin de nous dégager de cette
situation qui déterminait celui qui avait réussi le meilleur exploit. Quels
jeux merveilleux où les plus grands dangers ne représentent que de plus
grands défis à relever!
Fernand Gagnon et moi avions
essayé de fabriquer un "ski-doo". Nous voyions ces grosses auto-neiges et
nous pensions qu'à partir du même principe, nous pourrions fabriquer un
véhicule sur une seule chenille pouvant transporter une personne. Mais
devant notre incapacité à trouver un moteur et de rendre fonctionnelle toute
une mécanique aussi complexe que l'image que nous avions en tête, nous
avions décidé de fabriquer notre véhicule, à propulsion humaine. Quelques
rouleaux de bois entre deux planches, retenus à chaque bout par un gros
clou, leur permettaient de tourner; une toile servait de chenille. Le tout
était monté sous un traîneau, à l'avant duquel nous installions un ski
pour la conduite, et le tour était joué. Étant donné l'absence de moteur,
nous devions pousser le ski-doo dans les sentiers que nous avions
grattés avec notre traîneau gratte; ce qui demandait des efforts
surhumains. Notre invention ne prit la vedette que quelques heures. Mais je
me demande encore où notre imagination d'enfants de dix à douze ans avait
pris cette idée car il s'agissait bien de l'idée que Bombardier a
développée et qui est devenue la moto-neige telle que nous l’avons connue
quelques années plus tard. Avions-nous entendu parler de la possibilité de
construire un tel véhicule? Avions-nous déjà vu des esquisses de modèles?
Je n'en sais rien, mais une chose demeure; rien ne nous échappait même dans
nos campagnes loin des grands centres. Ou, avions-nous déjà vu les
inventions de Fortunat Jean? C’est bien possible.
Après avoir vu Mathieu Dionne
venir atterrir son avion sur skis, sur le lac en hiver, nous avions eu une
autre inspiration; celle de fabriquer un avion, sans moteur bien sûr. Donc,
il s'agissait plutôt d'un planeur. Nous avions auparavant fabriqué un
traîneau avec de vieux skis. Cela permettait une meilleure flottaison sur la
neige, par conséquent, la possibilité d'atteindre des vitesses beaucoup
plus élevées. Bien que très lourd parce qu'on l'avait fabriqué entièrement
de bois franc, nous avons cru qu'il était le plus approprié pour devenir
notre prototype. Aussi, nous avions utilisé une planche d'environ six ou
sept pieds de longueur sur huit pouces de largeur, avions gossé les
rebords pour lui donner plus de mordant dans le vent, imitant ainsi les
ailes de l'avion de Mathieu, qui était à l'époque les seuls que nous avions
eu la chance de voir et de toucher. Nous avons alors fixé ces ailes sur
notre véhicule d'essai. Nous sommes allés juste derrière la maison, là, où
la côte était le plus à pic et où un beau petit verglas recouvrait la
neige; conditions idéales! Nous avons aligné le prototype bien droit et
l'avons propulsé vers le bas. Il était beau à voir aller, à toute allure!
Mais il ne levait pas, et soudainement il a heurté de plein fouet un poteau
de clôture gelé qui a éclaté sans même le ralentir d'un seul iota. Les
résultats étaient probants; il nous faudrait améliorer notre prototype quand
nous en aurions le temps. Mais la spontanéité de l'enfance nous emmena
ailleurs vers d'autres passe-temps et, l'oubli se chargea de nos ambitions
d'inventeurs. Viateur me dit qu’on l’avait fait monter notre prototype et
c’est lui qui s’était senti coupable d’avoir cassé le poteau de clôture.
Au printemps, le temps des
sucres occupait tous nos temps libres. Bien sûr, tous les jours, il fallait
continuer d’effectuer nos tâches à la grange soir et matin. Tâches beaucoup
plus grandes à ce temps précis de l’année à cause des veaux qui arrivaient
au printemps. Donc les samedis et les dimanches, nos jours de congé
consacrés à la cabane à sucre, s’en trouvaient raccourcis, à cause du temps
supplémentaire qu’on devait accorder aux trains deux fois par jour.
Bientôt le dégel du lac devenait un évènement que nous ne pouvions pas
manquer, spécialement les jours avant que les grands vents de printemps ne
le dégagent entièrement de ses glaces. Durant ces jours-là, la glace est
encore très épaisse mais elle se fracture en maints endroits et forme des
pièces de plusieurs mètres carrés, tout au bord. Avec de grandes perches,
nous pouvions déplacer ces gros radeaux improvisés, les éloigner ou les
rapprocher, marcher des uns aux autres, casser de nouveaux morceaux, et s'en
fabriquer d'autres. Ce genre d'amusement nous faisait oublier les heures, et
les jours semblaient avoir raccourci au lieu de rallonger en cette période
printanière. Pour l'adulte que je suis maintenant, depuis hélas trop
longtemps je le constate, ces jeux me semblent dangereux. Pourtant, il
s'agissait pour nous d'une complicité avec la nature qui nous offrait
allègrement ses divertissements sains et variés en toute saison.
L'été, on ne manquait pas de
divertissements; même si les vacances de l'école libéraient nos journées
entières. Être élevés à la campagne et spécialement sur une ferme, présente
des avantages qui ne trouvent pas leur équivalent en ville. Les enfants
peuvent s'acquitter avec plaisir de menues tâches journalières comme aller
chercher les vaches pour la traite et aller les reconduire après. Ils
peuvent effectuer presque toutes les tâches coutumières dans l'étable. Ils
peuvent aussi aider aux travaux de la ferme, tels que: la réfection des
clôtures, les semences, les récoltes et de nombreux autres menus travaux que
l'on apprend à faire très tôt lorsqu’on est enfant de fermier. Les jours où
nous n'avions pas le goût de suivre notre père aux travaux des champs, nous
allions soit pêcher dans les ruisseaux, soit cueillir fraises, framboises,
gadelles, groseilles, noisettes; enfin tout ce que la nature offre dans ses
champs. De plus, à partir de la fin juin jusqu'à la mi-août, notre terrain
de jeu préféré était sans contredit le lac. On s'y baignait, on y jouait, on
se promenait en canot, etc. L'automne et le printemps, on y pêchait la
truite assis sur des quais de roches, le soir, et l'anguille en canot, à la
noirceur, à l'aide d'un fanal au gaz qui fournissait un éclairage très fort
attirant cette espèce de serpent poisson qui a si bon goût lorsque bien
préparé. Le lac était aussi la route la plus courte pour aller au village;
en canot l'été et à pied l'hiver. Parfois en raquettes, et pour certains
avec leur attelage de chiens. Aujourd'hui, je n'ai qu'à regarder et admirer
ce majestueux lac de mes souvenirs pour le qualifier de paradis de mon
enfance.
L'automne est la saison qui
fait le lien entre la période la plus active de l'année; l’été, et l’hiver,
où la nature est au repos. Aussi les mois d'octobre et de novembre sont les
plus ennuyants et, c'est sûrement durant cette période pré hivernale qu'il
est le plus difficile de se trouver des passe-temps. Je n'ai pas dans ma
mémoire le souvenir d'avoir trouvé un vide quelque part qui aurait pu
inciter à l'ennui. Nous allions tendre des collets aux lièvres, marcher dans
les bois, apprécier le bruit de la perdrix lorsqu'elle s'envole
soudainement, pour échapper aux prédateurs humains. Je me souviens de mon
père, qui n'était pas du tout chasseur, nous allions dans les boisés,
regarder se balader les chevreuils dans la nature; les mâles avec leurs
panaches, les femelles avec leurs petits.
Nous devions aussi
préparer nos jouets pour l'hiver. Dans la région du bas du fleuve, le froid
arrive très tôt; bien avant la neige. Dès la mi-octobre, de grandes
patinoires se formaient un peu partout dans les champs nous permettant de
patiner avant que le lac soit suffisamment gelé et sécuritaire.
Les Gagnon et nous devaient
ressembler à des enfants tout issus de la même famille, même si
physiquement nous étions aussi différents que si nous avions été des enfants
de race différente. Par contre au point de vue de la mentalité, des manières
et du langage, nous étions issus de deux mères qui non seulement étaient
cousines frérot, mais elles avaient été élevées voisines l'une de
l'autre, se confondant tous les jours en deux familles qui ne devenaient
qu'une. C'est Gérard qui avait faussé la lignée des Rioux, car contrairement
à papa qui avait été élevé à quelques voisins de distance de maman, qui
avait fréquenté l'école avec elle (jusqu'à la troisième année primaire,
c'était la moyenne dans ce temps-là) , Gérard lui, venait de St-Fabien, et
d'après ce que je me souviens de lui, il était issu d'une famille
complètement différente; heureusement car l'homogénéité aurait été trop
accentuée.
Si l'arrivée des Gagnon
s'avérait très intéressante pour nous, il en était autrement pour papa qui
perdait son partenaire en la personne de Pit Desjardins. Il savait ne pas
retrouver en Gérard un partenaire avec qui il pourrait collaborer comme
avant avec Pit. Cependant il ne fut pas seul longtemps. Omer qui cherchait à
s'établir quelque part était venu demeurer chez-nous quelques temps. Je ne
me souviens pas s'il avait déjà acheté sa terre à ce moment-là, s'il
attendait de se marier avant de prendre possession de la maison ou si
Fortunat Jean était demeuré dans la maison quelques mois avant de trouver
une maison à St-Simon. De toute façon, il demeura chez-nous quelques temps,
épousa Agnès et emménagea dans sa propre maison. Omer devenait un partenaire
idéal. Les deux frères travaillaient ensemble presque à l'année longue. De
plus Siméon était lui aussi devenu en âge de travailler et avait à toute fin
utile élu domicile chez-nous. Dès qu'il revenait des chantiers, normalement
avant les sucres, il revenait aider papa à préparer l'érablière et la
cabane à sucre pour la récolte printanière. Et, afin de ne pas travailler
seulement pour gagner sa subsistance, il partageait avec papa une partie des
revenus de la vente du sucre. Il faut expliquer ici que dans le bas du
fleuve dans ce temps-là, on ne vendait presque pas le sirop d'érable; on
devait convertir le sirop en sucre dur, en pain de quatre ou cinq livres,
et c'est comme ça que la récolte s'écoulait. Autres temps, autres mœurs!
Lorsque nous sommes partis en
1951, je croyais que Gérard avait acheté un morceau de notre terre pour
agrandir la sienne, mais c'est Fernand qui l'avait achetée et il en est
toujours propriétaire au moment où j'écris ces lignes. Malgré cela,
Gérard n'est pas demeuré au quatrième longtemps. Il a acheté dans le
troisième rang, (dans la partie que nous appelions; le bas de la
paroisse,) une plus belle et plus grande terre (l'avant dernière terre
de St-Mathieu, voisin d'Emile Letourneau, dont un des fils a marié Thérèse
Gagnon). Je crois qu'il avait donné à Fernand la terre du quatrième.
De toute façon, les bâtiments furent démolis et personne ne l'a plus
jamais habitée. (C'est Jacques Ouellet, celui qui avait acheté la terre d'Omer
qui devint propriétaire de la terre de Gérard également) Fernand n'était
pas encore marié, il demeurait toujours avec ses parents et aidait son père
à cultiver la terre du bas de la paroisse. Fernand qui, comme son
grand-père, est aveugle à environ quatre-vingt-quinze pour cent n'a
certainement jamais eu le désir d'essayer de vivre de l'agriculture. Pendant
ce temps, Gérard s'était recyclé cultivateur boucher. Il faisait l'abattage
d'animaux et vendait la viande au détail, ce qui lui rapportait un revenu
supplémentaire. Mais il semble que même avec ce genre de double emploi cela
n'a pas suffi à générer assez de revenus pour assurer la subsistance de sa
famille et assumer les dépenses d'opérations. Cela semble évident
maintenant, Gérard n'était pas fait pour vivre essentiellement de
l'agriculture. D'ailleurs après avoir essayé d'en vivre durant quelques
années, il a senti que les choses l'entraînaient de plus en plus vers la
dérive. Aussi, ai-je entendu dire que vers les années 1975, il a dû remettre
toutes ses propriétés à l'Office du Crédit Agricole. D'après une note que
j'avais gardée, il déménagea au village et il mourut de troubles cardiaques
en 1981. Il était encore relativement jeune, 69 ans.
Fernand qui avait rencontré
une perle de petite fille quelques années auparavant avait contracté
mariage, et n'étant pas très fortuné, il s'était aménagé un logement dans la
maison de ses parents. Il dut bien sûr déménager lui aussi lorsque Gérard
quitta sa terre. Mais, même s'il avait déjà commencé à fonder sa propre
petite famille, cela n'a pas semblé décourager cet autre caractère
typiquement Rioux. Il entreprit de bâtir sa maison au village en face des
D'Auteuil. Il a construit lui-même un très beau bungalow. Il a tout fait de
ses mains à l'exception du plâtrage qui a été effectué par ses frères qui
sont dans ce métier, et les armoires de bois franc qu'il a fait fabriquer
par mon cousin Rénald Bélanger dans sa manufacture de St-Fabien. Il lui a
fallu quelques années pour finir l'extérieur et le sous-sol; par manque
d'argent, car quand il faut compter sur une pension d'aveugle et sur les
quelques sous que lui rapporte son érablière le printemps, patience
s'impose. Même si j'ai été élevé avec ce gars-là et même si j'avais vu
comment il avait aménagé son logement dans la maison de ses parents en
bas de la paroisse, je n'ai pu m'empêcher d'être surpris; de presque
refuser de croire ce que je voyais, tellement, que j’allai lui demander si
c’était bien lui qui avait réussit ceci ou cela, sachant
qu'il ne peut même pas différencier le visage de son meilleur ami, lorsqu’il
est assez près de lui pour le respirer. Quelle habileté, ténacité, et
quel bel exemple de courage!
haut de page
Les années
à la petite école
La petite
école du quatrième, desservait toutes les familles à partir de
chez-nous, à l'extrême ouest, jusqu'à l'extrême est chez Elzéar Lagacé.
Ensuite en revenant vers l'école; lui aussi juché sur la côte, Omer
Ouellet. Au bas de la côte, Charles Dionne, Léonard Berubé, Désiré
Dionne et Ernest Desjardins; Et, dépassant l'école en tournant vers la
droite, ou vers le nord, Cyrice Bérubé, Charles Bérubé et Emile Lagacé.
Presque toutes ces familles étaient concentrées à moins d'un demi mille
de l'école. Sur l'autre côté, à partir de l’extrême ouest, de
chez-nous, à un mille et demi de l'école, il y avait les Rousseau, les
Gagnon et, un peu plus loin, nos cousins, les enfants d'Omer. L'autre
terre à l'est de l'oncle Omer, qui possédait toujours sa maison et sa
grange, avait appartenu à Raoul Vignola; un couple sans enfants qui
l'avait habité durant quelques temps. Cette terre fut achetée par
Georges Rousseau qui avait l'intention d'y établir son fils Mathieu. La
maison ne fut pas habitée pendant quelques années. Je crois que Mathieu
qui avait habité une partie de la maison de l'oncle Omer le premier
hiver après s'être marié, a effectivement habité cette maison durant
quelques temps. Mais Mathieu n'avait sûrement pas l'intention de crever
de faim sur cette terre trop petite dont la plus grande partie était
une côte impropre à l'agriculture. D'ailleurs Mathieu était déjà
menuisier depuis longtemps et il gagnait sa vie à construire maisons et
granges un peu partout. Mais dans ce temps-là, il était presque
impensable à quelqu'un de ne pas vivre sur une terre, même si on gagnait
sa vie ailleurs. Mathieu acheta une bonne terre, lui aussi dans le
bas de la paroisse, qu'il s'acharna à cultiver tout en continuant
de travailler dans son métier pour assurer les revenus supplémentaires,
nécessaires pour nourrir sa grande famille. Il vendit cette terre à un
de ses fils alors qu'il était encore très jeune et, bâtit sa propre
maison sur le terrain où était, quand j'étais encore tout jeune, la
maison de sa grand-mère Rousseau, voisin de la maison que son père
avait bâtie sur une partie du terrain appartenant jadis à sa
grand-mère.
Pour aller à
l'école, il nous fallait marcher un mille et demi et, bien sûr autant pour
en revenir. C'était une très longue marche pour de jeunes enfants qui
souvent avaient dû marcher longuement pour aller chercher les vaches
pour la traite et aller les reconduire sur des terres voisines après.
Scénario que l’on devait répéter le soir. Quand il n'y avait pas de neige,
cela semblait assez facile, bien que l'automne, en particulier, le mauvais
temps, la pluie et le froid nous rendaient la vie très difficile. Mais ce
sont les tempêtes d'hiver qui nous causaient des cauchemars. Non seulement
les chemins des rangs n'étaient pas entretenus l'hiver mais étant donné que
ce chemin n'était utilisé par personne durant cette période, on
n'entretenait même pas un chemin d'hiver pour voiture à cheval. Aussi, dès
qu'il y avait une certaine accumulation de neige sur le terrain, même Irène
Rousseau ne pouvait plus nous amener avec elle dans la voiture derrière le
cheval, qu'elle réussissait habilement et, au grand plaisir de son père, à
atteler et à conduire de main de maître. Près de l'école, Ernest Desjardins
(frère de Pit) possédait toujours une petite étable où Irène laissait son
cheval pour la journée.
Ces faveurs
d'Irène, qui prenait soin de moi comme une mère, n'ont pas duré très
longtemps. Lorsque j'étais en première année, elle, était en cinquième.
Aussi à la fin de ma deuxième année, elle a dû aller à l'école du village et
moi, je dus me débrouiller tout seul comme un grand. Seul le père Georges
venait nous reconduire de temps à autres en voiture, car Adèle qui était
encore jeune, à peine un an de plus que moi, était petite et fragile et, il
ne voulait pas risquer qu'elle attrape du mal. Quant à mon père qui a
toujours joué les durs, il croyait que la meilleure façon de faire des
HOMMES avec nous, c'était de nous laisser nous débrouiller tout seuls,
et à moins que les conditions lui semblent intolérables, il arguait à maman
que ce n'était pas si pire que cela, que nous n'aurions pas de problèmes et
que de toute façon, il avait beaucoup trop de travail pour s'imposer cette
corvée supplémentaire. Nous n'avons pas péri! Cela donna sûrement raison à
notre père. Combien de fois sommes-nous revenus de l'école sous des froids
de -20 degrés et davantage, de tempêtes, où on ne voyait ni ciel ni terre?
Notre instinct nous guidait vers les endroits près des bois au bas des
collines, là où nous pouvions trouver un peu d'abri; même si souvent la
neige n'en était que plus abondante et retardait davantage notre marche.
J'étais toujours le plus grand et je guidais les plus petits, qui marchaient
dans mes pistes, et me suppliaient de faire les pas plus courts. Nous
devions parfois mettre des heures à faire ce trajet, et je suis sûr que
maman s'inquiétait de nous; même s'il ne m'est jamais arrivé de penser qu'il
était possible que quelqu'un s'inquiète de notre sort. Car pour nous,
seules les difficultés à surmonter nous inquiétaient; le danger lui,
n'existait pas.
L'hiver, je le
répète, le chemin entre chez l'oncle Omer et l'école, n'était pas entretenu;
spécialement depuis l'arrivée du Snowmobile, que le facteur utilisait
maintenant quotidiennement. La neige durcie et gelée sous les traces des
chenilles rendait impossible à un cheval de marcher dans un chemin qui
n'était pas conçu pour lui. Beau temps, mauvais temps, il fallait donc
marcher. Moi, j'avais vieilli de quelques années et, cela faisait toute la
différence. Je devenais le leader et le protecteur de ces jeunes qui chaque
année devenaient de nouveaux écoliers.
Je me rappelle
que les vents sur la côte étaient très froids et très violents. Nous
chaussions plusieurs paires de bas dans nos petits rubbers (petits
bottillons en caoutchouc, très froids pour les pieds, à moins d'y enfiler
plusieurs paires de bas) ou encore dans nos pichoux blancs.
(Mocassin, idéal pour la marche en raquette, fait de peau de porc mince, de
couleur grise, excessivement glissants dans la neige; rendant la marche très
difficile. Très chauds à cause du cuir et du nombre de paires de bas qu'on
peut y enfiler) C'est grâce aux nombreuses paires de bas que nous avons
évité les engelures aux pieds. Nous portions aussi de grands caleçons longs
et camisoles, tricotés par nos mères, avec de la laine de nos propres
moutons, (très piquante) qu'elles avaient cardée et filée durant les jours
froids de l'hiver. Nos sous-vêtements comprenaient aussi les combinaisons
Penmans ou Stanfield 91% pure laine avec porte à l'arrière en cas de besoins
urgents. Et comme pantalons, nos mères nous confectionnaient des pantalons
au style le plus populaire du temps, des Breeches en étoffe du pays
et des Mackinaws (un mot que l'on utilisait dans le bas du fleuve et
que l'on changea plus tard pour Parka, toujours un mot indien mais peut-être
pas dans la langue de ceux qui avaient habité le bas St-Laurent avant nous)
avec cagoule bordée de fourrure, souvent une queue de renard argenté.
C'était très
chaud et confortable. Mais malheureusement les fermetures éclairs
n'existaient pas; ce qui rendait les choses périlleuses pour une certaine
petite partie de notre anatomie. Le vent glacial s'introduisait rapidement
dans la braguette et, il arrivait souvent que nous constations que nous
avions le zizi plutôt raide lorsque nous essayions d'uriner quand le besoin
se faisait sentir. Ou encore lorsque nous arrivions à la chaleur, nous
ressentions soudainement un drôle de picotement; le petit glaçon dégelait!
Fernand Gagnon
et Adèle Rousseau étaient plus vieux que moi, mais j'étais le plus grand.
Et, c'était le plus grand qui battait la piste pour les autres qui
suivaient à la file indienne. C'était dur, mais cette marche n'en était pas
moins un certain jeu. Car après avoir passé la journée assis sur un banc
d'école, elle nous libérait de ce cadre discipliné, et nous permettait de
donner libre cours aux façons les plus diverses de dépenser ce surplus
d'énergie accumulée durant ces heures de retenue en captivité. La plus
grande difficulté consistait à escalader la grande côte au départ de
l'école. Souvent Désiré Dionne, à qui appartenait cette terre et, qui
devenait de ce fait responsable de l'entretien du chemin l'hiver,
s'arrangeait quand c`était possible, pour passer la gratte avant que nous
sortions de l'école. Mais lorsqu'il faisait froid, la neige poudrée devenait
très dure et, il était forcé d'abandonner l'entretien. Alors, pour des
enfants à pieds, gravir cette côte très à pic, balayée par le vent du
nord-ouest constituait à chaque fois un défi.
Nous n'étions
que des enfants, mais des enfants acclimatés et endurcis aux rigueurs du
climat, qui, avec l'expérience semblaient devenir de plus en plus
indestructibles.
C'est le
Snowmobile qui nous a fourni le plus beau chemin. Malheureusement, il ne
montait pas la côte au même endroit que nous. Il devait choisir un endroit
moins abrupt et monter tout droit afin d'éviter les dangers de se renverser.
Dès que nous atteignions le sommet, nous avions tôt fait de rejoindre les
traces durcies qui facilitaient notre marche. Vers les années 1948, 49 et
50, nous avons connu des hivers où il est tombé très peu de neige (comme en
1992 et 93) et, bien sûr, cela nous a aidés beaucoup. Pour trois ans
d’affilée la neige n'avait pas réussi à couvrir le sol avant le milieu de
janvier. Les mois de décembre et le temps des fêtes n'avaient connu que des
pluies verglaçantes et des dégels. Les champs étaient inondés par endroits
et une épaisse couche de glace recouvrait le sol; gelant les racines des
plantes et laissant de grandes étendues de terre improductive l'été
suivant.
Bien qu'il soit
plus facile de marcher dans les traces du Snowmobile, notre goût de
l'amusement et de l'aventure nous forçait souvent à reprendre la route des
champs le long des bois. Le père Georges tendait des pièges aux renards dans
les clôtures de pieux et nous allions de temps en temps vérifier s'il n'y
avait pas, encore une fois, un renard qui s'y est pris; malgré son instinct
de fin renard. Je me souviens d'une fois lorsque Irène était encore
avec nous, d'avoir vu un renard dans un piège. Il essayait de s'en défaire,
jusqu'à ce qu'il ait la patte coupée et qu'il concède la victoire au piège.
Irène le voyant souffrir, s'empara d'un bout de bois et l'assomma, afin de
mettre fin à son angoisse. Le renard rendit l'âme et Irène l'apporta à son
père, qui fut très heureux de sa capture. Car il ne faut pas oublier que le
père Georges, (dont le grand-père était indien pur-sang, disait-on à tort à
cause de son comportement) vivait encore presque exclusivement de chasse et
de la vente des fourrures. Il faisait partie des trappeurs de son temps et,
chose qui peut nous sembler surprenante aujourd'hui, il existe encore des
trappeurs qui tuent les animaux avec autant d'horreurs. J'étais trop jeune
pour questionner ces choses qui semblaient tout simplement exister comme
faisant partie d'un processus de la nature. Je ne comprenais quand même pas
que l’on puisse faire souffrir un animal. D'autant plus que j'observais mon
père qui ne pouvait pas adresser un fusil vers un animal sauvage et tirer;
même si l'animal serait mort sans douleurs. Par contre cela faisait partie
des aventures et attirait notre curiosité.
Il y avait
aussi le bouc de l'oncle Omer. Il n'aimait pas seulement se mirer dans les
belles voitures, il aimait bien jouer avec nous, même si sa façon de jouer
était pour nous plutôt dangereuse. Il nous voyait venir de très loin,
dressé très droit sur ses quatre pattes, la tête haute; il nous attendait.
Il préparait sa motion, baissait la tête et au moment propice fonçait tout
droit sur nous, et nous faisions avec lui le jeu du toréador. Souvent sa
rapidité l'emportait sur notre dextérité. Un jour, après qu'il eut épuisé
toute la patience de son maître, on ne le vit plus, il avait dû céder sa
chair aux délices des gourmets, sur la table de son propre maître.
Il
n'y avait pas que le trajet qui nous apportait des aventures. L'école
elle-même semblait être issue d'une rapide aventure. Une petite école de
rang, comme il en existait partout dans ce temps-là, à la différence que
celle-ci n'avait pas été construite par le gouvernement. Elle n'avait donc
pas ce style universel d'école de rang que l'on retrouvait dans toute la
province. Non, c'est celui-là même qui agissait comme commissaire à cette
époque; Désiré Dionne, qui l'avait construite. On disait qu'il l'avait
construite à ses propres frais. Il n'y avait pas d'école dans le rang
quatre. Mais j’ai un vague souvenir qu'il y avait sur la terre de l'oncle
Omer (l'ancienne terre de M. Protais dont le nom était, je crois, Fournier,
probablement le père ou le grand-père d'Arthur Fournier, et que les jeunes
de l'époque surnommaient monsieur Péta) les vestiges d'anciennes fondations
en pierre des champs sur lesquelles avait été érigée une école. Je ne sais
pas où allaient les enfants après que cette école fut démolie.
(Il serait
logique qu’elle ait été démolie juste après la construction de l’autre, qui,
plus grande et mieux située, pouvait accommoder tous les enfants du
quatrième) Il y avait moins de familles au sud du lac que lors de la
colonisation et le nombre d'enfants ne justifiait peut-être plus la
construction d'une nouvelle école pour ce petit bout de rang.
Mais lorsque
Désiré Dionne s'installa sur sa terre, il laissa tomber en ruines le moulin
à farine de son père et se concentra sur son moulin à scie. Les affaires
semblaient bien aller et, il dut engager des travailleurs qui, voyant que
l'entreprise pour laquelle ils travaillaient progressait vers un avenir
certain, ont décidé de construire leur propre maison à proximité de leur
travail. Bientôt les alentours du moulin à scie ressemblaient à un petit
village, avec sa dizaine de familles.
Désiré Dionne
avait lui-même une assez grosse famille. Il se sentait donc accablé d'une
double responsabilité; celle de faire instruire ses propres enfants et, en
tant qu'employeur, celle de faire instruire les enfants de ses employés.
Étant lui-même dans le domaine des matériaux de construction, il décida de
construire lui-même, et à ses frais, une école dont les familles du rang
quatre avaient bien besoin. Je me souviens que de plus, il fournissait le
bois de chauffage et veillait à l'entretien de la bâtisse. Je crois que le
Ministère de l'Instruction Publique du temps avait accepté qu'il y ait une
école dans ce rang, à condition qu'il n'ait jamais à en faire les frais en
aucune façon; Désiré était le pourvoyeur et bienfaiteur.
Il s'agissait
quand même d'une bâtisse construite à l’aide d’une corvée, avec un minimum
de matériaux importés ou achetés ailleurs. Tout venait du moulin de Désiré.
Lorsque j'étais jeune, cette école était déjà un peu vieillotte, entretenue
dans un semi laisser-aller; mal isolée, très difficile à chauffer, avec son
très petit poêle à bois. Nous étions sept divisions; tout le primaire à la
fois. Près de 25 élèves, la plupart mal habillés, qui sentaient presque
toujours la grange et les animaux, sans compter ceux qui pissaient encore au
lit, (ce qui était courant dans ce temps-là à cause des conditions de vie
des enfants qui attrapaient toujours beaucoup de froid) et qui sentaient la
pisse séchée, senteur qui s'harmonisait bien avec les autres odeurs. Nous
avions aussi les grands (permanents de la quatrième ou de la cinquième
année) qui avaient beaucoup de talent pour distraire les plus petits et
ruiner la patience des institutrices; qu'on ne pouvait garder guerre plus
d'un an à la fois. Les commissaires d'école de la paroisse étaient pour la
plupart presque illettrés et disaient que leurs enfants n'avaient pas
besoin d'instruction, ils n'auraient qu'à faire comme eux; se débrouiller.
Pas surprenant que les choses se passaient comme ça.
C'est dans ce
système issu des années de la colonisation que nous avons été éduqués. Même
Duplessis, qui sans doute, se croyait un homme moderne avec des visions
d'avenir comme doivent toujours en posséder les dirigeants, n'a fait que
contribuer à empêcher l'évolution en construisant de nombreuses écoles de
rang à la grandeur de la province, durant les années cinquante. Il n'avait
pas visionné le progrès des années soixante. Il faut dire que Duplessis
croyait que la meilleure façon de contrôler le peuple était de le garder
dans l'ignorance et, il pratiquait religieusement cette politique.
D'ailleurs il n'a jamais refusé rien aux communautés religieuses et aux
prêtres qui n'ont pas cessé de prêcher en chaire les vertus du Duplessisme
à la grandeur de la province.
La petite école
de rang dispensait les sept années du cours primaire. Il fallait donc
réussir tous les examens, incluant et surtout, l'examen de religion; afin de
pouvoir accéder à l'école du village, là, où l'élève pouvait compléter la
huitième et la neuvième année. Années préparatoires à l’entrée au collège.
L'école du village ne pouvait accueillir qu'un faible pourcentage d’enfants
des rangs; raison pour laquelle la sélection devait être plutôt sévère.
Après la
neuvième année au village, quelques garçons, (les filles ne comptaient pas
encore dans la société, à l'exception des quelques institutrices ou
infirmières) les garçons, de parents plus fortunés, pouvaient avoir accès au
collège de Rimouski, s'ils désiraient devenir médecins ou homme de loi;
notaires ou avocats. Plusieurs devaient opter pour la prêtrise car il semble
que le séminaire pouvait accueillir plus d'étudiants que le collège.
D'ailleurs pour les parents moins fortunés, il se trouvait souvent un prêtre
quelque part qui offrait de défrayer une partie des études de ceux à qui
Dieu avait donné la vocation. On semblait oublier que la vocation était pour
plusieurs le seul moyen de se faire instruire. Le séminaire devait être
subventionné par l'Archevêché, toujours en quête de nouvelles vocations,
pour sauver les âmes de ces gens qui ne savaient même pas qu'il existait
autre chose que le catholicisme. Et par surcroît, tellement endoctrinés
qu'ils n'auraient même pas eu une pensée rebelle à l’endroit de leur
religion, ayant surtout peur du châtiment qu’il leur serait infligé en
passant au jugement de St-Pierre, le portier du ciel.. Donc, un seul petit
collège et un séminaire étaient les deux seules institutions dispensant
l'enseignement supérieur dans tout le comté.
Les années de
la petite école sont quand même celles dont je me rappelle le plus
fidèlement. Je vois encore cette classe de petits, moyens et grands à qui on
avait assigné une place permanente. Les petits en avant, les moyens au
centre et les grands en arrière. J'ai évolué aux différentes rangées, même
aux journées de pénalités où je devais rester dans la shed à bois.
Bien sûr, cela n'est pas arrivé souvent car j'étais de par ma nature un
enfant docile.
Tous ceux de
première année, et de première journée à l'école lorsque nous sommes entrés
en septembre, étaient comme moi; bien nerveux et craintifs devant cet
arrangement austère et discipliné, sous l’œil rigide et froid de cette
Jeanne Parent. Cette institutrice qui semblait vouloir s'acquitter d'une
tâche douloureuse pour elle, selon des principes rigoureux, dans un style
autoritaire, entièrement dépourvu de sens maternel, dont ont tant besoin ces
petits de six ans en particulier. Ils se détachent pour la première fois de
leur mère, ils ont la larme à l’œil et la lèvre tremblante. Heureusement
Irène Rousseau était là, pas loin derrière; elle était ma protection et ma
sécurité. Sans elle l'école pour moi aurait peut-être ressemblé à l'image
que l'on se fait parfois de l'enfer.
Inconsciemment
je détestais cette Jeanne, et je déteste encore son souvenir. Je me souviens
qu'elle s'était fait fabriquer une règle en érable par son frère qui
travaillait au moulin de Désiré Dionne. Elle gardait en vue sur son pupitre
cette règle de deux pieds de long, un pouce et demi de large et un demi
pouce d'épais. Le premier qui levait la tête pour regarder dehors passer une
voiture ou un autre qui avait une distraction, en recevait un coup,
administré avec force, sur une main; le plus souvent au dos de la main, là
où c'est le plus sensible et le plus dangereux. Lorsque j'étais encore en
première année, elle m'en avait soudainement administré un coup par surprise
sans préciser la raison; raison que je n'ai jamais trouvée d'ailleurs. Elle
n'avait rien accompli sinon que je la déteste encore plus et pour de bon.
Note : Lorsque
je suis allé aux funérailles de mon oncle Omer en 2003 elle travaillait à la
salle de réception avec les dames patronnesses ou autres qui avaient préparé
le lunch. Elle était là et sachant que plusieurs de notre famille y
seraient, elle surveillait pour voir si elle allait en reconnaître
quelques-uns. Je ne sais si elle m’a reconnu ou si elle a demandé à
quelqu’un si c’était bien moi. Lorsque je suis allé au sous-sol où elle
était seule, elle m’a demandé, c’est bien toi Fernand, j’ai dit oui mais je
n’avais aucune idée qui elle était. Je ne voyais qu’une grande femme mince
assez âgée mais encore fraîche et en forme. J’ai dit oui mais je n’ai aucune
idée à qui je parle. Elle dit; je t’ai enseigné à la petite école, (pour un
instant elle a piqué mon intérêt) je suis Jeanne Parent. Elle semblait si
gentille et si heureuse de me dire cela que je n’ai pu faire autrement que
de lui dire que j’étais très heureux moi aussi de la rencontrer. Elle
n’avait pas l’air de mériter les reproches que j’aurais aimé lui adresser et
lui expliquer combien elle avait été gauche avec moi et combien elle avait
gâché ma vie. J’ai eu peur de lui faire mal à mon tour et de gâcher sa bonne
humeur en lui racontant ses erreurs de jeunesse et d’institutrice; ce
qu’elle n’aurait jamais dû être, car cela la rendait agressive et peut-être
que durant le reste de sa vie elle fut une personne agréable comme sa sœur
Bibiane qui m’a enseigné quelques années plus tard et que j’avais aimé
beaucoup.
Elle est
revenue quelques années plus tard. J'appréhendais une très mauvaise année.
Si je me souviens bien, je commençais ma quatrième année. J'étais plus vieux
et je ne connaissais ni la crainte ni la peur. J'étais toujours le leader
du groupe du sud du lac et cela me donnait beaucoup d'assurance. Les Dionne
aussi étaient plus vieux. Bruneau était en cinquième année pour la
troisième année consécutive, Bertrand aussi, et les jumeaux Wilfrid et
Wilbrod répétaient leur cinquième année. Lucille en sixième et Denise en
septième (elle est décédée du cancer au début de février 1993 à l'âge de 57
ans) et Rémi était comme moi en quatrième année. Leur père Désiré était
commissaire d'école et, cela leur donnait un peu de prestige et d'autorité.
Ces gars-là étaient déjà des hommes qui conduisaient des camions,
transportant du bois de sciage ou autres marchandises, travaillaient au
moulin à scie de leur père, en plus de prêter leur aide aux travaux de la
ferme. C'est pour ces raisons qu'ils ne faisaient rien à l'école. Par
contre, ils pouvaient calculer mentalement combien il y avait de pieds de
bois dans une pile, avant ou après le sciage, et nous en donner la valeur en
argent. Ils pouvaient démonter un camion ou un tracteur et le ré-assembler;
cela n'avait pas de secret pour eux, non plus d'ailleurs que toute la
mécanique du moulin à scie.
Un jour Jeanne,
dans sa colère, appliqua un coup de règle au dos de la main d'un élève, qui
je crois était Guy Lagacé. Bruno et Bertrand qui n'ont pas apprécié ce geste
en ont parlé à leur père; le commissaire ! Le lendemain, tout fiers, braves
et la tête haute, ils ont décidé de provoquer la fureur de la coléreuse. Les
cloches aux attelages d'un cheval nous avisèrent que quelqu'un passait dans
le chemin en avant de l'école. On était toujours curieux de voir qui
passait, et c'est alors qu'on vit Bruneau et Bertrand qui, d'un seul clin
d’œil se levèrent à l'unisson, bien lentement, et regardèrent à l'extérieur
nonchalamment, en attendant que la fureur s'approche d'eux. Le fait de
réaliser que les deux compères l'avaient volontairement provoquée, l'avait
rendue complètement furieuse sans pourtant se poser la question; pourquoi?
Les élèves qui
n'étaient pas non plus au courant de leur stratagème, ont quand même vite
fait de comprendre leur bravade. Après une courte surprise qui nous a fait
manquer un battement de cœur, on a observé un silence complet et, le
suspense s'étendit sur toute la classe. Tous attendaient en ces quelques
secondes le déroulement de cette scène, qui devait se solder par des
gagnants et une perdante. Mais quelle arme avaient-ils pour se permettre
ainsi une telle arrogance? Étaient-ils en train de pécher par excès de
confiance? Se feraient-ils humilier? Ou justement, mettraient-ils un frein
à cette marâtre?
Toutes les
têtes se levèrent en même temps et, tous les petits yeux hagards se fixèrent
sur la fureur, qui, comme un somnambule s'avançait à pas presque hésitants
vers ses deux commettants. Bertrand, le plus dur des deux, entendit son nom
être prononcé avec dédain et amertume, le premier. Elle croyait qu'en
réglant le cas du leader en premier, ses chances de conserver son autorité
intacte, étaient assurées. Bertrand, dit-elle, tendez la main droite, cinq
coups dans la main droite, maintenant la gauche et encore cinq.
En avez-vous
assez maintenant? Dit-elle.
Si tu veux
continuer de t'amuser, moi, ça ne me fait pas mal répliqua-t-il.
Elle avait dû
remarquer qu'il l'avait tutoyée mais elle n'en fit rien. Sentant que son
autorité diminuait, elle se tourna vers l'autre et répéta le même scénario,
Bruneau la main droite, cinq coups et la main gauche......et juste au moment
où elle avait réussi à propulser sa règle de tous ses muscles, Bruneau tira
si rapidement son bras que la règle lui atterrit sur le genoux, ce qui
changea sa colère en furie. Le visage blanc de rage elle rappliqua et dit;
Bruneau, redonnez-moi la main. Mais Bruneau savait ce qui l'attendait et dès
qu'elle lui prit la main pour la lui tourner et lui servir le supplice
suprême, Bruneau retira sa main de nouveau et lui dit "tu peux frapper à
l'intérieur autant que voudras, j'ai les mains endurcies et je ne sens rien,
mais au dos, jamais. Mon père est commissaire et il dit que tu n'as pas le
droit de faire ça, et que si tu le refais de nouveau, c'est lui-même qui
s'occupera de toi. Elle dut s'incliner devant cette autorité évidente sans
même pouvoir punir ce jeune insolent, qui pour accentuer davantage sa
supériorité osait, non seulement lui faire face, mais encore lui faire
l'affront suprême de la tutoyer.
Après cet
incident nos deux compères ont semblé prendre en charge l'autorité en
commençant par bien se comporter eux-mêmes. Étant devenus des héros, donc
les leaders de la classe, ils n’avaient plus dorénavant à se rebeller, ils
devinrent dociles et les autres en firent autant. Jeanne connut une classe
relativement bien disciplinée par la suite. Vers la fin de l'année, j'avais
moi aussi goûté à sa médecine, même si sa règle était demeurée plutôt
inactive depuis un bon moment. Comme nous étions loin de l'école, nous
apportions notre lunch, que nous mangions la plupart du temps à nos places
respectives. Après le goûter, il restait beaucoup de temps pour jouer à
l'extérieur. Jeanne était cependant responsable de nous, car en l'absence
des parents, ses fonctions lui imposaient cette responsabilité. Alors un de
ces midi, Léonard Bérube (fils de Cyrice) qui n'allait plus à l'école depuis
quelques années, avait déjà dépassé les limites de l'adolescence, et
commençait sûrement à s'intéresser aux filles. Il se tenait par hasard de
l'autre côté de la clôture dans le jardin de sa mère, il regardait Jeanne
par la fenêtre sans que j'en sois conscient.
Est-ce que tu
la trouves de ton goût, ta maîtresse? M’entendis-je demander.
Dans un langage
qui était le nôtre dans le temps et qui reflétait le niveau intellectuel des
écoles de rangs de l'époque, je répondis du tac au tac " non, elle est rien
qu'une maudite vache et je l’haï" J'ai entendu un cri, et c'était mon
non qui était demandé à l'intérieur. Piteusement et déçu d'avoir été pris
sur le fait, je me dirigeai à l'intérieur en me préparant mentalement à
faire face à plus de fureur que je n'en avais jamais vu. En quatrième année,
dix ans et quelques mois, je reçus 14 coups dans la main droite et 7 dans la
main gauche. Je savais que sa plus grande satisfaction aurait été de me voir
souffrir et la supplier d'arrêter. Mais je n'ai pas bronché. Seul mon
orgueil était à la mesure de sa fureur et, j'avais l'habitude des coups: les
coups de poing à la tête et les coups de pieds au cul ne m'étaient pas
étrangers. Mon père croyait que c'était la seule façon de faire de vrais
hommes avec ses gars, je le répète. J'avais des ampoules à la grandeur des
mains, mais je n’avais senti aucun mal durant l’affrontement. J'avais
l'habitude de me durcir et de détacher mon cerveau de toute souffrance; mon
père m’y avait habitué.
Je
l'avais finalement défiée. Tu peux fesser tout l'après-midi si tu veux, j'ai
les mains engourdies et je ne sens plus rien. J'étais fier de moi, elle
savait enfin ce que je pensais d'elle et je ne m'étais pas excusé, ç'aurait
été une lâcheté. Je lui avais tenu tête et m'étais soustrait à toute
sensibilité et c'est elle qui était à bout de fatigue. J'avais gagné! Et
l'important était ce que cela représentait pour moi. C'est peut-être la
première fois que j'ai réalisé que j'avais confiance en moi et cela faisait
du bien à mon ego même si je ne savais pas que l'ego existait.
J'avais encore
une fois défié la souffrance. J'étais endurci. J'ai tellement pratiqué cela
dans mon enfance que j'ai toujours été capable de me soustraire à la
souffrance physique. Je n'en dirais pas autant de la souffrance
psychologique. Je m'endors sur une chaise de dentiste, par contre j'ai
beaucoup de difficultés à assumer mes émotions, je suis plutôt hyper
sensible.
Elle me laissa
tranquille jusqu'à la fin de l'année, ce qui flattait ma fierté, malgré mes
mains meurtries, que je dus cacher à mon père durant quelques semaines; afin
qu'il ne découvrit pas cette effronterie de ma part devant l'autorité: une
maîtresse d'école qui, par la force des choses, remplace les parents lorsque
leurs enfants sont sous sa gouverne. Mon père n'aurait pas toléré ce manque
de respect envers l'autorité parentale, même via une tierce personne. Je
savais qu'il n'aurait pu contrôler sa colère avant qu'il n'ait commit à mon
endroit des rudesses qu'il aurait regrettées toute sa vie. Je voulais à tout
prix éviter ses foudres car j'avais toujours peur qu'un jour il me rende
infirme. Heureusement, il n'en fut rien même si parfois j'endurai des coups
que j'aurais peine à supporter maintenant.
Par contre,
d'autres institutrices étaient douces et gentilles. J'avais parfois besoin
de recevoir ces marques de douceur et d'affection, que ma mère n'avait pas
toujours le temps de m'accorder à la maison. Elles avaient le talent de
donner aux enfants la responsabilité de ne rien faire pour leur déplaire,
parce qu'elles étaient trop aimables. C'était le cas de Bibiane Parent (sœur
de Jeanne) mais totalement différente. Louisiane Ouellet, elle, avait été
excellente lorsque j'étais en troisième année. Je l'aimais et j'avais fait
une très bonne année avec elle. Elle est revenue lorsque j'étais en sixième
année, et là, ce fut un fiasco pour toute la classe. Même moi qui
normalement étais un élève modèle et presque premier de classe, je m'étais
révolté au point de passer des après-midi dehors, dans la shed à
bois en guise de punition. J'avais quand même bien fini l'année car je
m'étais dit que la seule façon de la narguer comme il le faut était de lui
prouver que je n'avais pas besoin d'elle pour réussir. Je m'étais donc
efforcé d'étudier deux fois plus et je finis l’année avec de très bonnes
notes même si je savais qu'elle ne me ferait pas la charité à cet égard.
C'était sa
dernière année d'enseignement, elle se mariait à l'été. Son esprit était
occupé par tous ces préparatifs, et il était évident que son intérêt était
ailleurs, sa patience avait atteint sa limite.
Une autre que
j'ai bien aimée était Béatrice Rioux et, quand je parle d'elle, je réalise
que je vieillissais, car je me souviens qu'elle était grande et jolie fille,
bien que, assez rondelette. Elle devait mesurer cinq pieds six, et peser
environ 135 livres. Elle avait un beau visage rond, des os bien dissimulés,
des yeux et une bouche toujours prêts à sourire. La vie pour elle semblait
facile. Joviale et calme, la discipline ne l'effrayait pas. Elle acceptait
un certain laisser-aller mais savait quand intervenir afin de garder un
niveau de discipline acceptable, tout en permettant aux élèves d'être à
l'aise; sans nuire à la progression normale de la classe. Bertrand n'était
pas sans essayer de reprendre son leadership de temps en temps, mais elle
lui parlait si doucement et avec émotions, qu'elle lui faisait souvent tirer
une larme, et, c'est gênant pour un gars de quatorze ans en quatrième année
de pleurer; chaque fois il se rasseyait docilement.
Cette fille
jouissait d'un vrai talent d'enseignante. Déjà dès ses premières années
d'enseignement, elle déployait un charisme qui attirait les gens vers elle.
Je me rappelle que mon père appréciait son intelligence et l'à propos de
ses discussions. Elle attaquait volontiers divers sujets concernant les
différentes activités sociales de la paroisse; à qui elle prêtait son
assistance! Elle faisait aussi partie des différentes organisations
paroissiales ou municipales. Elle possédait un esprit sensé dont les idées
s’exprimaient à travers une personnalité à la fois ouverte, dynamique et
sympathique, qui savait se faire écouter grâce à son élocution enthousiaste
et ses propos sensés.
Nous avions
fait une bonne année avec elle et, elle était fière de nous; même si c'est à
elle qu'on le devait. La visite de l'inspecteur ne l'avait pas du tout
inquiétée; elle savait qu'elle pouvait compter sur ses élèves. Devant un tel
calme et une telle assurance, nous étions, nous aussi demeurés calmes. La
visite de l'inspecteur était pour nous une visite de routine plutôt simple,
c'était toujours le monsieur bien gentil que l'on avait déjà vu à maintes
reprises. Il semblait être sûr à l'avance que les élèves de Béatrice
obtiendraient de bonnes notes; et elle de même.
Cette année-là,
c'est avec enthousiasme que nous attendions la visite de l'inspecteur. On
avait hâte qu'il nous pose ses questions; supposément difficiles. On lui
répondait du tac au tac et on espérait qu'il aurait une question pour chacun
de nous, afin de pouvoir lui montrer notre savoir. C'était un jeu et, même
Béatrice affichait un petit rire moqueur, rassurant pour nous, derrière
l'inspecteur. Tel un coach au hockey, elle savait son équipe capable de
gagner, l'inspecteur ne trouva rien à redire. Avant de partir, il y eut un
petit sourire hésitant et incertain dans son regard. Sa formule si souvent
répétée pour les petites réprimandes et les correctifs à y apporter ne
pouvait pas servir. Il devait donc déclarer à l'improviste; "vous avez bien
travaillé et j'espère que vous finirez l'année en beauté". La fierté de
notre ego ne s'était jamais affichée si orgueilleusement sur nos visages et
dans nos cœurs d'enfants.
Bibiane Parent
n'affichait pas une si belle personnalité, mais, dans son genre particulier,
elle possédait toutes les qualités d'une bonne institutrice. Elle n'était ni
grosse ni grande ni belle ni laide. Ce n'est sûrement pas parce qu'elle
était de type moyen ou moins flamboyant que je n‘arrive pas à en faire une
meilleure description physique. Elle faisait partie de celles qu'on ne voit
pas. Une personne se regarde dans la glace et ne se voit pas. Un enfant
regarde sa mère et ne la voit pas. Bibiane donnait à chaque enfant
l'impression qu'elle s'occupait de lui personnellement et qu'elle l'aimait,
lui particulièrement, sans rendre les autres jaloux. Elle donnait à chacun
attention et amour, elle était maternelle; c'est peut-être cette grande
qualité qui nous faisait oublier qu'elle était aussi une jolie jeune fille,
que bien des garçons voulaient courtiser. Si ses enfants lisaient ceci, ils
seraient sûrement très fiers de constater qu'ils ne sont pas les seuls à
aimer leur mère et surtout à en faire l'éloge.
Son courtisan
fut Adrien Ouellet. Ils formèrent un couple d'amoureux qui se méritait l'un
l'autre. Je sais qu'ils ont élevé une belle famille que je n'ai
malheureusement pas pu connaître, sinon, ce que m’en disait Omer lorsque je
lui en parlait. Un jour que je passais à St-Mathieu au début des années
soixante, j'arrêtai la visiter. Cette attention de la part d'un de ses
anciens élèves l'avait beaucoup touchée. J'étais heureux de la revoir avec
ses jeunes enfants qui me paraissaient bien élevés; à son image.
Je ne l'ai
jamais oubliée. Elle a su faire du jeune garçon de douze ans (en
pré-adolescence que j'étais) un enfant modèle, obéissant et heureux, qui
aurait tout fait pour lui plaire. J'avais douze ans, oui, mes sens
commençaient à s'éveiller à la vie. Son corps de femme n'était pas non plus
sans exciter cet esprit qui s'éveillait. Je voyais en elle ce genre de femme
dont je rêverais plus tard. Elle m'avait enseigné deux ans plus tôt, et
cette année-là, je l'avais beaucoup appréciée également en tant
qu'institutrice, mais entre la période de 10 à 11 ans et celle entre douze
et treize ans, il se passe des choses étonnantes dans le cerveau d'un
apprenti adolescent. Je commençais à voir en elle la femme, et les
différences que cela comportait quand je la comparais aux filles de la
classe. Je ne détestais pas qu'elle s'approche de moi le plus souvent
possible pour vérifier mes travaux et s'assurer que je passerais mon
certificat de septième année avec succès. J'oubliais que c'était pour moi
que je travaillais si fort pour réussir; car, inconsciemment, je le faisais
pour lui plaire. Malheureusement pour elle et pour moi, je n'ai pas pu lui
faire le plaisir de voir ma réussite. Nous avons déménagé le 18 juin 1951,
trois jours avant la fin des examens pour le certificat. J'en étais désolé
mais je n'aurais jamais pu rester derrière la famille qui partait; c'était
impensable pour moi. Bibiane Parent, bien à son insu, fait désormais partie
des mes souvenirs les plus précieux.
Il n'était pas
facile pour ces filles d'enseigner dans ces petites écoles de rang,
spécialement la nôtre, qui était loin de tout, à une époque où l'automobile
était presque inexistante. Aucune famille du quatrième n'avait
produit d'enseignantes. Les filles venaient soit du haut ou du bas de la
paroisse. Celles du village n'étant pas très intéressées à enseigner dans
les rangs, peut-être parce qu'elles étaient désavantagées vis-à-vis les
filles de fermiers qui elles, pouvaient se faire conduire en voiture à
cheval par quelqu'un de leur famille. Les distances qu'elles avaient à faire
semblent bien courtes maintenant, mais avant l'arrivée de l'automobile qui
circule dans les routes l'hiver comme l'été, il en était tout autrement.
De plus, la
pauvre fille devait demeurer à l'école toute la semaine afin de chauffer le
poêle à bois. Toutefois quelqu'un était désigné pour assurer cette tâche les
fins de semaines afin d'éviter à l'eau de geler dans les tuyaux. De toute
façon elle n'aurait pas pu voyager tous les jours. Je vois très mal le
cheval (véhicule du temps) rester parqué à moins 30 ou moins 40
degrés toute la journée devant l'école. L'idée de demeurer à l'école ne
semblait pas très attirante non plus. Par temps très froids, on ne
réussissait pas à chauffer le poêle assez fort pour empêcher les tuyaux de
geler, sans augmenter le danger de feu. Les bécosses étaient à l'extérieur,
mais heureusement un passage intérieur avait été aménagé pour s'y rendre; ce
qui évitait d'être dans l'obligation de s'habiller chaudement pour aller
faire ses besoins la nuit à la noirceur; spécialement avant l'arrivée de
l'électricité en 1948. Il n'y avait pas de bain ni de chambre de bain. Un
pot de chambre sous le lit, et un évier dans le coin de la chambre à
coucher, au froid, étaient toutes les commodités de cette école.
Le poêle étant
dans la classe, la chambre ne recevait aucune chaleur directe; donc elle
était très froide et il fallait un amoncellement de couvertures pour se
tenir au chaud dans le lit. Et lorsque cette pauvre fille avait réussi à se
réchauffer, grâce à cet amoncellement de couvertures, elle devait se relever
et retourner chauffer le poêle. Les jours de grands froids, nous passions
les avant-midi emmitouflés dans nos mackinas et nous essayions
d'écrire avec nos mitaines. Si on regarde en arrière avec les yeux
d'aujourd'hui, il nous semble que ces filles étaient dévouées comme des
esclaves dans des conditions inhumaines, pour des salaires de quelques
centaines de dollars par année, pour enseigner et éduquer des enfants dont
les parents n'appréciaient même pas la valeur de l'instruction.
Qui étaient-ils
ces enfants et de quoi avaient-ils l'air? Ils étaient des garçons et des
filles issus des grandes familles du bas du fleuve; qui comprenaient en
moyenne, une douzaine d’enfants. La plupart venaient des fermes à
l'exception de ceux des employés de Désiré Dionne. Chaque enfant était
suivi de son cadet, environ un an plus jeune. Matin et soir, ceux des fermes
allaient à la grange, et souvent ne s'étaient pas changé de linge avant de
partir pour l'école; ça se sentait, et ça se voyait sur leurs chaussures.
L'étoffe du pays et les sous-vêtements de laine étaient transporteurs
d'odeurs et, étant donné que la laine piquait beaucoup moins quand elle
était adoucie par la saleté, on ne les faisait pas laver inutilement. On
pouvait facilement deviner aussi, ceux qui pissaient au lit, cela rendait
les senteurs de grange agréables par comparaison.
On pissait au
lit parce que l’on attrapait du froid. Et on avait toutes les raisons
d'attraper du froid, surtout parce que nous étions plutôt mal chaussés. Il y
en avait toujours quelques-uns qui avaient le rhume, mais n’avaient
jamais de mouchoir, reniflant constamment ce délicat petit filet de mucus
qui semblait plus vigoureux lorsque arrivait le temps de la lecture; debout
devant le pupitre de la maîtresse. Quel paysage! Regarder ces petites
langues devenues si habiles à s’occuper du va et vient de ce filet sur la
lèvre supérieure au rythme de la respiration. Ces enfants n'étaient ni pires
ni mieux que les autres. Ils étaient les enfants d'une certaine civilisation
à une certaine époque. Des enfants qui avaient la chance d'apprendre à lire
et à écrire jusqu'à la septième année. Leurs parents, une génération avant
eux, n'avaient pas eu cette chance. La plupart avaient dû s’arrêter à la
troisième année, à part quelques exceptions, qui eux, avaient pu se rendre
jusqu'à la quatrième année. Leurs grands-parents ne savaient même pas signer
leur nom. Deux de mes enfants eux, troisième génération après mes parents,
ont pu réussir à compléter leur doctorat à l'Université. Que les choses
changent vite! Je suis quand même reconnaissant envers cette école et ces
institutrices, que j'appelle souvent l'Université du quatrième
St-Mathieu, car elles m'ont permis d'acquérir une bonne base qui m'a servi
de tremplin pour tout ce que j'ai appris à l'école de la vie.
La religion et
la politique de ce temps-là au Québec voulaient que l'on produise de très
grosses familles afin de battre en nombre les Anglophones. C'était le
nationalisme du temps. Depuis les années soixante-cinq nous parlons plutôt
de séparatisme. En démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Et la
majorité n'a pas besoin d'instruction ni de métiers pour vaincre; seulement
le nombre de votants. On serait bûcherons, cultivateurs ou manœuvres, cela
importait peu pour ces dirigeants sans vision du futur. Plus tard on se
plaindra d'être dominés économiquement par les Anglais, plus instruits dans
la gestion et les affaires. Parmi ces enfants se trouvèrent des ambitieux
qui durent émigrer dans les grandes villes où ils pourraient donner libre
cours à leurs talents. Beaucoup d'autres qui n'ont pas eu le courage d'oser
ou qui n'avaient pas les capacités de le faire, ont fini par joindre les
rangs des masses d'assistés sociaux que l'on retrouve maintenant dans ces
régions dites défavorisées.
La petite école
de chez-nous n'était pas différente des autres écoles de rang ailleurs.
L'école n'était pas un moyen de formation, non plus qu'une continuation de
l'éducation reçue à la maison. Aucune notion sportive n'y était offerte.
Aucune sortie éducative ni aucune visite à l'extérieur non plus. Les leçons
de civisme et de bienséance étaient presque inexistantes. Nous jouions à la
balle comme les enfants d'aujourd'hui le font encore dans la rue mais nous
ne savions pas qu'il existait des jeux de balle bien structurés, avec
règlements et discipline. Nous jouions selon ce que l'instinct nous dictait,
mais cela ne nous empêchait pas de nous amuser ferme. Bien sûr, outre ces
quelques sports largement pratiqués maintenant, les belles côtes abruptes,
la neige abondante, l'eau et les glaces des ruisseaux, des rivières et des
lacs, nous procuraient plus d'amusement qu'il est possible d'en inventer
aujourd'hui dans les milieux urbains. Nous étions des enfants heureux,
comblés par une nature riche aux formes variées, offrant aux jeunes une
formation que les livres ne sauraient compenser. Toute notre vie dépendait
de la nature et était soumise aux caprices des saisons. Comme les arbres,
les plantes, les grains et les animaux, nous nous acclimations dès que les
saisons nous en donnaient le signal.
C'est peut-être
là, la plus grande des formations, acquérir cet instinct naturel et
le sens de la perception des choses, cette faculté qui échappe souvent aux
gens des centres urbains qui n'ont pas pu bénéficier de ce privilège dans
leur enfance.
|